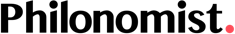Dans Humus, son dernier roman paru en 2023 aux éditions de l’observatoire, le philosophe Gaspard Koenig met en scène deux jeunes diplômés de l’école d’ingénieurs AgroParisTech, animés d’une même passion pour l’écologie – et les vers de terre, pour être précis. Les deux amis suivent pourtant des destins opposés : l’un se lance dans une start-up à haute croissance, tandis que l’autre préfère « déserter » le système. Lequel a raison ? Et en quoi le récit de leur parcours permet-il de saisir les difficultés qu’ont les jeunes à trouver leur voie dans un monde complexe ? Réponses de l’auteur.
Propos recueillis par Anne-Sophie Moreau.
Comment vous est venue l’idée d’écrire un roman sur des jeunes portés par un idéal écologique ?
Gaspard Koenig : J’ai voulu écrire un roman d’apprentissage. Mon idée était de mettre deux jeunes gens mus par un idéal écologique dans le bain de la société, avec toute sa complexité économique, administrative et sociale, afin de les tester, comme en laboratoire. J’avais été marqué par le discours des « bifurqueurs », que j’ai revu cinquante fois, où des étudiants d’AgroParisTech expliquaient, lors de la remise des diplômes, leur refus de rejoindre de grands groupes accusés de détruire la planète. Je les ai trouvés très touchants. Ce moment est très beau, parce qu’ils sont un peu intimidés, tremblants, polis, mais néanmoins très construits dans leur discours.
En quoi vos deux personnages sont-ils représentatifs des contradictions qui animent les jeunes diplômés aujourd’hui ?
Je ne voulais pas montrer des idéalistes militants, mais des jeunes représentatifs de leur génération. Mes deux héros décident de ne pas monter sur scène avec les bifurqueurs, après avoir hésité. Ce sont des jeunes qui ont certes un idéal en arrière-fond – ils ont bien écouté les conférences de l’ingénieur Jean-Marc Jancovici, répètent des phrases stéréotypées sur la décroissance, les limites planétaires, etc. – mais qui ne sont pas des guerriers. Leurs choix se font de manière hasardeuse : l’un part s’installer comme néorural à la campagne pour plaire à une fille, avant de se prendre au jeu, une fois coincé dans son propre fantasme. L’autre, venu de Limoges, voulait connaître la sexualité débridée des nuits parisiennes et se retrouve embarqué dans le capitalisme vert.
Le fait de montrer un concours de circonstances et non pas le déroulement implacable d’un projet militant rend la tension plus vive : Arthur, plutôt pragmatique au début, se radicalise peu à peu, alors que Kevin, lui, prend le chemin inverse. Mes deux héros suivent chacun un modèle opposé pour le pousser à l’extrême, l’un dans le capitalisme d’un côté, l’autre dans la révolution. Ce ne sont pas des choses qui arrivent à tout le monde. Mais lorsqu’on essaie de penser leur trajectoire, on retrouve une tension qui est très symptomatique de ce que vivent les jeunes actifs aujourd’hui.
“L’amitié de mes deux personnages a valeur de parabole”
Que diriez-vous aux jeunes qui souhaitent préserver le vivant et se retrouvent tiraillés entre le capitalisme ou la désertion ?
Si j’ai choisi d’écrire un roman et pas un essai, c’est justement pour ne pas donner de solution ! Le sujet est très complexe, et me laisse moi-même dubitatif. Certains jours, je me réveille en voulant vivre en autonomie comme Arthur ; le lendemain, je me prends de passion pour des start-up, comme Kevin. Je suis l’actualité de la finance régénérative comme celle des Soulèvements de la Terre, collectif qui me semble aussi très pertinent dans sa logique. Je n’arrive pas à voir de contradiction absolue ou à choisir un camp.
Au fond, l’amitié de mes deux personnages a valeur de parabole : si elle demeure possible, malgré leurs choix divergents, cela signifie que ces deux modèles de société peuvent se réconcilier et mener au même but ; s’ils ne parviennent pas à maintenir cette amitié, c’est que ces modèles sont irréconciliables. Cette amitié hésitante plonge dans cette question de la compatibilité de ces deux options par rapport à la crise écologique. En revanche, cela ne m’a même pas traversé l’esprit de faire adhérer mes héros au parti des Verts – comme si les convictions fortes des jeunes les empêchaient de s’engager dans une structure politique.
Vous présentez une vision assez noire du monde des start-up, à travers l’entreprise de Kevin qui développe un modèle de vermicompostage à grande échelle tout en falsifiant ses procédés de recyclage…
J’ai voulu décrire le fonctionnement du capitalisme contemporain. L’histoire de ma start-up de vermicompostage est calquée sur celle de Theranos, la société américaine qui proposait des analyses de sang et dont la fondatrice, Elizabeth Holmes, a été jugée pour fraude et écrouée. Si je mets en scène le parcours de mon héros Kevin dans les fonds d’investissement de la Silicon Valley, c’est pour montrer que lorsqu’on passe du capitalisme bancaire au capitalisme de capital-risque, on change complètement d’univers – ce qui affecte la manière de concevoir et de présenter des projets entrepreneuriaux. Une banque exige un projet qui marche ; peu importe qu’il marche extrêmement bien ou moyennement bien : elle récupérera la même somme à la fin. Il faut donc lui présenter des projets rentables. Un fonds de capital-risque américain, lui, finance mille projets en sachant que 998 vont échouer mais que deux feront des millions, qu’ils seront l’équivalent des Google, des Facebook… C’est pourquoi on ne peut leur présenter des projets modestes et équilibrés ; il faut leur dire qu’on va changer le monde. Ce n’est pas une condition morale, mais un business model !
“Les fondateurs de start-up sont obligés de vouloir grandir, grandir, grandir, et d’aller vite”
Kevin ne parvient pas à réunir 60 000 euros pour son projet initial, qui était de produire de sympathiques vermicomposteurs pour appartements ; la seule solution, pour lui qui n’avait au départ que peu d’ambition, c’est finalement de demander dix millions à des fonds d’investissement. En un sens, cette méthode est plus facile : tout se joue dans le pitch. On ne vend plus un bilan comptable pour obtenir un prêt bancaire, mais du rêve pour une prise de participation qui, sait-on jamais, pourra se transformer en succès. Les fondateurs de start-up sont obligés de vouloir grandir, grandir, grandir, et d’aller vite. C’est ce qui a piégé Theranos : la technologie n’était pas au point, mais déjà les investisseurs leur demandaient de trouver des clients. Il fallait donc « fake it until you can make it » [faire semblant jusqu’à ce que cela marche, ndlr]. Or il s’agissait de données médicales, avec la vie et la mort pour enjeu. C’est ce fonctionnement que j’ai voulu montrer : celui d’un système où l’on ne s’engage pas par idéalisme, mais pour des raisons économiques.
Cela dit en passant, je constate que l’élite est très douée pour se recycler : on retrouve les mêmes noms issus des mêmes familles dans les grandes écoles, dans les grands groupes, et maintenant dans les start-up. Ce monde de la disruption est totalement récupéré par l’élite habituelle. Par ailleurs, ces start-up n’ont pour seul horizon que d’être rachetées : cette scène censée être innovante finit donc par alimenter l’hyperconcentration des très grands groupes, ce qui ne crée pas de diversité économique et entrepreneuriale. C’est rageant.
“J’aimerais sauver le capitalisme pour l’agriculture, et lui donner la chance d’être non productiviste”
Vous qui vous présentez comme libéral, diriez-vous que l’écologie et le capitalisme sont forcément incompatibles ?
Aristote, dans sa Politique, opère une distinction assez classique entre l’économie et la chrématistique. La première, du grec oikos signifiant la maison, désigne la manière de gérer le foyer, d’échanger des biens au sein de la communauté de manière équilibrée et dans le seul but de vivre bien. La seconde correspond au fait de gagner de l’argent pour l’argent, de devenir investisseur. Il s’agit de faire la différence entre l’argent comme moyen et l’argent comme fin.
Aristote prône l’économie et condamne la chrématistique ; mais il précise, dans un passage étonnant, qu’il existe un genre de chrématistique qui n’est pas mauvais, à savoir la chrématistique appliquée au domaine de l’agriculture. C’est justement ce que je voudrais faire : j’aimerais sauver le capitalisme pour l’agriculture, et lui donner la chance d’être non productiviste. Il me semble qu’on peut penser un capitalisme décroissant. L’économie de marché, pour le dire de façon plus neutre, peut garder une légitimité, parce qu’elle est plus créative, plus inventive et plus libre que les solutions administrées, et peut être mise au service d’un projet, à la fois d’entreprise ou de société, qui ne soit pas dans l’accumulation et la surproduction. Je note qu’à l’inverse, les sociétés communistes, soviétiques notamment, étaient tout sauf sympathiques pour l’environnement ou écologistes. Les productivismes de tous bords : voilà ce contre quoi il faut lutter.
Il faut donc un peu de capitalisme, à condition de mener des projets raisonnés ?
Je pense qu’on peut créer des projets qui ne visent pas l’accumulation des revenus. C’est d’ailleurs ce que font naturellement les bifurqueurs. Quand ils s’installent dans des fermes coopératives, ils vendent leurs produits sur les marchés. C’est le début du capitalisme ! En tout cas, les jeunes ont raison de ne pas vouloir d’un capitalisme vert mou, et de refuser de travailler dans une boîte qui se contente de « faire de la RSE ».
“L’écologie est devenue un truc de vieux”
Les jeunes sont-ils tous écolos de nos jours ?
Il faut savoir distinguer entre les différentes générations de « jeunes ». Le public auquel je m’adresse dans mon livre, ce sont des gens qui ont entre 25 et 40 ans. Greta Thunberg a déjà 21 ans ; la « génération Greta », qui a fait ses marches pour le climat, est maintenant quasiment dans la vie active. De ce que j’ai pu voir, les lycéens qui leur succèdent ne sont pas intéressés par l’écologie.
Lors d’une présentation de mon livre auprès de jeunes qui semblaient s’ennuyer ferme à l’évocation du sujet, je leur ai posé la question : « Vous n’avez pas l’air si passionnés par l’écologie, n’est-ce pas ? — C’est vrai, on s’en fout », m’ont-ils répondu avec une franchise incroyable, devant leurs professeurs qui faisaient des mines décomposées. Pour eux, c’est un sujet qu’on leur impose, et ils se demandent surtout pourquoi ce serait à eux de payer les erreurs passées. Ils ont par ailleurs le sentiment que c’est très institutionnalisé : aujourd’hui, il faut devenir « écodélégué » parce que ça fait gagner des points sur Parcoursup, mais dans le fond, ça les ennuie. Ils décrivent enfin très bien le fait que les mêmes adultes qui leur imposent ces contraintes sont de parfaits tartuffes qui n’appliquent absolument pas leurs principes écologiques dans leur propre vie. Bref, l’écologie est devenue un truc de vieux. L’ambiance est plutôt à la fast fashion qu’à la décroissance !
Le fait même que ces lycéens se soient exprimés de manière aussi unanime sur scène, alors qu’ils étaient devant leurs camarades, montre que cette attitude de désinvolture par rapport aux questions climatiques est aujourd’hui devenue « cool ». Les lycéens sont grégaires : il y a cinq ans, ils auraient tous marché pour le climat ; aujourd’hui, la mode a changé. Or la crise écologique, elle, ne change pas, et s’aggrave. C’est peut-être une question d’âge plus que de génération : on peut imaginer que ces gens-là vont s’intéresser à ces questions en grandissant. Toujours est-il que ce n’est pas un acquis : le travail de sensibilisation est à reprendre à chaque génération.
Arthur, votre personnage de décroissant qui part cultiver son champ, est issu d’un milieu privilégié. La sensibilité aux questions écologiques est-elle l’apanage des bourgeois ?
Je serais moins affirmatif sur ce point. Kevin, mon personnage d’entrepreneur, est d’un milieu rural profond et a pourtant la même conscience écologique que son ami, du moins au départ. En Normandie, où je vis en partie, je croise de tout : des riches qui se moquent de l’écologie et prennent l’avion constamment, des ouvriers qui vont à l’usine en vélo électrique et qui prennent soin de la nature… À l’inverse, l’écologie peut être une source d’économie, notamment dans le contexte de l’inflation alimentaire : pour les ménages, cela vaut le coup, d’un point de vue financier, de pouvoir consommer les fruits de son potager et les œufs de ses poules. Au fond, je trouve qu’il est un peu méprisant de dire que les pauvres se moquent de l’écologie. C’est moins une question de classe que d’habitude et d’éveil personnel, d’accès à la nature aussi. Je pense que l’expérience pratique de la nature est un déclencheur : il est compliqué d’être écolo en ville, intellectuellement.
“La désobéissance civile est essentielle”
À la fin du roman, vous décrivez une révolution souterraine qui vire à la lutte armée. Les jeunes écolos ont-ils raison d’être radicaux aujourd’hui, en s’opposant par exemple à la construction des mégabassines ou de l’autoroute A69 ?
Des actions comme celles de Sainte-Soline ou contre l’autoroute A69 ne sont pas faites dans une perspective révolutionnaire, mais obéissent au schéma de la désobéissance civile, notion qui est au cœur de l’écologie politique puisqu’elle a été formalisée par Henri David Thoreau, penseur du XIXe siècle. On reste dans le cadre d’actions concentrées sur un objectif précis, qui visent la prise de conscience et qui sont globalement conçues de manière responsable. Les militants qui envoient de la peinture sur des tableaux s’assurent qu’il y a une vitre, par exemple. On n’est pas du tout dans le vandalisme. Or la désobéissance civile est essentielle. Ce n’est pas parce les lois sont votées par des représentants qu’il n’est pas légitime de les contester. C’est à cet espace de contestation qu’on doit tous les grands progrès, les révolutions démocratiques, les droits des femmes, l’affranchissement des Noirs aux États-Unis…
Mais ce que je mets en scène dans mon roman, ce ne sont pas tant les mouvements d’aujourd’hui que ceux de demain : en effet, on voit peu à peu, au sein des mouvements écologiques, être théorisée l’idée que la violence est légitime. Cela a commencé avec le succès de Comment saboter un pipeline, le manifeste d’Andreas Malm [La Fabrique, 2020, ndlr]. Et puis cela a infusé. On voit se tenir des conférences ayant comme sujet « La violence est-elle légitime ? », organisées par des mouvements comme Extinction Rébellion. Ce que j’ai voulu mettre en scène, c’est l’idée que la génération d’après verra les choses autrement. Pour elle, on n’aura plus le temps de la prise de conscience. Elle se moquera de l’adhésion de la population et cherchera la prise de pouvoir par l’action directe, comme dans les années 1970. Il s’agit d’un terrorisme quasiment sartrien, où la violence comme prise de l’État est vue comme le seul moyen de faire advenir une révolution. Je ne dis pas que je l’appelle de mes vœux ; je décris simplement ce qui me semble être la suite logique du mouvement militant écolo. J’ajoute que cette scène de révolution a beaucoup perturbé mes lecteurs : au fond, les gens ne sont plus habitués à la violence politique. Or celle-ci fait partie de notre histoire : il faut sortir du déni et être capable d’imaginer son retour.