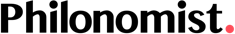« On est une grande famille. » On retrouve souvent ce poncif au sein des entreprises, de la petite boîte à la multinationale cotée en bourse. Mais est-ce vraiment désirable ? N’y a-t-il pas un risque à considérer un organisme comme un bloc naturellement uni, à mettre de l’affect là où d’autres attendent loi et respect ? Dans cet entretien, la philosophe Sophie Galabru, auteure de Faire famille (Allary, 2023), explore les écueils de ce « familialisme ».
Propos recueillis par Alexandre Jadin.
Quel est le problème, au fond, à vouloir « faire famille » au sein d’une entreprise ?
Sophie Galabru : Le premier problème, c’est le fait d’exporter la famille à un groupe qui ne lui ressemble pas. Au travail, nous n’avons pas les mêmes responsabilités qu’envers nos enfants ou encore nos anciens. Nous ne nous réunissons pas pour développer les mêmes liens d’affection, de confiance et d’intimité.
Par ailleurs, le risque est de n’importer qu’une seule vision de la famille et de négliger les autres conceptions possibles. Le plus souvent, la conception importée relève du familialisme. Cette idéologie considère la famille à partir de son unité, de sa cohésion, de sa cohérence : elle passe parfois par l’uniformité, la similitude voire la recherche de la ressemblance totale. En contrepartie, elle interdit les divergences, les différences.
“Faire famille, précisément, suppose un travail de construction qui n’a rien de naturel”
Avec des effets pervers…
Avec cette idéologie, les prises de liberté sont mal perçues, et elles sont même étouffées, condamnées. Dans certaines familles, cela peut mener à des violences ou des négligences intrafamiliales soutenues ou dissimulées au nom de l’unité absolue qu’il doit y avoir dans le groupe. L’intérêt du groupe familial passe alors avant les intérêts des individus, y compris quand il s’agit de délits ou de crimes très graves. On le voit notamment dans les affaires d’inceste, où la famille souhaite que le crime reste étouffé. On préfère alors expulser la victime du groupe plutôt que l’agresseur.
Faire famille, précisément, suppose un travail de construction, d’attention, de réflexion qui n’a rien de naturel ou de facile. Je pense que c’est peut-être parce que les gens croient en l’idée d’une famille naturelle qu’ils se heurtent à de grandes difficultés ou des épreuves, voire des échecs : on n’aura peut-être pas assez mis en valeur cette idée de construction.
“La logique familialiste introduit le régime du sentiment plutôt que celui du respect”
Dire « on est comme une famille » dans son entreprise, ce serait donc faire le jeu du familialisme ?
Bien sûr, c’est sous-tendre une vision familialiste : tous pour un, un pour tous ! Dans mon livre, je reprends l’exemple de cette entreprise qui prenait ses salariés pour des écureuils (j’ai volontairement changé l’animal). Le directeur général se désignait lui-même comme « papa écureuil » afin de renforcer le sentiment de chaleur humaine, de cohésion avec les salariés. Derrière, c’est l’idée que l’on a le même pedigree, les mêmes intérêts – mais ce n’est pas vrai.
Le transfert de la logique familialiste à l’entreprise a pour effet de développer des liens informels, d’introduire le régime du sentiment plutôt que celui du respect et des liens légaux. À court terme, l’affect est intéressant et embaume les relations, mais il les rend plus complexes lorsqu’il s’agit de défendre de manière juridico-légale ou professionnelle des droits ou des intérêts.
Pourtant, les collègues développent entre eux des liens qui n’en restent pas toujours au contractuel…
Il ne faut pas se méprendre. Je ne dis pas que l’amour, l’amitié ou des liens d’affect n’existent pas entre des collègues. Tout cela arrive, c’est possible, mais ce n’est pas une finalité à imposer. À partir du moment où il y a une injonction, presque une stratégie pour oppresser, culpabiliser, procéder à du chantage précisément affectif, c’est là que c’est problématique.
“Certains citoyens aiment être maternés, paternés, infantilisés”
Au-delà des stratégies de management, comment expliquez-vous qu’il existe chez certains salariés un désir de faire famille avec leur entreprise ?
Il y a d’abord une certaine nécessité. Si on arrive dans une entreprise et que l’on voit tous ses collègues adhérer à cette proposition familialiste, on n’a pas l’idée de s’y opposer ou de rechigner. On adhère aux codes sociaux et aux propositions par besoin économique et on s’intègre à la boîte et aux collègues par besoin social.
Ensuite, l’effet d’entraînement des autres joue aussi beaucoup. La dissidence est compliquée à assumer : elle mène à la solitude, et peut même menacer une position socioprofessionnelle. Mais je pense qu’il y a surtout une intériorisation inconsciente de ces deux raisons, motivée par le pragmatisme et un besoin d’intégration.
Après, il ne faut pas exclure qu’il y ait des salariés qui apprécient la valeur familiale, et aiment la voir exportée dans diverses relations – dans le cercle amical ou dans la sphère du travail. Ils y voient peut-être quelque chose de plus chaleureux et d’affectueux.
Philosophiquement, comment comprendre un tel désir ?
Certains salariés ne sont pas insensibles à un management qui passe par le « nursing » [le maternement, ndlr]. Chez des philosophes comme Tocqueville ou La Boétie, on retrouve cette idée que certains citoyens aiment être maternés, paternés, infantilisés, parce qu’il y a toute une dimension de prise en charge qui leur est agréable.
Il est agréable et doux de se laisser aller aux injonctions, aux demandes, de ne pas se fixer des objectifs soi-même, mais de vouloir plutôt exaucer ceux des autres pour ne pas se positionner en individu autonome ou en individu indépendant. Et puis pour d’autres personnes, ce familialisme apporte une certaine chaleur qui n’est pas pour leur déplaire. Mais à terme, il y a également un risque d’infantilisation.
“L’entreprise exporte un familialisme qui n’est pas exempt de certains résidus du patriarcat”
Dans le familialisme que vous décrivez, il y a aussi la notion de patriarcat.
Oui, l’entreprise exporte un familialisme qui n’est pas exempt de certains résidus du patriarcat. La famille n’est pas un refuge, une pure sphère d’intimité close et sans rapport avec le monde. Elle est le reflet de ce qui se passe dans la société ; c’est une microsociété qui introduit l’individu à la notion de justice, d’égalité et d’équité, de liberté, qui lui fait aussi comprendre le rapport à l’autorité, les rapports de force et même parfois les rapports de domination.
Et inversement, le patriarcat s’est nourri du salariat. Il faut en revenir à Engels qui disait que la femme est la première des prolétaires, la première exploitée dans sa cellule familiale. D’un point de vue économique, toutes les tâches domestiques non rémunérées – coudre, cuisiner, faire le ménage, élever des enfants – permettent de libérer du temps au mari, pour qu’il puisse travailler davantage et avoir la possibilité d’être promu.
Vous écrivez dans votre livre que « nous portons une attente infinie, celle d’être un jour accueillis par ceux qui nous ont fait venir au monde ». À rebours de ces désirs démesurés, vous proposez une « vision minimaliste » de la famille. Pouvez-vous l’expliquer ?
Dans mon livre, il y a un versant descriptif qui interroge la signification de la famille, mais il y a aussi un versant normatif : qu’est-ce qu’on est en droit d’en attendre ? Avoir des attentes comme la sécurité, la responsabilité, l’intimité, la confiance dans ces liens-là, ce n’est pas une attente démesurée ou délirante.
Fonder une famille, c’est une construction qui peut prendre plusieurs visages, plusieurs formes qui évolueront au cours du temps. Faire famille, c’est produire un équilibre, mais instable, qui sera forcément déstabilisé par des épreuves de vie, par le temps qui passe, par des reconfigurations. Finalement, ce qui doit rester, c’est la sécurisation, la responsabilité des uns et des autres, l’affection (ou au moins, le respect), la bienveillance, l’écoute. Tout ce qui peut faire perdurer ce groupe, malgré toutes ses transformations et ses fragilisations.