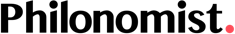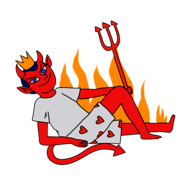Le point commun entre une association de militants écolo, une communauté de communes, une entreprise agroalimentaire et un collectif de riverains en colère ? Ils sont tous obligés de rendre des comptes. Toutes les organisations, privées ou publiques, lucratives ou non, petites ou grosses, font leur compta : pourquoi ne pas s’appuyer sur ce langage commun pour créer un nouvel espace d’expérimentation et de dialogue ? Quelques pistes concrètes pour une comptabilité vraiment écologique, avec Clément Feger et Alexandre Rambaud.
➤ Retrouvez la première partie de l’entretien : “La comptabilité, objet philosophique ?”
Propos recueillis par Apolline Guillot.
Existe-t-il déjà des normes comptables unifiées à l’échelle mondiale ?
Alexandre Rambaud : Il en existe, mais seules les entreprises cotées doivent suivre ces normes comptables internationales. Ces dernières ont été construites au sein de la Fondation des normes internationales d’information financière (IFRS Foundation), un organisme de droit privé, domicilié dans un paradis fiscal aux États-Unis, le Delaware. En 2002, l’Union européenne (UE) lui délégué sa normalisation comptable pour les groupes cotés et de nombreuses entreprises et investisseurs internationaux se basent sur les IFRS actuellement, sans que ces normes soient réellement internationales. En tolérant une perte de souveraineté comptable sur les grandes entreprises, l’UE s’est coupé la possibilité d’intervenir sur les normes pour les modifier, même si elle le souhaitait.
Clément Feger : N’oublions pas que la norme comptable est une convention qui n’a rien d’objectif ou de scientifique. Le philosophe Cornelius Castoriadis disait que la légitimité de la norme, c’est la possibilité de la reprendre. À partir du moment où l’on considère qu’une norme ne peut plus être reprise, elle n’est plus légitime. Or aujourd’hui, il est impératif de la réinterroger, de la repositionner dans les nouvelles problématiques, notamment écologiques, qui se posent.
D’où votre travail sur la comptabilité dite « écologique », au Collège des Bernardins, et en particulier, Alexandre Rambaud, à travers l’élaboration d’une comptabilité globale pour l’écologie (« Comprehensive Accounting in Respect of Ecology » ou CARE). Ce modèle marque-t-il une rupture par rapport à la comptabilité classique ?
A. R. : Le modèle CARE s’inspire de la comptabilité classique, en revenant à la signification première de « capitaux ». Ce mot existe depuis l’Antiquité et renvoie simplement à une dette. Longtemps, ce n’était pas un terme économique mais bien juridique, qui signifiait tout simplement qu’il fallait rembourser l’argent qu’on nous prête. Encore aujourd’hui, la comptabilité d’entreprise continue à utiliser la notion de capital dans ce sens historique. Un autre sens est apparu par glissement sémantique à partir de la Renaissance : le capital devient un ensemble d’actifs, de ressources productives à faire fructifier – ce qui favorise les actionnaires et les propriétaires au détriment des autres parties prenantes. C’est aujourd’hui celui qu’utilisent l’économie et la comptabilité financiarisée.
“Nous ne faisons qu’aligner les normes comptables sur les sciences écologiques”
—Alexandre Rambaud
Le modèle CARE reprend l’idée première des « capitaux » comme des dettes, pour ensuite l’élargir aux enjeux non financiers. Il définit littéralement un capital comme une entité (matérielle ou non, humaine ou non) qui est jugée comme capitale, c’est-à-dire qui est source de préoccupations. Nous proposons d’inscrire une obligation de préserver ces « entités capitales » employées par les organisations. Dans le modèle CARE, les organisations ne peuvent plus calculer leur profit et leurs performances qu’une fois que leur dette envers les capitaux naturels et humains est « remboursée ». Cela ne contrevient pas aux normes comptables existantes historiquement, cela nécessite seulement d’inscrire des passifs écologiques dans le bilan comptable. En fait, nous ne faisons qu’aligner les normes comptables sur les sciences écologiques, en nous adaptant à la réalité des impératifs d’une organisation.
Avez-vous un exemple d’une chose traditionnellement considérée comme une « ressource » mais qui, dans le modèle CARE, serait plutôt considérée comme une « entité capitale » à préserver ?
A. R. : Selon CARE, le sol, lors de sa mise en situation d’exploitation, doit être considéré comme une dette, car on emprunte un « commun écologique » non prédestiné à un simple usage humain. Ensuite, par ses usages particuliers, il est intégré dans l’activité de l’entreprise : ce qui est reconnu comme un actif, c’est l’usage fait du sol. Il faut un sol suffisamment solide pour offrir un support au passage des engins et des hommes, qui permette une exploitation. Si le sol était totalement meuble, il serait impossible d’y faire pousser ce que nous avons aujourd’hui.
Lorsqu’une organisation souhaite passer au modèle CARE, on établit d’abord que c’est l’« usage du sol », et non le sol en tant que tel, qui est un actif. Dans un deuxième temps, il faut mesurer l’impact sur le sol des usages que l’on en fait. Faire passer un engin sur un sol est une condition nécessaire pour pouvoir fabriquer du blé, mais en même temps, cela le déstructure. De là, on va se demander comment remettre le sol à l’état initial, dans un « bon état écologique » – que l’on aura déterminé au préalable avec tous les acteurs impliqués dans la vie de cet écosystème. Finalement, on chiffre les dépenses nécessaires de prévention ou de remise en état écologique des sols, qui sont intégrées dans le pilotage de l’activité globale.
CARE repose ainsi sur deux niveaux de comptabilité : des comptabilités biophysiques qui suivent la consommation du sol du fait de ses usages et une comptabilité reliant ces usages aux dépenses nécessaires de préservation, qui impactent le résultat de l’entreprise.
“Le profit ne peut être calculé qu’après avoir remboursé les apporteurs de capitaux, y compris naturels”
—Clément Feger
C. F. : Cela change profondément ce que l’on appelle le profit, qui ne peut être calculé qu’une fois que l’on a remboursé les apporteurs de capitaux, y compris les apporteurs de capitaux naturels… c’est-à-dire le sol. Comme le sol contribue à la création de valeur économique par les emplois (usages) qu’il rend possibles, les coûts de préservation doivent être déduits de la création de valeur.
Et concrètement, comment ça marche ?
A. R. : Quand on arrive dans une entreprise, on définit avec elle les capitaux extrafinanciers et leur niveau de préservation sur des bases scientifiques. C’est l’étape qui nécessite le plus d’attention, car elle nous donne l’ensemble des « entités capitales » à préserver. Ensuite, on les insère dans le modèle organisationnel de l’entreprise et on structure les actions de préservation et d’évitement – quitte à faire évoluer le modèle d’affaires si besoin. Là, on peut prendre en compte la chaîne de valeur et les investissements financiers, évaluer les coûts de préservation, et intégrer ces coûts dans les comptes. On peut alors établir le bilan, le compte de résultat et l’annexe selon CARE, et analyser les performances de l’organisation en articulant comptabilité biophysique et comptabilité intégrée finale, connectée à la comptabilité financière de l’organisation.
“Il faut entamer un dialogue avec des acteurs qui n’ont en commun que l’écosystème qu’ils partagent”
—Clément Feger
C. F. : Le souci, c’est que ni les comptabilités limitées aux périmètres des entreprises, ni les comptabilités publiques et nationales n’ont été conçues pour gérer en commun les milieux naturels. Lorsqu’on va définir les entités capitales à préserver, il faut donc entamer un dialogue avec des acteurs qui n’ont en commun que l’écosystème qu’ils partagent.
Et ce dialogue, Clément Feger, est à la base de ce que vous appelez la « comptabilité écosystème-centrée » ?
C. F. : Un bilan comptable, actuellement, rend compte de l’activité d’une organisation privée, publique ou associative dotée d’une personnalité morale. Dans le cas de la préservation d’un écosystème, il faut pouvoir installer un espace de dialogue et de négociation pour que toutes les organisations dépendantes de cet écosystème puissent instaurer une gouvernance collective, coordonnée, en s’entendant sur la définition des entités naturelles à préserver, sur le niveau de bon état écologique à maintenir ou atteindre, ou sur l’efficacité des contributions apportées… Et pour donner aux acteurs les moyens de s’organiser malgré l’hétérogénéité des contextes et des situations sur les territoires, il faut repenser la base sur laquelle ils communiquent.
“Ce travail pourrait contribuer à développer des dispositifs adaptés à la gouvernance collective des écosystèmes”
—Clément Feger
Ne suffirait-il pas de créer une personne morale pour l’écosystème ?
C. F. : C’est une solution, en effet, de créer une personne morale pour une forêt ou une rivière qui devra être protégée. Mais on peut aussi penser des formes diverses de gouvernance à l’échelle de chaque écosystème, qui intègrent des associations, des représentants de l’État, des entreprises privées et des résidents qui habitent cette rivière ou cette forêt, l’utilisent et ont un impact dessus. Il s’agit de changer de périmètre d’action et de redevabilité : plutôt que d’additionner les intérêts de différentes organisations, on raisonne directement au niveau de l’écosystème et des préoccupations écologiques.
En tout cas, il faut se poser ces questions d’organisation collective. Aujourd’hui, beaucoup de gens bien intentionnés essayent de mettre en place des formes de quantification, de mesure de la biodiversité ou de l’impact écologique. Ils ne font pas forcément le lien entre la production de données et la question de l’architecture organisationnelle et comptable nécessaire pour rendre opérationnelle la gestion des enjeux écologiques sur les territoires. Or, il va bien falloir des bases comptables autour de ces préoccupations partagées, qui sont de plus en plus sources de conflit, à la fois pour discuter des responsabilités de chacun, négocier et suivre nos engagements, et pour requalifier nos relations et nos activités. À terme, ce travail pourrait contribuer à développer et instituer des dispositifs juridiques adaptés aux problèmes de gouvernance collective des écosystèmes.
“La normalisation comptable ‘extrafinancière’ fait l’objet d’une véritable course internationale”
—Alexandre Rambaud
N’est-on pas déjà en train d’imposer des critères extrafinanciers à la comptabilité ?
A. R. : La normalisation comptable « extrafinancière » fait l’objet d’une véritable course internationale opposant notamment l’UE et un consortium anglo-saxon de droit privé, l’International Sustainability Standards Board (ISSB). Mais toute volonté d’intégrer la nature ou la société en partant du principe que ce sont des capitaux au sens économique du terme, c’est-à-dire productifs, reste une catastrophe. Derrière, on a toujours l’idée qu’on pourrait contrôler des écosystèmes avec quelques indicateurs, sans renoncer à l’idée de productivité ! Or, on peut aujourd’hui montrer par des modélisations économiques que cela ne suffira tout simplement pas : cela conduit à des appauvrissements systématiques des écosystèmes.
C. F. : Beaucoup d’acteurs de la finance et de la comptabilité dites « durables » n’abordent cette question que de manière instrumentale, pour faire des questions socioenvironnementales de nouvelles sources d’enrichissement ou de gestion des risques financiers.
Peut-on changer un système comptable en lui ajoutant des comptes successivement, en l’adaptant ?
C. F. : Il y a toujours une coévolution entre les méthodes, les techniques et les pratiques d’une part, et les concepts et les visions du monde d’autre part. Soit on prend au sérieux la question écologique, on part de l’enjeu de la préservation des écosystèmes, et on se demande comment il faut réorienter notre système économique, nos organisations, nos modes de production, et nos comptabilités pour y répondre concrètement ; soit on considère que les limites écologiques, les crises qui se multiplient, sont simplement une erreur de calcul et qu’on va pouvoir réajuster à la marge nos méthodes et pratiques existantes pour y intégrer la « question écologique ». Cette dernière option, c’est la solution de facilité, mais elle nous laissera démunis face aux défis futurs.
A. R. : Au fond, ce que nous proposons est bien plus concret que ce que proposent les tenants de la « finance verte » mainstream. Nous gardons en tête que les organisations ne sont pas des simples points errants dans notre système économique, mais constituent le socle même de toute l’économie. Donc il y a une nécessité de donner aux organisations un horizon concret, et de poser des jalons pour y arriver. Le modèle CARE comporte huit phases : on n’est pas obligé d’aller jusqu’à la huitième phase directement, on peut s’arrêter à une phase donnée, faire une pause. Mais au moins, on sait qu’il reste des étapes à franchir, on sait où on va.