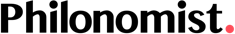Si vous n’avez jamais entendu parler du féminisme néolibéral, vous avez forcément croisé son chemin en entreprise. Peut-être parle-t-on dans votre boîte de « leadership au féminin » ou de combattre les « stéréotypes » qui empêchent les femmes de tirer profit de leur « potentiel inexploité ». Pour les tenants de cette mouvance, c’est avant tout aux femmes qu’il revient de se donner les moyens de prendre le pouvoir. Les causes des inégalités seraient individuelles et non structurelles. Pour vous apprendre à décrypter les promesses du féminisme néolibéral, Apolline Guillot et Sandrine Holin, autrice de Chères collaboratrices. Comment échapper au féminisme néolibéral (La Découverte, 2023), ont rédigé ce petit glossaire.
Féminisme néolibéral
Le terme « féminisme néolibéral » est utilisé pour la première fois en 2018 par l’universitaire américaine Catherine Rottenberg pour désigner la fusion progressive d’un certain type de féminisme centré sur les libertés individuelles, et la rationalité néolibérale. Ce féminisme affirme haut et fort qu’il subsiste encore aujourd’hui des inégalités liées au genre, en particulier dans le milieu professionnel, et qu’il revient aux femmes de se mettre davantage en avant. Les porte-parole de cette mouvance sont souvent des femmes d’affaires ou des femmes politiques des classes supérieures : la plus représentative est sûrement Sheryl Sandberg, ex-numéro deux de Facebook, autrice de En avant toutes ! (JC Lattès, 2013) livre-plaidoyer pour l’empowerment féminin dans les affaires.
“De la même manière que chaque individu est responsable de sa réussite personnelle, chaque femme est responsable de sa propre émancipation”
Si le terme est assez récent, il désigne un phénomène qui se profile depuis plusieurs décennies. Au début des années 2000, la philosophe étasunienne Nancy Fraser remarque que la montée en puissance du néolibéralisme a métamorphosé le féminisme de la deuxième vague, qui s’était construit à partir des années 1960 sur l’accès à des droits sociaux – sexualité, famille, travail. Dans un article de 2011, « Féminisme, capitalisme et ruses de l’histoire », elle montre qu’une convergence d’intérêts entre les deux mouvements, notamment autour du rêve d’émancipation des femmes, a permis au néolibéralisme de s’accaparer certaines revendications féministes et de les transformer en revendications libérales. De la même manière que chaque individu est responsable de sa réussite personnelle, chaque femme est responsable de sa propre émancipation. C’est déjà le constat que faisaient Luc Boltanski et Ève Chiapello en 1999 dans Le Nouvel Esprit du capitalisme (Gallimard) : pour continuer à se développer, le capitalisme a besoin de trouver ailleurs qu’en lui-même des principes de justification qui légitiment l’engagement de ses acteurs. Il va donc récupérer les courants critiques qui sont dirigés contre lui pour se renforcer.
Choice feminism
Le début des années 2000 voit apparaître le « postféminisme », un courant qui considère que les femmes ont conquis l’égalité de droits et qu’il n’est plus question de débattre de justice sociale ou de discrimination. Le débat se déplace alors vers la question du choix individuel des femmes. Notamment, doivent-elles faire plus d’efforts pour s’adapter à un monde du travail hostile, ou au contraire le quitter ? Sur le sujet, deux positions semblent initialement opposées : d’un côté, Anne-Marie Slaughter, qui renonce à son poste d’adjointe d’Hillary Clinton pour retrouver son poste d’université qui lui laissait plus de temps pour sa vie de famille, et signe un vibrant essai dans The Atlantic, « Why Women Still Can’t Have it All » (« Pourquoi les femmes ne peuvent toujours pas tout avoir », 2012). De l’autre, Sheryl Sandberg, qui dans son livre En avant toutes invite les femmes à cesser de s’autocensurer et à avoir de l’ambition pour faire mentir les stéréotypes à leur sujet.
“Les entreprises tentent de mettre en place des dispositifs permettant aux femmes de ne pas avoir à choisir”
Ces deux positions en apparence divergentes trouvent leurs racines dans le même courant du féminisme contemporain, le féminisme du choix ou choice feminism, qui affirme qu’être féministe, c’est avant tout disposer de sa vie comme on l’entend – que l’on souhaite faire carrière et prendre la tête du FMI ou rester à la maison pour élever ses enfants. Pour dépasser ce dilemme, les entreprises tentent de mettre en place des dispositifs permettant aux femmes de ne pas avoir à choisir.
C’est ainsi que, dans les années 2010, le féminisme néolibéral se réinvente autour du fameux « équilibre vie pro vie perso » : plus de tolérance, plus de flexibilité, moins de réunions tard, des jours de télétravail… En bref, tout est bon pour la rétention des femmes. Il faut qu’elles n’aient l’impression de renoncer à rien – si elles veulent des enfants, certaines entreprises donnent même la possibilité aux femmes de congeler leurs ovocytes. Les entreprises se donnent ainsi les moyens d’attirer des jeunes femmes diplômées qui voudraient faire autre chose de leurs jeunes années que changer des couches, sans fermer la porte à une vie de famille. Mais c’est aussi une manière de s’assurer que les femmes n’interrompent plus leur carrière n’importe quand avec une grossesse qui n’entre pas dans les plans de croissance de l’entreprise. Se battre pour concilier, voire intégrer, une vie professionnelle et une vie privée épanouissante réassigne à la lutte féministe un objectif de développement personnel, délaissant toute référence à des notions de justice sociale.
Potentiel inexploité
Il y a le wealth gap (écart de richesse), le pay gap (écart des salaires), l’opportunity gap (écart d’opportunité)… Bref : il y a un écart à combler entre les hommes et les femmes. Et très souvent, cet écart est d’abord présenté comme un écart financier qui coûterait très cher à l’économie mondiale. Il y aurait un gisement de talents, les femmes, qu’on pourrait enfin utiliser en leur donnant leur chance, à elles aussi ! Un « potentiel inexploité », en quelque sorte. Dans cette logique, la discrimination n’est pas tant une atteinte aux droits humains qu'un obstacle à une concurrence pure et parfaite entre les êtres humains sur le marché du travail – qui nuit, à terme, à la performance globale de l’économie.
“Les institutions financières récupèrent la lutte pour l’égalité en lui assignant une nouvelle finalité : le combat pour la croissance économique”
Mais il n’est pas anodin que les institutions financières produisent du discours sur les inégalités de genre. Ce faisant, elles récupèrent la lutte pour l’égalité en lui assignant une nouvelle finalité : le combat pour la croissance économique. Chaque institution y va alors de son « chiffre choc ». Pour la Banque mondiale, les inégalités hommes-femmes nous font perdre 160 000 milliards de dollars dans le monde ; selon McKinsey, « faire avancer l’égalité homme-femme peut ajouter 12 000 milliards à la croissance mondiale ». Le problème avec les chiffres choc, c’est qu’ils se présentent comme une mesure objective, rationnelle, mais qu’il est très difficile de se les représenter concrètement. Ils activent juste une zone émotionnelle de notre cerveau qui nous dit que « wow, c’est énorme », et espèrent ainsi inciter les entreprises à prendre des mesures pour gagner de l’argent.
Par ailleurs, en justifiant une mesure d’égalité par autre chose que la recherche d’égalité en soi, que se passe-t-il lorsque le raisonnement économique change, qu’on entre en récession ou que la natalité baisse ? C’est ce qui est peut-être en train de se profiler en Corée du Sud, où le coût de la vie est élevé et la pression sociale très forte. Là-bas, élever un enfant est tellement lourd que beaucoup de jeunes arrêtent de se mettre en couple, de faire des enfants, émigrent… Quel genre de réactions va susciter cette indocilité ? Ne va-t-on pas assister à un retour du bâton pour ramener les femmes à leur fonction procréatrice ?
Stéréotype
Un stéréotype était au départ un objet utilisé dans l’imprimerie pour reproduire des contenus en de nombreux exemplaires. Stereos, en grec, signifie à la fois rigide, dur, solide. Dans cet objet d’imprimerie naît le sens actuel du mot, utilisé pour la première fois par l’un des pères du néolibéralisme, Walter Lippmann, dans Public Opinion (« Opinion publique », 1922). Pour lui, le stéréotype n’est pas une mauvaise chose. Il peut être bon et utile pour le progrès démocratique et social d’orienter les foules grâce à ces représentations toutes faites. On voit déjà apparaître, de manière encore balbutiante, l’idée même de nudge : l’inertie humaine ne pourrait être combattue que par la fabrication d’autres stéréotypes.
Le féminisme néolibéral nous dit que la cause de la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes serait à rechercher dans ces biais et stéréotypes de genre. Sans interroger les causes des inégalités au-delà des stéréotypes, le discours des entreprises sur l’égalité homme-femme repose tout entier sur l’idée que nous devrions travailler sur nous-mêmes. Les femmes, pour se mettre en avant ; les hommes, pour ne plus discriminer sur la base de préjugés. La seule cause structurelle qui est avancée, c’est l’imperfection des individus (ou des cerveaux) qui ne pourraient s’empêcher de simplifier leurs décisions en employant des raccourcis cognitifs. Tels des entrepreneurs de nous-mêmes, nous pourrions améliorer notre conduite et pas-à-pas devenir plus rationnels.
“Les biais cognitifs et les stéréotypes n’expliquent pas les fondements des inégalités et ne constituent pas le seul levier disponible”
Certes, il est vrai que les biais cognitifs et les stéréotypes participent du creusement des inégalités ; mais ils n’en expliquent pas les fondements et ne constituent pas le seul levier disponible. En faisant reposer tout le travail de reconstruction sur les individus, la communication interne des entreprises peut occulter parfois toute la démarche critique qui devrait être menée, pour comprendre les racines historiques et politiques des inégalités et mieux les combattre.
Leadership au féminin
On met en avant le « leadership au féminin » comme une formule magique pour atteindre une société plus durable, « résiliente », humaine. Les femmes seraient plus tournées vers la durabilité, plus humaines, plus sages. Pour Christine Lagarde, à la tête de la Banque centrale européenne (BCE), les femmes pourraient sauver l’économie grâce à leurs qualités intrinsèques : « Une étude montre qu’elles sont particulièrement douées pour penser de façon holistique, gérer la complexité, et pour générer de la coopération, des attributs idéaux quand on parle de négociation commerciale », déclare-t-elle le 8 mars 2023 lors d’un événement de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le seul souci ? Les femmes s’autocensureraient encore trop. Pour le féminisme néolibéral, bien représenté par l’ouvrage de Sheryl Sandberg En avant toutes !, le cœur du problème des inégalités serait le manque d’ambition, de persévérance. Il faudrait apprendre à se mettre en avant pour se faire sa place au soleil. Mais ces discours ne s’adressent qu’à une certaine catégorie de femmes, qui nourrissent l’ambition de gravir les échelons, les futures leaders !
Dans les formations de leadership au féminin, la figure de la wonderwoman, la super-héroïne, la femme exceptionnelle, revient souvent. Il faudrait être non seulement une femme, mais une femme puissante. À l’heure où la productivité baisse (notamment en France), c’est une manière d’aller puiser des ressources supplémentaires chez les individus, en leur disant qu’ils sont capable de faire des miracles. Certes, c’est peut-être vrai ; mais c’est mettre énormément de pression sur les femmes ! C’est aussi invisibiliser celles qui ne sont pas des leaders. Combien de ces entreprises qui font la promotion des wonderwomen ont recours à des sociétés de nettoyage qui interviennent le soir ou le matin tôt, pour des salaires faibles et avec une logique de réduction de coûts drastique ? Qu’est-ce qui est alors le plus féministe : payer des formations d’éloquence à ses cadres sup’ prometteuses, ou revaloriser, financièrement et symboliquement, les travailleuses qui nettoient les lieux de travail, en réintégrant les services de nettoyage dans les effectifs et en les faisant travailler à des horaires normaux pour qu’elles puissent avoir une vie de famille ?
“Se focaliser sur le leadership au féminin conduit à passer sous silence le travail qu’il reste à faire du côté des hommes”
Se focaliser sur le leadership au féminin conduit à passer sous silence le travail qu’il reste à faire du côté des hommes. Trop souvent, les séminaires diversité et inclusion sont pensés pour les femmes et suivis par des femmes. Mais la parité ne pourra être atteinte sans la participation des hommes. Et si l’on veut plus de femmes à des postes de direction, il faut que des hommes leur laissent la place, quitte à imposer des quotas dans des métiers traditionnellement occupés par des femmes et peu valorisés financièrement (dans la communication, les postes de secrétariat…). Qui sait, cela aboutirait peut-être à une revalorisation salariale générale.
Individualisme
Le problème du féminisme néolibéral, c’est sa tendance à accepter et accentuer la mise en concurrence d’individus. L’égalité promise par Sandberg, c’est l’égalité d’accès au marché du travail non biaisé, sans remettre en cause l’inégalité de la répartition des richesses ou l’absurdité du système productiviste capitaliste. Ce féminisme individualiste consacre en réalité ce que les chercheuses Nancy Fraser, Cinzia Arruzza et Tithi Bhattacharya, nomment une « égalité des chances de dominer » (Féminisme pour les 99 %. Un manifeste, La Découverte, 2019).
“Être féministe n’est pas une manière de booster sa confiance en soi ou sa capacité de prendre la parole en public”
Avantager certaines femmes, c’est faire planer sur elles la menace de les renvoyer d’où elles viennent si elles ne se tiennent pas à carreau : des mères, des objets sexuels. Au contraire, il faut retrouver un sens de la lutte collective, pour réorganiser le travail et la vie de manière à remettre en cause tous les rapports de domination. Pour cela, comme l’explique l’essayiste américaine Sarah Schulman dans La Gentrification des esprits (Éd. B42, 2018), il faut que nous acceptions un certain degré d’inconfort. Notre conception du bonheur repose sur l’idée d’un confort absolu. Or, nous devons nous poser des questions qui nous mettent mal à l’aise. Ce sentiment de malaise doit être réintégré au cœur de nos vies, pas évacué d’un revers de main. Être féministe n’est pas une manière de booster sa confiance en soi, sa capacité de prendre la parole en public, mais une éthique de l’opposition pour construire un monde plus vivable pour tous. Il s’agit d’assumer de sortir du consensus et de faire front commun avec des femmes qui ne nous ressemblent pas. Ça ne veut pas dire que le féminisme ne peut pas être joyeux, au contraire. Mais il doit déstabiliser, déséquilibrer, amener à se poser des questions sur le monde dans lequel on vit. Ce n’est qu’en passant par un moment d’inconfort qu’on va ensuite réfléchir à d’autres solutions, d’autres manières de vivre, d’autres manières de faire, sans avoir peur de déranger.