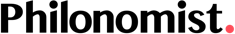Faire travailler des étrangers dont on ne désire pas l’immigration : la pratique, bien que contre-intuitive, est solidement ancrée en France et dans d’autres pays occidentaux. Le sociologue Daniel Veron, qui signe Le Travail migrant, l’autre délocalisation (La Dispute, à paraître), retrace l’histoire du travail migrant. Il rappelle que l’attractivité de la main-d’œuvre migrante repose sur un écart de droits, institutionnalisé par le recours aux travailleurs sans-papiers d’une part, et aux travailleurs détachés de l’autre. Entretien.
Propos recueillis par Athénaïs Gagey.
Dans votre livre Le Travail migrant, l’autre délocalisation (La Dispute, à paraître), vous dénoncez un utilitarisme migratoire. En quoi consiste-t-il ?
Daniel Veron : Depuis la fin du XIXe siècle, les politiques migratoires sont tiraillées entre le besoin de main-d’œuvre et le refus d’accueillir des étrangers – refus alimenté par des considérations racistes, et même, à l’époque, eugénistes. Les étrangers sont indésirables et pourtant, ils sont indispensables économiquement. Alors, comment résoudre cette contradiction ? À la fin du XIXe siècle par exemple, en Colombie-Britannique, le Canada utilise la migration chinoise, nécessaire à la construction du chemin de fer. Les dirigeants défendent que c’est une « sous-race », mais dont on ne peut se passer. D’ailleurs, sitôt le chemin de fer terminé, on commence à limiter l’immigration chinoise !
En fait, le Canada a été pionnier en matière de recours utilitariste à la main-d’oeuvre étrangère. Dans les années 1920, le pays met en place des contrats temporaires, l’équivalent des contrats dits « OMI » [Office des migrations internationales, ndlr] qu’on utilisera en France après-guerre, pour pourvoir ses besoins de travail dans l’agriculture. Après-guerre et dans les années 1960, ces programmes au départ très sectoriels s’étendent à la main-d’œuvre qualifiée… puis à la main-d’œuvre non qualifiée. Aujourd’hui, il y en a une multitude, y compris en France, même si c’est sous d’autres formes. Ces dispositifs sont emblématiques : on veut le travail, sans s’incommoder du travailleur. Ce dernier est destiné à rentrer chez lui, si bien que l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère reste compatible avec des politiques migratoires restrictives.
“L’exploitation de la force de travail migrante utilise un différentiel de prix qui découle d’un écart de droits”
À vous lire, on comprend que la main-d’œuvre étrangère est d’autant plus nécessaire qu’elle est indésirable !
Depuis qu’il y a des marchés du travail nationaux et des droits accordés aux travailleurs, les pays du Nord ont toujours eu recours à la main-d’œuvre étrangère, dont ils minorent les droits. En excluant les étrangers du régime de plein droit, on crée un différentiel de prix entre deux segments de main-d’œuvre : la force de travail étrangère devient considérablement moins chère que la force de travail domestique.
L’exploitation de la force de travail migrante, c’est donc l’utilisation d’un différentiel de prix, qui découle d’un écart de droits ! Aujourd’hui, c’est institutionnalisé par deux dispositifs : le premier, c’est l’utilisation du travail des sans-papiers. Le second, de plus en plus massif, consiste à jouer avec la concurrence des régimes sociaux entre les pays, en recourant aux contrats de détachement.
Commençons par le recours aux sans-papiers.
Pendant l’après-guerre et la reconstruction, la main-d’œuvre immigrée a été très importante en Europe et aux États-Unis. Avec la crise du choc pétrolier de 1970, on ferme les vannes à l’immigration légale. Mais dans les faits, la main-d’œuvre immigrée reste présente ; seulement, elle n’est plus légale. En France, jusqu’en 2007-2008, c’était très facile de se faire embaucher avec de faux papiers. Et puis, à partir de 2007, les vérifications se durcissent : la voie restante pour se faire embaucher, encore massive aujourd’hui, c’est le recours aux papiers d’un tiers, ce qu’on appelle l’usage d’un alias.
Beaucoup de « sans-papiers » travaillent légalement en CDI, en CDD ou en intérim. Ce qui produit des régimes de droit étonnants : comme la loi postule que les droits afférents au Code du travail s’appliquent à tout salarié, quel que soit le statut migratoire, ils ont les mêmes droits qu’un travailleur quelconque. Ils cotisent à l’ensemble des
…(sans coordonnées bancaires)
Accédez gratuitement à l'intégralité du site.
Votre entreprise vous a abonné(e) à Philonomist ?
Cliquez sur le bouton ci-dessous.