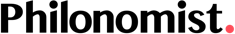Malgré tous les efforts mis en œuvre par les entreprises pour promouvoir l’égalité des genres au travail, sexisme et injustices demeurent. En cause, la persistance de biais collectifs, mais aussi des mécanismes plus complexes, comme la « paresse épistémique » ou les « biais de deuxième génération ». Éclairage avec la philosophe Manon Garcia.
Propos recueillis par Apolline Guillot.
Quand il s’agit de mettre des femmes en position de pouvoir, des blocages persistent. Pourquoi cela ?
Manon Garcia : Certes, on n’exclut plus délibérément les femmes, mais elles sont maintenues à distance, à cause de ce qu’on appelle des « biais de deuxième génération ».
C’est-à-dire ?
Déjà, l’absence de modèles féminins qui soient réellement désirables pour des jeunes femmes. Alors que j’étais étudiante, j’avais interviewé d’anciens normaliens sur leur expérience dans l’entreprise. Parmi les quelques femmes que j’avais interrogées, aucune n’avait une vie que j’enviais. L’une d’elle m’avait confié qu’en choisissant d’avoir une carrière et des enfants, elle avait tiré un trait sur sa vie de couple et sa vie sociale. Elle était attendue à un tel niveau, en tant que femme, que c’était impossible pour elle d’avoir une vie normale. Comme elle disait : « il faut faire des choix ».
Un autre exemple : les loisirs de socialisation au travail. Le squash ou le golf, tout le monde sait que c’est le genre de loisirs de gens haut placés qui réseautent. Et ce sont des loisirs très genrés. Tant qu’on ne pourra pas faire de la zumba à midi entre leaders sans que ce soit vu comme ridicule, il y aura toujours une forme de socialisation des hautes sphères qui restera inaccessible aux femmes. Sans parler des femmes qui, parce qu’elles s’occupent des enfants, ne peuvent pas s’attarder à faire des mondanités… alors que c’est là que des choses importantes se passent. On les perçoit comme moins impliquées, on les soupçonne immédiatement.
“Les normes sont ce qui rend les comportements intelligibles”
Peut-on espérer se débarrasser complètement des normes et des stéréotypes pour faire de l’entreprise un endroit où chacun pourrait se réinventer ?
Avec les discours féministes, antiracistes, non binaires, etc., vient l’espoir qu’un jour tout sera possible. Mais Heidegger l’avait déjà compris : les normes sont ce qui rend les comportements intelligibles. Par exemple, pour saluer, en France, on se serre la main ou on se fait la bise. Si vous décidez de faire un hug [accolade, ndlr] à quelqu’un pour dire bonjour, ce comportement va être immédiatement interprété. On va se dire que vous faites exprès d’être original, de montrer que vous êtes cool : on se raccroche à des signifiants pour rendre cette accolade intelligible ! Et pour ça, on a besoin de normes sociales que l’on comprend et maîtrise, afin de pouvoir ensuite prendre nos distances avec elles.
Le racisme ou le sexisme, c’est quand même autre chose que dire « bonjour » !
Mais c’est le même principe : il serait naïf de penser que le monde du travail puisse être une table rase, un lieu d’expérimentation complètement à part. Il fait partie de la société, il en hérite. Impossible de décréter que le patriarcat ou le racisme n’existent pas en open space parce qu’on y met de la bonne volonté ! Au contraire, je pense qu’il est important de prendre en compte le fait qu’on a des biais, qu’il y a des normes sociales, pour ensuite essayer de faire en sorte qu’ils ne s’appliquent pas de manière injuste.
“Nous sommes responsables de contenir les effets de nos biais”
Un exemple ?
Quand on est blanc, on s’attend à ce que les personnes de couleur, en particulier les femmes, soient déférentes, et quand elles ne le sont pas, on le prend comme une agression. À nous de veiller à ce que ces attentes stéréotypées ne débouchent pas sur des actes racistes ou injustes. Il serait utopique de croire qu’on va, un jour, se débarrasser de toutes nos normes, de tous nos biais. Nous sommes responsables, en revanche, de contenir leurs effets.
On pourrait donc imaginer une entreprise dont le patron ne serait pas activement sexiste, mais perpétuerait la domination masculine ?
Oui, bien sûr. Souvent, dans les entreprises où il y a beaucoup de femmes, on pense être protégé du sexisme. Mais les femmes sont sexistes aussi, et parfois même plus, parce qu’elles s’interrogent moins sur leur sexisme. Elles ne sont pas immunisées contre les injustices épistémiques !
Les injustices épistémiques ?
C’est le fait de systématiquement douter de la capacité d’un individu à être producteur de savoir légitime. On discrédite par exemple la parole des femmes ou de certains groupes ethniques, sous prétexte que leur parole serait trop « située ». La vérité, c’est que les membres du groupe dominant n’ont pas besoin d’avoir accès à ces connaissances produites par le groupe minoritaire ou discriminé. Ils peuvent donc se permettre de les ignorer activement : c’est ce qu’on appelle la « paresse épistémique ».
Dans mes travaux sur la sexualité [La Conversation des sexes, Flammarion, 2021] j’ai vu que les hommes disposaient en réalité de beaucoup d’informations sur le plaisir féminin, et que souvent, ils décidaient de les traiter comme non pertinentes, parce qu’ils n’y voyaient pas de réel intérêt. C’est ça, la paresse épistémique ! C’est un peu la même chose dans l’entreprise. Les gens savent que la façon dont s’organise le travail est défavorable à certaines de leurs collaboratrices, mais ils savent aussi que s’il fallait vraiment changer les choses, cela demanderait du temps et des efforts.
“Le déni est un mécanisme en partie inconscient, alors que la paresse épistémique relève de la mauvaise foi”
C’est un peu du déni, non ?
Le déni est un mécanisme en partie inconscient, alors que la paresse épistémique relève plus de la mauvaise foi. La mauvaise fois est tentante, personne n’en est à l’abri, même quand on est au courant du risque ! Dans un passage de l’introduction du Deuxième Sexe [1949], par exemple, Simone de Beauvoir écrit que les femmes qui prétendent que leur sexe n’a rien changé à leur vie, qui disent être « des hommes comme les autres », font preuve d’énormément de mauvaise foi. Mais la même Simone de Beauvoir, dans certaines interviews, affirme qu’être une femme n’a eu aucun effet sur sa vie ! Alors qu’on lit exactement le contraire dans ses Mémoires ou ses journaux.
Comment apprendre à entendre les choses qu’on n’a pas envie d’entendre ?
Souvent, cela passe par des moments où quelque chose se brise, se délie. C’est ce qui s’est passé avec #metoo : avant, beaucoup d’hommes de bonne volonté voyaient bien que les femmes étaient mal traitées. Mais le prendre en compte, cela voulait dire provoquer des conflits, perdre des contrats, etc. Et puis, plus les femmes ont pris la parole, plus le silence est devenu, de facto, de la complicité active. Là, c’est devenu pour les hommes une question de justice, et plus seulement de confort.
“Il faut créer les conditions pour que les gens parlent et soient écoutés”
Être inclusif, cela veut donc dire tolérer l’inconfort ?
Oui ! Pour être plus inclusif, il faut inévitablement réfléchir à ce qu’on a fait, et qu’on continue de faire, qui n’est pas inclusif ! Très souvent, les entreprises veulent être plus ouvertes sans payer le prix du malaise. Je suis frappée quand on me demande, avant une conférence, de ne pas mettre les hommes mal à l’aise : surtout, ils ne doivent pas se sentir coupables, il ne faut pas les faire fuir. Je ne suis pas pour l’autoflagellation, mais les choses ne changeront pas tant que les gens, hommes comme femmes, ne s’interrogeront pas sincèrement sur leurs comportements.
Qu’est-ce que cela voudrait dire, de retrouver une conversation saine sur le sujet, au travail comme ailleurs ?
Je propose de renverser le regard et la responsabilité. Au lieu de dire « ce qui importe, c’est de parler » et de faire peser la responsabilité de l’inégalité sur les femmes qui n’auraient pas su « se faire entendre », il faut créer les conditions pour que les gens parlent et soient écoutés.