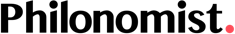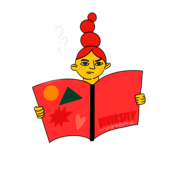Le psychologue Daniel Kahneman met au jour l’illusion de la rationalité dont se bercent les individus, mais aussi (et surtout) les marchés. Ce qui lui a valu l’équivalent du prix Nobel en économie et une grande influence auprès de Barack Obama.
Le fait est assez rare pour être noté : en 2002, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel (soit le « Nobel d’économie ») a été accordé à un homme qui avoue n’avoir jamais pris un seul cours d’économie. Si Daniel Kahneman est, avec son ami Amos Tversky, à l’origine de la nouvelle « économie comportementale » qui a significativement influencé l’administration Obama, c’est en faisant œuvre de psychologue. Il est vrai que, de psychologie, les économistes orthodoxes en ont beaucoup manqué ces dernières décennies. Ils auront en revanche imposé la fiction d’un Homo economicus guidé par ses choix rationnels et donc milité pour un monde néolibéral où prime la compétition de tous contre tous.
En ce sens, la crise actuelle du capitalisme relève surtout d’un retour de réel. Car voilà, la pensée de Daniel Kahneman est une mise en pièces méthodique, scientifique, imaginative aussi, de l’idée selon laquelle nous serions des agents rationnels : à l’évidence, l’homme est l’animal qui se prend souvent les pieds dans le tapis. La faute à un désaccordement entre les deux systèmes de pensée qui cohabitent en nous, explique Kahneman : un « Système 1 », rapide, intuitif, trop sûr de lui, et un « Système 2 », raisonnable, laborieux, mais souvent distrait.
Commençons par vos débuts. À 21 ans, vous élaboriez un test pour l’armée, en Israël…
Daniel Kahneman : Israël était une société très jeune, les experts manquaient partout, il nous fallait tout inventer. L’élaboration de ce test, d’ailleurs toujours utilisé aujourd’hui, a donné lieu à une expérience pour moi édifiante. En tant que psychologue, je devais donner une évaluation prédictive du comportement d’une recrue sur le terrain. Le protocole alors en place consistait en un entretien libre de quinze à vingt minutes avec le soldat, couvrant un large éventail de sujets, afin de se forger une impression générale de ses futures prestations. Or les retours que nous avions quelque mois plus tard contredisaient presque toujours nos avis. Je tombai alors sur les recherches du psychologue américain Paul E. Meehl [1920-2003] qui soutenait qu’une batterie de statistiques était plus efficace que tout jugement intuitif. J’ai donc imaginé un test très simple : à l’aide de questions types, il s’agissait de noter de 1 à 5 une poignée de caractéristiques indépendantes les unes des autres (dont la « sociabilité », la « responsabilité » et la « fierté masculine »). La pondération des notes me fournissait un résultat qui s’est avéré bien plus fiable. Cela marche aussi pour un recrutement professionnel : on aura bien moins de déceptions si l’on s’appuie sur une série d’évaluations des différentes compétences requises plutôt que sur un élan du type : « Je l’ai regardé au fond des yeux et ce que j’y ai vu m’a plu. »
Cette expérience est-elle à l’origine de vos recherches
sur les biais de l’intuition ?
À l’époque, j’étais surtout frappé par l’ironie de la situation : avoir des certitudes très fortes mais qui ne valaient rien. Il n’y avait aucune logique là-dedans et c’est à moi que ça arrivait directement : cela m’indignait ! Le pire est que les mauvais résultats n’entamaient guère notre confiance en nous. À cette occasion, j’ai forgé le terme d’« illusion de validité ». Mais ma focalisation sur les biais de l’intuition s’est imposée quelques années plus tard.

À quelle occasion ?
J’enseignais alors la statistique, et elle s’avérait une matière très difficile à expliquer. C’est que les statistiques sont contre-intuitives : nous ne les prenons spontanément jamais en compte. Par exemple, le phénomène de « régression à la moyenne » qui fait que, dans une série de résultats, on peut observer ponctuellement un écart extrême suivi d’un retour à des résultats de valeurs moyennes. J’expliquais un jour à des officiers qu’il était plus efficace de récompenser une amélioration que de punir une erreur. L’un d’eux me répondit que je me trompais, puisque, lorsqu’il engueulait un aviateur qui avait raté une manœuvre, celui-ci faisait mieux ensuite. Et qu’inversement, lorsqu’il félicitait une performance brillante, la suivante était moins bonne. Il voyait un lien de cause à effet qui n’existe pas : en réalité, il s’agit d’une simple fluctuation aléatoire de la performance avec régression prévisible à la moyenne. L’aviateur, après avoir commis une faute ou accompli un exploit, revenait ensuite à un résultat plus habituel. La vie nous expose donc à des informations perverses : statistiquement, elle a tendance à nous punir pour notre gentillesse et à nous récompenser pour notre méchanceté !
Venons-en donc à votre théorie principale sur laquelle s’étayent toutes vos observations : notre cerveau est régi par deux personnages conceptuels que sont le « Système 1 » et le « Système 2 ». Comment les présenteriez-vous ?
Le Système 1 régit notre intuition : il est automatique, procède par associations, cherche les relations de cause à effet et ne s’appuie que sur le particulier. Il n’a aucun atome crochu avec les statistiques ou les grands ensembles. Ce qu’il veut, ce sont des histoires, il cherche la cohérence. Or la cohérence ne dépend pas de la quantité de connaissances et de preuves qu’on a sur un sujet : nous pouvons tirer des conclusions fortes à partir de très peu. C’est ce que j’appelle “Covera” : c’est « Ce qu’On Voit Et Rien d’Autre » qui gouverne la plupart de nos impressions. Prenez par exemple « l’effet de halo » qui nous pousse à parer de toutes les qualités (intelligence, fiabilité, compétence) une personne qu’on a trouvée simplement sympathique lors d’une soirée. Dernier point : le sentiment d’aisance avec lequel le Système 1 trouve une réponse renforce sa confiance dans son jugement…
“Cela demande effort et concentration de pouvoir soutenir deux scénarios contradictoires”
Et en face, le Système 2 est paresseux…
Le Système 2 a la capacité de raisonner, de résister aux suggestions du Système 1, de ralentir les choses, de faire preuve d’analyse logique et de livrer nos illusions de validité à une autocritique. Mais il n’intervient que contraint et forcé. Lorsque notre Système 2 entre en action, nos pupilles se dilatent, notre rythme cardiaque s’accélère, notre cerveau dépense une dose de glucose. Cela demande effort et concentration de pouvoir soutenir deux scénarios contradictoires. C’est pourquoi, la plupart du temps, le Système 2 se contente de valider les scénarios d’explication qui viennent du Système 1 : il est plus facile de glisser vers la certitude que de rester campé sur le doute.
D’où, souvent, de fausses justifications à partir de faits lacunaires ?
Revenons à notre étanchéité à l’égard de la logique statistique. Une enquête sur les 3141 comtés américains nous apprend que le taux de cancer du rein le plus bas se rencontre dans des comtés ruraux, peu peuplés et situés dans des États votant traditionnellement pour les républicains. Vous réfléchissez quelques secondes, écartez le facteur républicain, vous focalisez sur la dimension rurale de ces comtés et en concluez que, en effet, un mode de vie plus sain, sans pollution ni nourritures chimiques explique que les cancers soient moindres. Mais voilà, cette même enquête révèle que les comtés où il y a le plus de cancers du rein sont ruraux, peu peuplés et situés dans des États votant traditionnellement pour les républicains ! Logique, me répondrez-vous : la pauvreté et l’accès difficile aux centres de soin expliquent pleinement ce résultat ! À chaque fois, vous avez puisé dans votre mémoire associative pour offrir l’explication la plus cohérente. Mais la vérité est que les petits échantillons enregistrent – statistiquement – des résultats extrêmes, dans un sens comme dans l’autre : ils ne sont simplement pas représentatifs.
À l’image de cet exemple, la lecture de votre livre est déstabilisante, car elle nous démontre nos erreurs en direct.
C’est vraiment la clé de notre succès : tous nos articles commençaient par une expérience auquel le lecteur pouvait lui-même se livrer et qui lui montrait directement les biais intuitifs dont il est victime. J’avais été très impressionné par la psychologie allemande du Gestalt. Les images qu’elle utilise permettaient au lecteur d’expérimenter des phénomènes d’illusion : dans un dessin, selon que vous observez la forme de deux profils qui se font face ou celle d’un vase, vous voyez deux choses différentes. C’est ce qui m’a inspiré notre manière de soumettre systématiquement le lecteur à une expérience ironique sur lui-même.

Mais nos intuitions, à défaut d’être justes, peuvent nous être utiles : sans les espoirs, certes excessifs, qui soutiennent nos entreprises, nous ne ferions rien.
Oui, c’est le « biais optimiste » qui est le moteur même du capitalisme : nous exagérons toujours les chances de succès de ce que nous entreprenons. Mais cette tendance est heureusement contrebalancée par cet autre biais cognitif qu’est « l’aversion aux pertes ». Il y a alors un jeu de balance entre ces deux tendances, qui pare à un excès de témérité ou de conservatisme : nous sommes partagés entre des prévisions courageuses et des décisions timides.
Vos travaux sur l’intuition ont été l’enjeu d’une controverse qui, de façon exceptionnelle, s’est révélée fertile.
Nos recherches sur l’intuition étaient en effet attaquées par l’école adverse menée par Gary Klein, pour qui un raisonnement intuitif tombe le plus souvent juste. Plutôt que de répondre par articles interposés, je lui ai proposé ce que j’appelle une « collaboration de confrontation » : il s’agit d’écrire avec son contradicteur un article à propos de nos divergences. Il a accepté et s’en est suivi un long échange de sept à huit ans au bout duquel nous avons pu signer un article intitulé : « Conditions d’une expertise intuitive : comment nous avons échoué à être en désaccord ». En fait, nous ne parlions pas de la même chose. Il y a une différence entre l’anticipation à court terme et les prévisions à long terme : entre un pompier qui sent, sans se l’expliquer, qu’une maison va s’effondrer dans la minute et un spécialiste du Moyen-Orient qui livre ses prédictions sur l’évolution de la région. Car une compétence intuitive ne peut se développer que s’il y a un environnement suffisamment régulier pour être prévisible et la possibilité d’apprendre ces régularités grâce à une pratique durable – il faut à peu près dix mille heures de pratique pour devenir un expert. C’est le cas pour le pompier ou l’infirmière qu’étudiait Klein et pas du tout avec les économistes et les politistes que j’étudiais. De même, un thérapeute, fort de pouvoir deviner comment son patient va réagir à ce qu’il lui dit, va s’imaginer qu’il peut aussi prédire où ce dernier en sera dans un an. Par excès de confiance, nous avons tendance à aller au-delà de notre champ de compétence.
“L’idée d’un Homo economicus est profondément liée à l’individualisme américain”
Vous racontez que le jour où vous avez découvert la description de l’Homo economicus, vous êtes tombé de votre chaise… Cette fiction d’un agent rationnel, imposée par les néolibéraux de l’École de Chicago, n’est-elle pas à l’origine de la crise actuelle du capitalisme ?
Sans doute, mais l’idée d’un Homo economicus est profondément liée à l’individualisme américain : l’individu est responsable de ses choix et doit vivre avec leurs conséquences. Et si l’on dit que « l’individu est rationnel », cela signifie qu’on n’a pas besoin de le protéger, ni de ses propres erreurs, ni de la rapacité des entreprises. Reste que toutes nos recherches montrent, au contraire, que la plupart du temps, nos décisions, prises sous l’influence du Système 1, sont entachées de nombreux biais qui les écartent manifestement de toute rationalité.
D’où le concept politique de « paternalisme libertarien » ?
Oui, ce sont Richard Thaler et le juriste Cass Sunstein qui, s’inspirant de nos travaux, ont forgé cette idée dans leur livre Nudge publié en 2008 et qui est devenu la bible de l’économie comportementale. Il s’agit de comprendre comment nous pouvons aider les gens à prendre les bonnes décisions sans pour autant empiéter sur leur liberté. D’où le paternalisme libertarien qui autorise l’État et les institutions à « pousser les gens du coude » (to nudge). Exemple simple : pourquoi 96 % des Suédois sont donneurs d’organes contre seulement 4 % de Danois ? Les premiers doivent cocher une case sur leur permis de conduire pour refuser le don, les seconds doivent la cocher pour l’accepter.
Ces conceptions n’ont-elles pas rencontré un certain succès auprès d’Obama ?
Cass Sunstein a effectivement conseillé l’administration Obama et a pu mettre en place une trentaine de mesures, dont le « Save more tomorrow » qui organise un virement automatique d’une partie du salaire sur une caisse d’assurance afin d’encourager les gens à se constituer une épargne. Mais l’économie comportementale n’est pas marquée politiquement : en Angleterre, c’est l'ex-Premier Ministre conservateur David Cameron qui a engagé Richard Thaler pour animer une cellule officieusement appelée The Nudge Unit.
“Si je suis plutôt pessimiste concernant la lucidité des individus, je suis relativement optimiste en ce qui concerne l’avenir des organisations”
Vous avez passé trente ans à étudier les logiques retorses du Système 1 et, pourtant, vous confessez que vous en êtes toujours victime. N’est-ce pas désespérant ?
La dimension automatique du Système 1 fait qu’il nous est très difficile de prendre conscience de nos erreurs. Par contre, il est tout à fait possible de repérer les failles de raisonnement chez les autres. Si je suis donc plutôt pessimiste concernant la lucidité des individus, je suis relativement optimiste en ce qui concerne l’avenir des organisations. Il s’agit d’enrichir le langage courant avec des expressions parlantes, telles que « l’effet de halo », « l’aversion aux risques », « l’illusion de validité » ou encore « l’effet de cadrage » qui pointent l’influence que la formulation même d’un problème exerce sur notre décision. Nous ne pouvons pas grand-chose contre nos propres illusions, mais nous pouvons nous doter d’un langage assez sophistiqué afin que les uns puissent mettre en lumière les biais cognitifs des autres – et inversement.