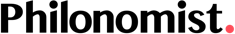Recrutement, évaluation, télétravail, intelligence artificielle, management des données… la technologie transforme le monde du travail en profondeur. Christophe Catoir, président de l’entreprise d’intérim Adecco, et la philosophe Julia de Funès analysent ces mutations et les enjeux qu’elles apportent dans un dialogue éclairant.
Cet article est extrait de l’ouvrage Le Sens de la tech, publié le 26 mai 2023 chez Philosophie magazine éditeur. Retrouvez le sommaire et l’ensemble des articles extraits de cet ouvrage sur le site de Philonomist. Pour commander le livre, c’est par ici !
S’il est un milieu dont on s’attendrait qu’il soit et reste humain, c’est bien celui des ressources humaines. Et pourtant, comme tant d’autres, les métiers du recrutement et du management se trouvent déstabilisés par les évolutions rapides de la technologie. Il y a évidemment l’essor du télétravail, qui oblige les entreprises à réinventer leur organisation, et les managers leurs méthodes. Il y a tous ces outils, analyse sémantique, algorithmes de recrutement, management des données, qui modifient déjà notre façon d’interagir avec nos collaborateurs. Et puis, il y a ces transformations en profondeur du monde du travail qui se dessinent à peine au gré des innovations technologiques, et que l’on ne peut qu’imaginer.
Pour analyser ces évolutions et en cerner les enjeux, nous avons fait appel à deux figures des ressources humaines. Christophe Catoir d’une part, président de l’entreprise Adecco, leader mondial de l’intérim, qui a évolué au sein de cette entreprise durant toute sa vie professionnelle. Julia de Funès d’autre part, philosophe qui a travaillé dans le recrutement durant une dizaine d’années, avant de se consacrer à l’analyse du monde du travail dont elle rend compte dans ses ouvrages.
Propos recueillis par Anne-Sophie Moreau et Sophie Gherardi.
Quelles technologies ont bouleversé ou vont bouleverser le monde du travail ?
Christophe Catoir : Les technologies qui modernisent le monde du travail transforment d’abord le contenu du travail et les compétences requises pour les métiers. Que ce soit dans l’industrie, dans le bâtiment et les travaux publics (BTP), dans le tertiaire, il y a désormais des automates, des interfaces digitales, de la programmation, des gestions de données qui bousculent les manières de travailler. À tel point que l’accès à certains métiers devient compliqué pour des personnes qui les ont pourtant exercés pendant des années.
Prenons trois exemples. Le premier, c’est la maintenance dans le domaine industriel. Avant, on ouvrait la machinerie pour la réparer avec un tournevis. Aujourd’hui, on est passé à la maintenance prédictive : l’usure est calculée en fonction du nombre d’utilisations ; un ordinateur détermine à quel moment le taux de rupture va être atteint et la pièce est changée même si tout fonctionne. La nature du métier a donc complètement changé. On trouve cette première brique technologique dans toutes les industries.
Mon deuxième exemple a trait au recrutement. Historiquement, la rencontre entre le recruteur et le candidat se faisait dans un bureau, une boutique ou un atelier. Pour être sélectionné, il suffisait d’une poignée de main chaleureuse et convaincue. Puis on a vu émerger des job boards, ces sites web qui amalgament l’offre et la demande d’emploi. Ils amènent à se positionner autrement, car il faut savoir comment se servir de ce mode d’intermédiation, sans recourir à la séduction dont on joue pendant l’entretien.
“Des entreprises sont managées en fonction de quelque chose qui n’existe pas encore, qui est complètement virtuel”
—Christophe Catoir
Un dernier exemple : le management des données. On voit arriver des modèles où ce n’est plus le carnet de commandes qui justifie de recruter de nouveaux collaborateurs. Il s’agit plutôt de la gestion prédictive de ce que pourrait être votre carnet de commandes demain. Et là, seul l’algorithme sait véritablement ce qu’il en est. Des entreprises sont donc managées en fonction de quelque chose qui n’existe pas encore, qui est complètement virtuel.
Julia de Funès : Le télétravail, rendu possible grâce aux innovations digitales, modifie au-delà de l’outillage les conceptions du travail, de l’entreprise, du management. C’est un bouleversement global, avec des impacts sur le temps, sur l’espace, sur les relations aux autres et à soi-même. En mêlant le travail à la vie du foyer, en faisant du travail moins un lieu qu’un temps, le télétravail désacralise le travail. La vie n’est plus simplement ce qui reste à 19 heures une fois qu’on quitte le bureau. La vie reprend le dessus sur le travail. Et c’est paradoxalement lui redonner tout son sens que de le concevoir comme un moyen, et pas comme une finalité en tant que telle, comme nous avions tendance à le faire depuis des années ! Travailler pour travailler n’a aucun sens. Si notre travail a du sens, c’est qu’il répond à autre chose que lui-même, et nous sommes en train de le replacer dans nos vies.
Le télétravail oblige également à une relation de confiance. N’ayant plus les collaborateurs sous l’œil en permanence, les managers sont contraints de faire confiance. Les managers très contrôlants ont du mal à lâcher prise, quand bien même la confiance est rentable ! Quand on fait confiance, l’autre se sent investi par la confiance reçue et veut s’en montrer digne. Bien sûr, des moments de contrôle restent nécessaires, mais le climat général de travail évolue vers davantage d’autonomie. Que ce soit dans le sens personnel qu’on accorde à son travail, ou dans ses relations managériales, cette manière de travailler bouscule les anciens paradigmes.
Que devient le recrutement au temps des algorithmes ?
C. C. : Après vingt-sept ans dans le recrutement, je constate qu’on a remplacé une rencontre physique par un modèle assez rugueux : si vous correspondez à suffisamment de mots-clefs, votre employabilité augmente ; si vous ne les avez pas, elle diminue. Cela donne un monde très aseptisé, à un moment où l’on parle beaucoup de diversité. Les promesses de communication et les modalités de recrutement ne convergent pas, et les décideurs dans les entreprises n’en sont pas forcément conscients. Si vous vous contentez de collecter un CV supposé résumer une vie, une carrière, vous n’y retrouvez pas ce qui, de l’avis même des entreprises, fait le succès ou l’insuccès dans une fonction.
La technologie des data, pour le coup, peut être utile pour comprendre la personne à partir d’un spectre beaucoup plus large que le CV, permettant de rouvrir sur la diversité. Il y a quand même de l’espérance, à condition d’utiliser la technologie comme un support et non une finalité. Si j’avais un seul rêve dans mon entreprise, ce serait d’être capable de détecter tout le potentiel de chaque candidat. Je suis sans doute plus équipé pour le faire avec la technologie qu’avec des modèles d’entreprise fondés sur la productivité, surtout quand on sait comment fonctionnent l’orientation professionnelle et l’éducation initiale. Je vois quand même derrière tout cela une promesse !
J. F. : Je suis tout à fait d’accord avec votre promesse. À nous de faire des nouvelles technologies, non pas des puissances autonomes qui rivaliseraient avec nos intelligences, mais des moyens de se délester – autant que faire se peut – du purement procédural, pour privilégier ce que nous avons en nous, pour l’heure, de spécifiquement humain, à savoir les émotions, l’intelligence d’action, l’intuition, et tout ce qui ne relève pas du rationnel mais du « sensible ».
“Souvent, le recruteur s’apparente à une intelligence artificielle, bas de gamme, sans la puissance algorithmique”
—Julia de Funès
Si je prends l’exemple du recrutement, dans lequel j’ai travaillé une dizaine d’années, certains éminents recruteurs se vantaient parfois d’une disposition au flair, à l’intuition, à l’inspiration alchimique mais, très souvent, ils l’occultaient par peur du risque, en laissant place à des critères objectifs, rationnels, « pavloviens », comme les mots-clefs, les bonnes écoles, les expériences similaires… Le recrutement qui se voulait un art, un savoir-faire, se réduisait en somme à une mécanique bien huilée. La décision n’était qu’une réplication, la sélection du clonage de candidats. Finalement, le recruteur s’apparentait à une IA bas de gamme, puisque nous ne pouvions avoir sa puissance algorithmique. Grâce à l’IA, peut-être parviendrons-nous enfin à moins artificialiser nos intelligences !
On accuse l’IA de favoriser des biais misogynes, racistes, etc. Comment l’utiliser tout en répondant à l’exigence de diversité ?
C. C. : Construire des algorithmes censés être intelligents et les appliquer avec une confiance aveugle, c’est un drame. J’ai vu des entreprises dire, en partant d’une bonne intention : « Je fais passer le même test à tous les candidats que je reçois en entretien et à tous les collaborateurs de l’entreprise. Je vois ensuite leur performance individuelle et je peux déterminer quel est le profil type qui réussit. » En tant que DRH, c’est la promesse d’avoir la guerre des clones ! Si votre ambition est celle-là, l’IA est un bon ami car elle va reproduire votre souhait jusqu’à la caricature.
Le problème est double. D’une part, cela crée un modèle d’exclusion inacceptable sur le plan éthique, qui ne fait pas partie de la nature humaine et ne doit pas exister dans notre conception du travail. D’autre part, c’est un modèle dont vous n’êtes plus le maître. L’algorithme, c’est du machine learning : petit à petit il apprend, il retient, et à la fin la complexité est telle qu’on ne sait plus ce qui a amené à choisir certains candidats plutôt que d’autres. Et cela se retourne contre vous. Si l’IA aboutit à dupliquer des clones, autant avoir des robots et renoncer à la diversité qu’on pourrait trouver chez des collaborateurs. L’IA centrée sur un tel système n’a pas de sens. A contrario, si elle est fondée sur un modèle d’éducation, elle peut avoir du sens. Par exemple, on peut, à travers des rédactions de texte, repérer où sont les points forts et où sont les faiblesses, détecter certains critères qui vous rendent rétif à l’écriture et très ouvert à la lecture… Il faut s’adapter à l’individu, et l’IA peut nous y aider.
“Compter sur une technologie comme l’analyse sémantique pour comprendre un collaborateur me semble extrêmement risqué”
—Christophe Catoir
Après le recrutement, il y a la suite de la carrière. Peut-on remplacer l’entretien individuel par de l’analyse sémantique pour juger le travail d’un individu ?
C. C. : Compter entièrement sur une technologie comme l’analyse sémantique pour comprendre un collaborateur ou évaluer le management me semble là aussi extrêmement risqué. Il existe des modalités de coaching digital, mais à la fin, il faut un vrai coach qui va définir et suivre de vrais objectifs. D’ailleurs, pour que le collaborateur s’approprie ce mode de coaching, il faut qu’il ait l’impression d’avoir été compris. Il faut de l’incarnation pour susciter la confiance. Je ne suis guère optimiste sur le rôle managérial de la technologie. Elle peut aider, apporter un support pour l’évaluation. Mais il faut avoir une discussion autour des indices qu’on utilise. Pour moi, la décision doit appartenir à quelqu’un qui essaie de construire un tout homogène avec les collaborateurs. Dieu sait que c’est difficile.
J. F. : Quant à moi, vous savez que même le vrai coach ne me rassure pas, bien au contraire ! Trop souvent, les hordes de coachs en toc noient les singularités dans des kits comportementaux éprouvés, des méthodes convenues, des classifications de couleur et autres babioles qui réduisent l’individu à un schéma type et le moi à un exemplaire, jusqu’à le chloroformer dans des postures convenues. Dans votre réponse, vous êtes discrètement passé du coaching digital au coach puis au manager, et en effet je crois que votre glissement est révélateur. Seul le manager qui vit la mission en saisit les enjeux, construit, comme vous dites, un tout homogène avec une équipe, et peut se permettre de « juger » le travail personnel effectué.
Enfin, les outils d’IA sont formidables pour analyser, comparer, diagnostiquer ; moins pour saisir la part irrationnelle inhérente à chaque humain. Si je reprends votre exemple de la pédagogie : un même élève peut rencontrer des difficultés avec tel professeur, et devenir excellent avec tel autre. Un élève peut adorer une matière avec untel et la détester avec un autre professeur. Tout cela ne relève évidemment pas de la logique algorithmique.

Christophe Catoir © Laurent Villeret pour Philonomist
C. C. : Notre culture est très émotionnelle : les personnes réagissent plus avec le cœur et les tripes qu’avec la tête. Quand vous avez la capacité de parler au cœur des gens sans manipulation, ils le sentent tout de suite. Et si vous êtes fake, ça se sent aussi. Dans le secteur industriel, on trouve des cultures fondées davantage sur le rationnel, facts and figures, comme disent les Anglais. Mais d’autres leviers sont efficaces. On ne peut pas tout modéliser, et il ne faut surtout pas le vouloir. Ce qui fait la différence, c’est aussi le plaisir au travail, c’est d’y trouver un environnement propice à sa personnalité, à son mode d’épanouissement. Est-ce que la technologie peut sonder ça ? Je ne suis pas certain que ce soit son rôle.
J. F. : On n’a malheureusement pas attendu l’IA pour « penser » en termes de modélisation rationnelle. Je n’ai jamais apprécié les tests de personnalité purement quantitatifs ou les tests de couleur débilitants : vous êtes rouge donc vous êtes courageux, vous êtes bleu donc vous êtes généreux… affligeant ! Toutes ces modélisations classifient, ordonnent, englobent, résument, sans rien comprendre d’une complexité humaine. Prenons l’exemple du charisme. Le charisme est une question de style, d’authenticité, de personnalité, et de courage d’être soi-même. Ça ne se modélise pas, ça ne se chiffre pas, ça ne se colorie pas ! Il dépend de conditions existentielles autrement plus complexes et bien souvent irréductibles aux diagrammes, graphiques, courbes, camemberts, ensembles et sous-ensembles classificateurs !
Ces techniques employées se croient personnalisantes mais sont au fond dépersonnalisantes et impersonnelles par leur uniformisation, leur homogénéisation, leur généralisation. Elles s’adressent au « moi » de chacun comme à des millions d’autres. Elles schématisent l’humain, qui ne peut l’être entièrement.
“Le distanciel redonne de la vigueur, de l’intérêt et de l’efficacité aux moments collectifs”
—Julia de Funès
Le télétravail rend-il les relations interpersonnelles plus difficiles ?
J. F. : Contrairement à l’idée, devenue poncif, selon laquelle le télétravail entame le collectif, je pense au contraire qu’il le renforce. Il est trop facile de faire du télétravail l’alibi d’une difficulté organisationnelle. Le télétravail rend certes plus difficile l’organisation de moments collectifs, mais ne les empêche en rien. Premièrement, en France, peu télétravaillent cinq jours sur cinq. Les moments de présence demeurent. Deuxièmement, le présentiel n’a jamais garanti un collectif fort : en open space, les gens peuvent être à 1,5 m de distance et préférer s’envoyer un mail pour ne pas déranger l’ensemble du plateau, ce qui revient à faire du télétravail en présentiel ! Troisièmement, virtualiser et distancer les relations les rendent d’autant plus attendues, désirées et désirables. C’est vrai en amitié, en amour, et au travail. Quand on est en présence continuelle les uns avec les autres, une certaine usure ou lassitude peut se faire sentir. Le fait d’être privé de l’autre attise le désir des retrouvailles. Vous avez remarqué comme moi le plaisir qu’avaient les gens de se retrouver après avoir été confinés. Eh bien, quand on sait qu’on ne peut voir son collaborateur qu’une ou deux fois par semaine, les réunions sont généralement plus efficacement menées. En ce sens, le distanciel redonne de la vigueur, de l’intérêt et de l’efficacité aux moments collectifs.
C. C. : Aujourd’hui, il faut prêter attention aux gens, qui deviennent une ressource rare ! La complexité pour les entreprises est de réussir à s’organiser pour contenter chacun des collaborateurs, tout en atteignant un objectif collectif. Avant, les partenaires sociaux discutaient pour savoir si on allait avoir une journée ou une demi-journée en télétravail. La crise a résolu le problème : ils ont eu cinq jours sur cinq ! Mais l’extrême n’est jamais satisfaisant. Certaines entreprises ont voulu mettre tout le monde en télétravail tout le temps, en y voyant les nouvelles modalités de l’emploi et peut-être pour se rendre populaires. C’est une illusion. On a besoin des autres, de se voir, de se toucher pour que l’énergie circule.
A contrario, ce serait une erreur de vouloir en revenir à négocier la journée ou la demi-journée de télétravail. Certains ont compris qu’aller au bureau tous les jours à heures fixes et rencontrer les mêmes personnes n’étaient pas un plaisir pour eux. Et comme l’entreprise a besoin de gens motivés et engagés pour réussir, il faut répondre aux modalités de chacun. En ayant quand même une mission collective : faire travailler un nouvel arrivant à distance n’est pas une bonne idée, par exemple, car il a besoin de voir comment s’exprime le métier, d’être embarqué par des gens et non par une interface digitale. C’est très différent pour quelqu’un qui a l’expérience du métier.
J. F. : La raison d’être du télétravail est la flexibilité. Il serait donc paradoxal, sinon insensé, d’en faire un carcan procédural ! Le télétravail présente selon moi, au-delà des avantages connus (temps de transport gagné, etc.), un avantage majeur : une libération psychologique. Depuis des années, les entreprises sont des blocs de verre, tout est transparent – on est donc visible en permanence. Or, il suffit de se savoir visible pour agir comme si nous étions vus. Ce qui explique une grande part de comédie humaine, de théâtralité qui se joue encore dans les entreprises – le présentiel pour le présentiel, etc. Le télétravail atténue cette part de jeu, en privilégiant une culture du résultat. Il agit comme un tamis : peu importe mon look, le lieu et mes horaires, ce qui va compter, c’est le résultat de mon travail. En ce sens, il libère et rend plus authentiques et professionnelles les relations de travail. Le télétravail a néanmoins des inconvénients, comme l’amplification des inégalités sociales et la difficile conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.
Est-ce que le télétravail favorise une prise de distance et donc une certaine infidélité vis-à-vis de l’employeur ? On entend beaucoup que les jeunes préfèrent être freelance, et que les salariés sont de moins en moins fidèles à l’entreprise…
C. C. : Je ne dirais pas qu’il y a plus d’infidélité qu’avant, ou que c’en est fini des carrières longues. Il y a certes une frange de la population qui, quand elle est infidèle, l’est plusieurs fois, et la rotation peut être extrêmement forte. Mais il y a toute une partie de la population qui demeure très fidèle, et s’épanouit en faisant de vrais choix. J’ai moi-même commencé comme stagiaire chez Adecco. De nombreuses raisons auraient pu justifier mon départ ; or finalement je suis resté car l’environnement s’est avéré propice, parce qu’il y avait un contrat « gagnant-gagnant », et je parle là de contrat moral. Je dirais qu’il y a aujourd’hui une relation moins normative au travail, c’est-à-dire qu’on accepte moins facilement d’être sous la contrainte d’un modèle taylorien où l’on fait le même geste toute sa vie.
“Aujourd’hui, la fidélité pour la fidélité ne fait plus sens ! Ce n’est plus une finalité.”
—Julia de Funès
J. F. : Si, comme vous le dites, la fidélité demeure, je crois néanmoins qu’elle a changé de motivation. Il y a quelques années encore, la fidélité était sacralisée en tant que telle : faire une longue carrière dans une même entreprise était un gage de sérieux, de constance, d’intégrité. Aujourd’hui, la fidélité pour la fidélité ne fait plus sens ! La fidélité n’est plus une finalité. Si fidélité à l’entreprise il y a – et c’est de plus en plus rare –, c’est qu’elle est un moyen d’épanouissement personnel et que l’individu y trouve son compte. Toutes les sphères de nos sociétés sont touchées par un mouvement d’individualisation : en politique, on vote en fonction de son intérêt personnel ; sur le plan vestimentaire, on s’habille moins pour les autres que pour son confort personnel ; en médecine, on s’automédicamente davantage ; et au travail, on choisit sa carrière en fonction d’un équilibre vie professionnelle-vie personnelle. Pour attirer – sinon retenir – les collaborateurs, privilégier l’individuel me semble le meilleur moyen. Ce qui crée un nouvel enjeu : comment avoir une ambition collective quand le sens s’individualise ?
On accuse souvent la technologie de détruire l’emploi. Est-ce le cas ?
J. F. : Je ne crois pas qu’il faille revenir sur une technologie dans le but d’abolir les difficultés qu’elle fait naître, mais plutôt miser sur les innovations pour pallier ses inconvénients. On dit souvent que le télétravail amplifie les inégalités sociales. Ce qui est vrai. Mais ce n’est pas en revenant sur l’existence du télétravail qu’on atténuera les inégalités sociales enkystées de manière structurelle dans notre pays. C’est en innovant, en créant de plus en plus de tiers-lieux par exemple, ou en développant les accès aux outils numériques que l’on parviendra à en affronter les enjeux. L’innovation capitalistique ne se fait pas forcément au détriment du social, mais dans notre pays binarisé par la droite et la gauche, on a du mal à les penser compatibles. Or, cela me semble être une exigence pour ne pas tomber dans du capitalisme insensé ou du social impuissant.
C. C. : Quand je suis entré dans mon industrie, à 25 ans, je visitais les entreprises et je voyais des gens qui faisaient des tâches difficiles mais dont ils étaient fiers, parce qu’elles étaient le fruit d’un héritage, parfois d’une tradition ancestrale. Chez un verrier qui travaillait pour les champagnes, le job le plus important consistait à graisser les moules avec du verre en fusion : c’était très risqué, on pouvait y perdre son bras. Ces gens parlaient de leur métier avec un éclat dans les yeux, car c’étaient des communautés de père en fils, avec une noblesse et des gestes sains. Aujourd’hui, on n’a plus besoin d’eux : une machine met le verre, une autre met la graisse et ça marche très bien. Or, ça ouvre la possibilité de créer de la valeur ailleurs. On se demande souvent : « Est-ce que la technologie tue l’emploi ? » Pas nécessairement. La question est plutôt : « Où est-ce qu’on va mettre le temps disponible ? » Une véritable révolution s’est opérée dans le monde des services. Avant, vous n’imaginiez pas que quelqu’un puisse vous livrer un paquet de piles chez vous à une heure donnée avec un ticket moyen à 4 euros.

Julia de Funès © Laurent Villeret pour Philonomist
Mais est-ce vraiment un progrès ?
C. C. : C’est un énorme progrès pour le consommateur. Par exemple, nombreux sont ceux qui critiquent Amazon, mais les trois quarts des individus en sont clients ! Cela dit, il y a des modalités d’exercice de ces métiers. En France, on considère pour l’instant que puisqu’il y a des plateformes, des gens pour exercer ces jobs et que le système crée de l’emploi, il faudrait le préserver sous couvert de précautions en vertu du droit du travail. Dans d’autres pays, tels que les Pays-Bas ou l’Espagne, le législateur est allé plus loin, estimant qu’il fallait plus encore encadrer un système porteur de précarité et revenir à un modèle de salariat au lieu de ce travail dit « au rabais ». Ce qui amène certaines entreprises à quitter ces pays et donc à ne plus apporter le service voulu par les consommateurs. C’est un débat philosophique sur la relation au travail, et aussi un débat de société. Un étudiant choisit de travailler pour une plateforme – il ne cotise pas pour sa retraite mais c’est le cadet de ses soucis au départ. Est-ce irresponsable de la part de son employeur ? De la sienne ?
J. F. : On entrevoit généralement les nouvelles technologies et les entreprises américaines comme des menaces pour les petites entreprises françaises. Mais quel libraire de quartier, quel artisan, et quel petit commerce aujourd’hui n’a pas envie d’être sur Amazon, par exemple ? Beaucoup me disent à quel point Amazon les a sauvés ! Si on oppose ces deux mondes, c’est qu’on rumine encore dans l’idéologie droite-gauche dont est si friand notre pays.
Il en est de même avec l’écologie. Penser l’écologie en opposition à l’économie mène directement à la décroissance ! Relier les deux en ayant en tête que l’économie sans l’écologie est discutable, mais que l’écologie sans économie est impuissante, me paraît moins dogmatique, plus pragmatique et plus prometteur. Notre pays aurait pour une fois à gagner à s’américaniser sur ce point, en valorisant la réussite, le progrès, la création, et en cessant de faire systématiquement du capitalisme un tabou et l’origine de tous nos maux. Encore une fois, on peut penser ensemble progrès social, souci écologique et innovations technologiques. Encore faut-il sortir des dogmes politiciens.
“Comprendre le pourquoi d’une technologie, voir les bénéfices qu’elle apporte, c’est ce qui donne envie de se l’approprier très rapidement”
—Christophe Catoir
Comment l’employeur peut-il accompagner les collaborateurs dans ce qu’on appelle la transformation numérique, qui force les organisations à adapter les postes et les tâches à un nouvel environnement ?
C. C. : On a tendance à trop se concentrer sur le « comment ». Comment s’approprier cette nouvelle technologie ? Comment s’organiser d’une nouvelle manière au travail ? On oublie le « pourquoi », qui donne la motivation à apprendre par soi-même. Comprendre le pourquoi d’une technologie, voir les bénéfices qu’elle apporte, c’est ce qui donne envie de se l’approprier très rapidement car on en voit la finalité. Le rôle du management, c’est toujours de répéter « pourquoi » on fait ci ou ça. Et d’en venir à la technologie ou à de nouveaux modes d’organisation comme étant juste des moyens d’y arriver de manière plus efficace, avec davantage de valeur et d’engagement.
Un autre élément, c’est qu’on a eu tendance, ces dernières années, à vouloir formater pour tout rendre plus prédictible. Mais, chaque individu étant différent, quel cadre donner pour parvenir à l’objectif collectif ? Le challenge est de réussir à avoir une convergence d’action, mais aussi de permettre à chacun de s’exprimer en fonction de son degré de maturité, de son degré d’expertise, de sa dépendance à d’autres fonctions puisque les interdépendances en entreprise se sont accentuées.
Dans de nombreux métiers, surtout dans les activités de service, vous recrutez quelqu’un parce qu’il a les yeux qui brillent. Vous avez envie de travailler avec lui parce qu’il est convaincu, parce qu’il est motivant. Par contre, il faut qu’il y ait de la cohérence. On dit que les métiers de la santé ont du sens, mais si ensuite les gens passent leur journée à faire de la bureaucratie et à remplir des dossiers, ils vont exécrer ce qu’ils font. Le pire, c’est de survendre un métier qui se révèle décevant. Après l’espoir vient l’insatisfaction, et votre jauge d’énergie baisse de jour en jour.
J. F. : Ce qui permet de valoriser l’individu, c’est de le rendre actif, autonome, qu’il se sente acteur, auteur de sa vie professionnelle, et pas simplement un bon petit soldat qui exécute. Or, très souvent, on s’agite plus qu’on agit en entreprise. Pour se sentir actif, encore faut-il avoir la capacité de prendre des risques, de pouvoir répondre à la question du sens de ce qu’on fait, et d’évoluer dans un climat de confiance pour passer à l’action. Si certains s’inquiètent de l’IA qui rivalise avec l’intelligence humaine, je m’inquiète davantage de l’intelligence humaine qui s’artificialise très vite dès lors qu’elle ne peut répondre à ces trois conditions.
Prenons un exemple. Pendant cinq ans, j’allais deux fois par mois dans la même entreprise où le process d’accueil consistait à donner sa carte d’identité en échange du traditionnel badge à cordon fluo. Un jour, j’oublie ma carte d’identité. J’ose demander à l’agent d’accueil qui me connaît, puisque cela fait un certain nombre de fois que je me présente, si je peux malgré mon oubli avoir le badge. La sentence irrévocable tombe : « La procédure, c’est la procédure ! » C’est une faute managériale majeure que d’embaucher aujourd’hui des gens pour leur faire dire : « Ce n’est pas le process. » Une IA est capable de m’identifier grâce à la reconnaissance faciale et de tout savoir sur ma présence en entreprise. L’homme est donc réduit à moins qu’une machine.
En somme, faire des collaborateurs des sujets, des personnes, des autonomies, et pas simplement des applicateurs de process, me semble l’enjeu central pour motiver, responsabiliser et humaniser les relations. C’est valorisant pour l’individu, mais c’est rentable pour l’entreprise, car rien n’est plus efficace, stimulant et motivant que de se sentir actif. Montaigne le dit expressément : « Nous sommes nés pour agir. »