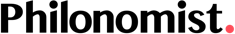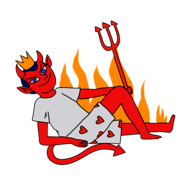Les voitures autonomes, ChatGPT, les métavers : depuis quelques années, les innovations technologiques majeures semblent se démultiplier. Difficile d’imaginer à quoi ressemblera la société de demain, mais une chose est sûre : elle sera profondément informée par le développement technologique. Comment la technologie change-t-elle nos vies, et plus généralement, notre espèce ? Pascal Picq, paléoanthropologue, et Olivier Girard, président d’Accenture France et Benelux, en discutent.
Cet article est extrait de l’ouvrage Le Sens de la tech, publié le 26 mai 2023 chez Philosophie magazine éditeur. Retrouvez le sommaire et l’ensemble des articles extraits de cet ouvrage sur le site de Philonomist. Pour commander le livre, c’est par ici !
Que nous nous en rendions compte ou non, le progrès technologique bouleverse nos vies. Et ce, depuis toujours : la maîtrise du feu, le développement de l’agriculture, le moteur à explosion et l’invention d’Internet ont permis à la vie humaine de se réorganiser autour de ces technologies. Aujourd’hui, la généralisation du télétravail transforme déjà notre société et nos modes de vie. L’IA et les métavers, qui n’en sont qu’à leurs débuts, promettent des bouleversements plus grands encore.
Pour discuter de l’impact des technologies dans nos vies, nous avons fait se rencontrer deux personnalités aux regards complémentaires : Pascal Picq, paléoanthropologue de renom, qui étudie la façon dont l’être humain a évolué depuis ses débuts jusqu’à notre époque numérique, et Olivier Girard, président d’Accenture France et Benelux, qui accompagne les entreprises et institutions françaises dans leurs transformations, et dont l’expertise technologique est largement reconnue. Ensemble, ils esquissent ce que Pascal Picq décrit comme une véritable « révolution anthropologique », guidée par les dernières innovations dans le domaine des machines intelligentes et des technologies du numérique.
Propos recueillis par Anne-Sophie Moreau.
Comment les technologies bouleversent-elles nos vies ?
Olivier Girard : Pour analyser l’impact des technologies et de la révolution scientifique sur l’humanité, je m’intéresse à trois périodes de l’histoire : l’arrivée de l’agriculture, la révolution industrielle et l’époque actuelle. Chacune de ces révolutions a bouleversé notre rapport au temps et à l’espace et, partant, notre rapport à soi et au monde. Avec la révolution agricole, nous avons cessé de nous déplacer au fil des saisons. La révolution industrielle est le temps de l’accélération : c’est là qu’on a inventé le mot « productivité », qui implique de penser l’efficacité en fonction d’un rapport au temps. Aujourd’hui, les technologies nous poussent à considérer la dimension du temps réel, de l’instantanéité, avec la complexité que cela implique. Il en va de même avec notre rapport à l’espace : la révolution agricole a accéléré la sédentarisation ; la révolution industrielle a permis l’essor de la ville. Nous sommes désormais entrés dans un cadre multidimensionnel, avec un continuum entre monde physique et espace virtuel qui s’hybrident de plus en plus naturellement.
Pascal Picq : La caractéristique de la vie humaine, soit le genre homo, qui apparaît en Afrique il y a deux millions d’années, c’est de pouvoir s’adapter à la fois sous les contraintes du milieu – comme les autres espèces – et, aussi, en inventant de nouveaux modes de production et de vie. Ses capacités morphologiques, physiologiques et cognitives sont très plastiques. Il est aussi capable de transformer le monde par la technique. Or, non seulement les outils et les machines améliorent les compétences fondamentales des humains (en termes de rapidité, de précision, d’efficacité, etc.), mais ils transforment aussi notre biologie. Nous autres boomers avons gagné vingt-cinq ans d’espérance de vie sans changer notre patrimoine génétique, et ce grâce à la médecine, la culture, l’éducation, les avancées sociales, etc.
La lignée humaine se caractérise par ce que j’appelle « la deuxième coévolution » ou « coévolution bioculturelle ». Chaque grande innovation technologique, ce que les Anglo-Saxons appellent « a general purpose technology », produit des « révolutions » qui affectent tous les aspects de nos vies. Le feu il y a deux millions d’années, les agricultures il y a dix mille ans, la machine à vapeur il y a deux cent cinquante ans, l’électricité et le moteur à explosion il y a cent cinquante ans, la chimie de synthèse et l’informatique il y a soixante ans, et aujourd’hui le numérique, ont eu, ont et auront des conséquences sur les moyens de production et le travail, mais aussi des conséquences démographiques, sociétales, politiques et philosophiques.
Ces changements ne proposent pas une amélioration globale, mais un nouveau compromis où les avantages prévalent sur les inconvénients. Joseph Schumpeter parle de destruction créatrice : toute adaptation a un coût négatif pour une partie de la population. C’est ce qu’on constate partout depuis plus d’une décennie, surtout dans les pays riches. Et notre cerveau tend à voir les inconvénients immédiats plutôt que les avantages escomptés…
Comment apparaît une technologie de rupture ?
P. P. : On explique volontiers l’apparition des technologies par le solutionnisme : on croit qu’elles ont été inventées pour résoudre des problèmes. Nos ancêtres auraient par exemple inventé la cuisson parce qu’ils en avaient assez de manger cru… Mais ce n’est pas arrivé ainsi. Il y a une double articulation entre l’apparition d’inventions – qui peuvent être intentionnelles, dédiées à un problème ou un projet (le solutionnisme) ou attribuées à des processus (comme la sérendipité ou les exaptations) – et, dans un deuxième temps, leur sélection puis leur développement dans la société.
“La grande erreur de l’Occident après la chute du mur de Berlin a été de persister à croire que l’humanité se cale sur ses inventions et que notre modèle deviendrait universel”
—Pascal Picq
O. G. : On ne trouve l’usage véritable d’une invention que dans un deuxième temps. Une ampoule électrique a l’apparence d’une bougie améliorée – mais ce n’en est pas une ! Ce n’est que plus tard que l’électricité trouve une diversité croissante d’applications. De même avec l’ordinateur, qu’on a d’abord vu comme une puissance de calcul avant de développer des usages nouveaux. Ou le smartphone, qui embrasse désormais toutes nos activités.
P. P. : Un des autres aspects, c’est que les grandes innovations n’apparaissent jamais toutes seules, mais de manière indépendante et sous des profils divers dans différentes parties du monde. À l’époque où j’étais étudiant, on parlait de la théorie du « diffusionnisme » : on croyait que l’Occident était le foyer de toutes les inventions et qu’elles se diffusaient ensuite ailleurs. Or, ce n’est pas le cas. Les agricultures apparaissent dans au moins huit foyers différents entre huit mille et trois mille ans avant J.-C. Plus récemment, dans le millénaire qui précède notre ère (ce qu’on appelle l’« âge axial »), émergent les grands systèmes philosophiques et religieux. Aujourd’hui, on assiste à un phénomène similaire avec la révolution numérique : les Américains ne font pas comme les Européens, qui ne font pas comme les Chinois, etc. La grande erreur de l’Occident après la chute du mur de Berlin a été de persister à croire que l’humanité se cale sur ses inventions et que notre modèle deviendrait universel. L’illusion d’une mondialisation heureuse !
Le développement technologique entraîne-t-il forcément un progrès politique, allant vers plus de démocratie ?
O. G. : Dans la préface de De la démocratie en Amérique [1835], Tocqueville explique comment la démocratie s’impose inéluctablement, aidée entre autres par le progrès scientifique. Il montre par exemple comment l’évolution scientifique dans l’armée a contribué à faire reculer ce qui était considéré comme un privilège : avant, seul un noble pouvait se battre car il fallait avoir appris à se servir des armes. Le progrès technique a permis à d’autres gens d’entrer dans l’armée. Les progrès technologiques contribuent ainsi au « développement graduel de l’égalité », pour reprendre les mots de Tocqueville. Le rôle de la technologie dans la diffusion du savoir est une autre évidence avec l’imprimerie et l’avènement d’Internet.
P. P. : Il faut avoir conscience des contraintes historiques, culturelles et anthropologiques. On touche ici à la question de la liberté et des aptitudes à s’améliorer de l’être humain. Après l’entrée de la Chine à l’OMC, les prospectivistes se sont réjouis à l’idée d’une émergence de classes moyennes comme dans les pays occidentaux après la Seconde Guerre mondiale. Où sont ces classes moyennes des BRICS [Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud] ? Il n’y a jamais eu autant de bipolarité entre les très riches et les plus modestes dans ces pays. Quant aux démocraties, c’est le grand recul.
“Il serait très présomptueux de considérer que plus de technologie entraîne forcément plus de démocratie”
—Olivier Girard
O. G. : On n’a pas toujours cru à la mondialisation heureuse. Après Fukuyama qui annonçait la « fin de l’histoire » et le triomphe de la démocratie, Samuel Huntington a publié Le Choc des civilisations [1996], qui défendait un point de vue hélas plus lucide…
Pour en revenir à la technologie, je pense qu’il serait très présomptueux de considérer que plus de technologie entraîne forcément plus de démocratie. La technologie est un outil, un vecteur. La question reste : « Que voulons-nous et pouvons-nous en faire ? » Les révoltes du Printemps arabe nous ont montré qu’elle pouvait faciliter la contestation, en dévoilant ce que certains pouvoirs souhaitaient cacher, et accélérer les mobilisations. À l’inverse, on constate que la technologie est aussi utilisée comme outil de contrôle, en particulier par des régimes autoritaires. Une sorte de panoptique parfait, tel que l’imaginait Jeremy Bentham au XVIIIe siècle, en version numérique et à l’échelle de toute la société. Il nous faut accepter cette contradiction apparente. Pour la démocratie, rien n’est acquis, mais le meilleur est toujours possible.

Olivier Girard © Marie Genel pour Philonomist
L’humanité a toujours connu l’innovation technique : en quoi l’époque actuelle serait-elle si particulière ? Sommes-nous en train de vivre une ère de rupture profonde ?
P. P. : Il y a deux changements majeurs de paradigme. Des premiers silex au premier âge des machines, les outils et machines rendent les gestes des humains plus efficaces, rapides et précis. Avec la révolution industrielle se déploie le temps des « machines-main-d’œuvre » qui exigent un apprentissage des utilisateurs. Cette logique conduit à ce qu’on appelle l’« automatique humaine » : on fait en sorte que les humains ne limitent pas les performances des machines. Les gestes techniques sont imposés aux utilisateurs, avec des conditionnements tayloriens et behavioristes traumatisants pour les corps et les cerveaux. Il en a été de même pour les produits mis sur le marché et leurs usages : il fallait apprendre de nouvelles techniques, comme conduire des voitures. Bien sûr, on devait déjà apprendre à monter à cheval, mais sans avoir à changer l’environnement et sans contraintes réglementaires ; c’est une autre affaire avec les voitures.
Le second grand changement de paradigme arrive en 2007, quand Steve Jobs présente les premiers iPhone, augurant l’explosion des smartphones. Il dit : « I’m going to change the world. » Parce qu’il a mis dans nos mains une machine et surtout des technologies qui incitent à inventer d’autres usages : les applications. Ça a commencé avec les ordinateurs, des machines généralistes destinées à de plus en plus d’usages, même non pensés par leurs inventeurs. Le phénomène des start-up vient de là : alors qu’il fallait de gros investissements pour les révolutions industrielles, les smartphones et autres appareils connectés permettent de créer des activités économiques en étant possesseur de ses propres moyens de production. Le numérique et ses outils nous entraînent dans le monde du « cerveau-œuvre », avec tout un cortège de transformations cognitives. Dans le monde mécanique et analogique de ma jeunesse, toute action suivait une suite contrainte d’étapes. Aujourd’hui, on peut atteindre un même but par divers chemins, machines, logiciels et algorithmes.
“L’arrivée du smartphone est une fausse révolution : la vraie révolution est encore devant nous”
—Olivier Girard
O. G. : L’arrivée du smartphone est une fausse révolution : la vraie révolution est encore devant nous. La première époque du digital, c’est la révolution de l’expérience client : celle de l’accès à un produit ou à un service. Avec Amazon, on a ramené l’acte de consommer à sa plus simple expression, un clic entre le consommateur et le produit. Tout est simplifié et dématérialisé. La prochaine révolution sera celle qui combinera l’expansion de l’Internet des objets et du edge computing [alternative au cloud qui permet de traiter des données à proximité de leur source, sans passer par un data center] pour rendre nos produits intelligents, serviciels, personnalisés et utilisant le temps réel. La voiture électrique est une évolution de la motorisation ; la voiture autonome, une révolution complète de cette industrie. Nous vivons un moment de transformation séculaire, comme avec la découverte de l’électricité ou du moteur thermique. Rien ne sera plus pareil, même si nous avons encore du mal à l’imaginer.
Le métavers va-t-il changer nos vies ?
O. G. : Les métavers portent deux révolutions en une. Ils bouleversent notre rapport au temps et à l’espace. Le temps est très fragmenté dans les réseaux sociaux : on a plusieurs conversations en même temps sur WhatsApp. Dans le métavers, nos avatars discutent dans le même espace-temps. Cela ressemble à une tentative de restaurer un espace proche de l’espace physique, sans les contraintes de ce dernier. Il va aussi permettre d’aller plus loin dans le télétravail, en le rendant accessible à une partie des cols-bleus. L’autre révolution, c’est celle qui permettra de disposer d’une identité digitale unique, sûre, et pouvant aller d’un site à l’autre, là où aujourd’hui nous avons une identité par site.
“Bientôt, nous aurons tous des doubles numériques à partir de toutes nos données personnelles”
—Pascal Picq
P. P. : Les métavers sont l’expression d’une galaxie numérique qui ne fait que s’agrandir. Ils sont la convergence logique entre les réseaux sociaux, les jeux et les outils des réalités virtuelles, des jumeaux numériques et des blockchains, et engloutissent de plus en plus d’activités personnelles, sociales et économiques. Après l’ubérisation, voici le temps de la « gamification » ! J’y vois un paradoxe. Les algorithmes nous connaissent mieux que nous-mêmes (les suggestions de choix de produits sur Amazon ou de films sur Netflix ne sont que de pâles figures de ce qui existe déjà). Bientôt, nous aurons tous des doubles numériques à partir de toutes nos données personnelles ; les entreprises chinoises du numérique, par exemple, définissent des profils très élaborés de leurs clients. Mais ces doubles numériques ne sont pas des avatars, et c’est là le paradoxe : nous avons d’un côté des déclinaisons numériques de ce que nous sommes à notre insu, et de l’autre, nous pouvons nous échapper dans des métavers grâce à nos avatars.
O. G. : Dans le métavers, on peut être qui on veut – par exemple mi-homme, mi-animal. Les jeunes sont très à l’aise avec cette idée qu’on peut avoir de multiples identités. Ce dédoublement est troublant. Cela me fait penser au carnaval !
P. P. : En effet, le métavers est un carnaval. Toutes les conventions sociales y sont bousculées. Plus les sociétés sont contrôlées, plus les individus ont besoin de ces soupapes de liberté.

Pascal Picq © Marie Genel pour Philonomist
Le numérique a bouleversé les rapports sociaux, notamment à travers le télétravail…
P. P. : Jusqu’à la révolution industrielle, il y avait unité de temps et de lieu pour la vie sociale et le travail, hormis pour quelques commerçants, des diplomates, les marins et les militaires. Toutes les activités gravitaient autour des lieux d’habitation et leurs événements commerciaux, politiques, festifs, religieux… Avec la concentration des moyens de production, les gens sont venus habiter près des mines et des grandes manufactures. Le monde moderne, c’est l’avènement d’un monde centripète, concentré autour du lieu de travail, avec un fort exode rural. À partir des années 1960 s’instaure une séparation géographique plus franche entre lieux de travail et de résidence, sur fond de tertiarisation de l’économie, avec des temps de transport contraignants. Aujourd’hui, on se retrouve à nouveau dans un monde centrifuge.
O. G. : Avec le télétravail, il s’est passé quelque chose d’extraordinaire : le travail est revenu à la maison !
P. P. : Et le stress du travail aussi ! La séparation entre le monde du travail et la vie privée est une invention récente. Mais là, on commence à avoir une inversion intenable. Le travail à domicile n’est qu’une composante des formes de travail à distance qui se déploient dans nos économies numériques.
O. G. : Ce qui fonctionne très mal encore, c’est l’hybride. Avoir une partie de l’équipe en présentiel et une autre en visio ne fonctionne pas. La communication n’est pas assez fluide, malgré la technologie. Le virtuel se confronte au réel. Mais nous ne sommes qu’au début de cette transformation. Le métavers nous laisse envisager une expérience qui sera de plus en plus « sans couture ». Nous allons aussi acquérir de nouvelles habitudes.
“Le 100 % distanciel nous a permis d’avoir accès à plus de talents, notamment féminins”
—Olivier Girard
P. P. : Des enquêtes ont été réalisées autour de la sociabilité induite par les réseaux sociaux. On se rend compte qu’il y a beaucoup de contacts et d’échanges, mais très peu de réalisations physiques. C’est troublant. Il y a là un aspect anthropologique et éthologique majeur. On perd les « épouillages », ce temps que passent les singes à s’enlever les poux. Lorsqu’on se rencontre, on éprouve un sentiment de partage, et l’on prête attention à la manière dont on exprime ce qu’on va dire. Un des gros problèmes de la modernité, c’est qu’on a perdu les rituels de passage.
O. G. : En entreprise, on travaille justement à rétablir des rituels, à organiser de l’événementiel, du temps non productif. Le travail est entré dans la sphère privée : par équilibre, la vie personnelle doit aussi exister au bureau ! Quand j’écoute les jeunes, je constate qu’ils veulent recréer un lien social qui a été très abîmé ces dernières années. On se retrouve physiquement au travail aussi pour sociabiliser. Il ne faut donc pas tant inventer des façons de travailler différentes que penser des moments différents au bureau. Du collectif, de l’informel… en complémentarité de ce qui peut être réalisé en télétravail. Celui-ci apporte un gain de temps dans les zones urbaines ; un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ; une diversité accrue aussi. Le 100 % distanciel nous a permis de recruter dans des villes où nous n’étions pas présents, ou encore d’avoir accès à plus de talents, notamment féminins.
P. P. : Mon utopie anthropologique numérique est celle-ci : grâce aux nouvelles collaborations à distance, on découvre des femmes et des hommes de toutes les diversités de par le monde ; de quoi faire reculer le sexisme et le racisme, car on constate qu’il y a des compétences partout.
“Les humains ont des capacités cognitives que n’auront jamais les machines”
—Pascal Picq
Le développement de l’IA suscite une certaine angoisse. La crainte de se voir dépassé par les machines est-elle justifiée ?
P. P. : Nous craignons d’être manipulés par les machines parce qu’elles touchent à nos capacités intellectuelles. Le problème, c’est qu’on comprend mal la notion d’IA. Au sens anglo-saxon du terme, l’intelligence est la capacité de résoudre un problème complexe à travers un ensemble de données ou d’informations. C’est ce que fait l’IA : elle résout des problèmes plus vite que nous. Or, nous n’avons jamais craint d’être dominés par les voitures parce qu’elles vont plus vite que nous ! Les humains ont des capacités cognitives que n’auront jamais les machines, comme les aptitudes à la généralisation ou la conceptualisation ; quant aux machines, elles ont des capacités de traitement des données que notre cerveau trop lent ne peut espérer développer.
O. G. : Je suis entièrement d’accord avec vous, mais je pense que cette angoisse vient du fait qu’on imagine que ces machines peuvent faire preuve de créativité, voire développer un jour une conscience de soi. Quand Kasparov se fait battre aux échecs par Deep Blue, nous sommes forcés d’enterrer notre conception romantique de la créativité humaine. On se rend compte que c’est le jeu lui-même qui est devenu un calcul élaboré ! Comme vous le dites, on peine à définir exactement l’intelligence. On parle par exemple d’IA faible et d’IA forte. Une IA faible accomplit le mieux possible des tâches spécifiques qu’on lui donne ; elle peut certes apprendre avec le deep learning, mais elle a un objectif. Aujourd’hui on ne fait que de l’IA faible, c’est-à-dire des choses extraordinairement répétitives. On aime se faire peur, or il est évident que les machines n’ont pas conscience d’elles-mêmes, qu’elles ne sont pas créatives et qu’elles ne savent résoudre que des problèmes qu’on leur a déjà un peu débroussaillés.
P. P. : Une IA n’a aucune créativité au sens cognitif des humains. C’est en ce sens qu’il faut comprendre les affirmations du genre « l’IA n’existe pas ». Par contre, les analyses de données proposent des schémas que l’esprit humain aurait la plus grande peine à extraire. Il ne s’agit pas de créativité, mais de corrélations et de schémas proposés par les machines. On peut décider que ce qu’elle a produit relève de l’œuvre d’art – mais cette décision sera prise par des humains !
O. G. : Le rapport à la machine a toujours été un peu anxiogène. On a besoin d’un moment d’apprentissage. La littérature de science-fiction reflète assez bien à quel stade d’acceptation en est une société par rapport à l’évolution technologique. Au moment où l’on découvre l’électricité, Mary Shelley écrit Frankenstein [1818], l’histoire de cette créature qui devient autonome. On pensait alors que l’électricité était à l’origine de la vie. Plus récemment, c’est Stanley Kubrick qui a révélé notre peur de l’IA dans 2001. L’odyssée de l’espace [1968]. La question posée par ces œuvres est la même : « Que se passe-t-il si je perds le contrôle ? »
“Nous voyons l’arrivée des machines comme une révolution technique, alors que c’est une révolution anthropologique”
—Pascal Picq
P. P. : Mary Shelley s’est inspirée des travaux d’Erasmus Darwin, le grand-père de Charles, premier grand médecin moderne qui eut l’idée d’appliquer l’électricité à la médecine. Dans la culture occidentale, nous avons une phobie profonde de l’autonomie de l’intelligence, que ce soit pour les animaux ou les machines. C’est pourquoi notre science-fiction est si dystopique : à chaque fois, ça tourne mal ; on craint des robots tueurs ! Les Japonais ne partagent pas cette méfiance. Dans chaque culture, le rapport à la machine reproduit le rapport à l’animal, une altérité qu’on considère comme intelligente ou pas. De ce côté-là, nous avons un sacré handicap en Europe occidentale. Avoir un dialogue avec une IA semble parfaitement naturel à un Japonais, alors que ça nous semble complètement aberrant. Nous voyons l’arrivée des machines comme une révolution technique, alors que c’est une révolution anthropologique.
O. G. : Tout à fait. En Asie, les gens n’ont aucun problème avec l’idée d’avoir un jumeau numérique. Ils sont parfaitement à l’aise avec le fait qu’un double d’eux-mêmes fasse les courses sur Internet, par exemple, ou que des robots dispensent des soins infirmiers.
P. P. : La philosophie occidentale a une peur ontologique fondamentale de l’autonomie des machines. Or, avec l’Internet des objets, cette autonomie est déjà là : on a des assistants vocaux, des smartphones, des laptops connectés qui échangent de l’information et ne cessent d’évoluer. C’est l’espace digital darwinien : tout se passe comme dans la nature. On assiste à des mutations qui se font sans nous, grâce aux algorithmes apprenants. N’oublions pas que l’IA n’est pas biomimétique, mais bio-inspirée. Le biomimétisme imite les matières, les structures et les formes de la nature ; la bio-inspiration est beaucoup plus complexe : elle emprunte aux mécanismes de l’innovation et de l’adaptation dans le monde vivant. On se représente toujours l’IA comme un robot : c’est absurde. On voit des machines, on ne voit pas leurs interactions. Ce monde de machines connectées et apprenantes évolue exactement comme les écosystèmes naturels, et de façon indépendante.
L’IA ne risque-t-elle pas de faire disparaître des emplois ?
P. P. : À chaque révolution technologique surgit le spectre du remplacement des humains ou des travailleurs. L’histoire des technologies est riche d’exemples de politiques qui freinent l’essor de nouvelles technologies de peur de provoquer des désordres sociaux. Cela a toujours existé depuis l’Antiquité, mais le phénomène s’est amplifié depuis la révolution industrielle en raison de l’ampleur des changements économiques, sociaux et politiques. Ces réactions, compréhensibles, recouvrent néanmoins un paradoxe. Prenons les luddites : ces ouvriers du textile ont détruit les machines qui les menaçaient, alors même que leurs emplois provenaient… de machines inventées quelques décennies plus tôt ! La question est de savoir quelles tâches la technologie détruit ou crée dans les différents emplois.
“Les machines ne vont pas nous voler notre travail. Elles vont nous permettre de nous concentrer sur les problèmes les stimulants intellectuellement”
—Olivier Girard
O. G. : Les machines ne vont pas nous voler notre travail. Au contraire, elles vont nous empêcher de faire des tâches répétitives et nous permettre de nous concentrer sur les problèmes les plus complexes et stimulants intellectuellement. On oublie que l’IA permet de créer de nouvelles activités. On a par exemple développé une IA pour écrire les mémoires des personnes âgées : un appareil enregistre ce qu’elles racontent, leur pose des questions pour vérifier les informations, et un écrivain termine le travail pour proposer un livre de cent cinquante pages à offrir à leurs petits-enfants. C’est une nouvelle activité qui se crée. L’IA va venir en complément du travail humain. C’est d’ailleurs là où c’est le plus efficace : quand l’humain apprend de la machine et apprend à la machine. Mon conseil, c’est de ne jamais laisser une IA seule ! Non pas car elle pourrait nous contrôler, mais parce que c’est sous notre contrôle qu’elle nous apporte le plus.
P. P. : Tous les experts de la prospective sur le travail se sont plantés en annonçant sa fin ou son partage. Leur erreur : postuler qu’il y a un volume constant de travail. D’où sort une telle idée ?
Les disruptions technologiques ont pourtant des répercussions sociales terribles.
P. P. : Le pire danger pour les emplois les moins qualifiés, ce n’est pas la digitalisation ou l’automation, mais les délocalisations. La révolution technologique ne pose pas de problème pour les métiers des plus diplômés, ni pour les métiers de proximité, de services et les moins diplômés, mais pour ceux qui sont entre les deux. On assiste, comme pour chaque révolution technologique, à une bipolarisation avec l’érosion des métiers dits « intermédiaires », ceux des classes moyennes plus modestes qui sont durement malmenées. Jean-Marc Vittori appelle ça l’« effet sablier » : chaque rupture technologique bouleverse l’équilibre socio-économique de la population. Ma génération a connu l’émergence des classes moyennes, notamment avec la création des métiers techniques. Ce sont ces métiers qui sont directement touchés par les nouvelles technologies. D’où, si l’on accepte les travaux d’Erik Brynjolfsson et Andrew McAfee, la « grande coupure » avec l’effondrement des classes moyennes dans les pays occidentaux. Les diplômes Bac + 2 à Bac + 4 garantissaient l’entrée dans les classes moyennes ; c’est terminé depuis vingt ans. On passe d’une distribution des indices socio-économiques selon une courbe en forme de dromadaire (comme une courbe de Gauss) à une courbe en forme de chameau, marquée par une forte bipolarité.
O. G. : D’autres économistes comme Branko Milanović parlent d’une courbe en forme d’éléphant, ce qui revient au même.
La technologie finira-t-elle par nous libérer du travail, comme l’espèrent certains ?
O. G. : Je ne crois pas à une disparition du travail. Les trois pays les plus avancés en robotique, à savoir le Japon, la Corée du Sud et l’Allemagne, ont des taux de chômage qui sont parmi les plus faibles, preuve que l’évolution technologique ne détruit pas l’emploi à long terme. Au XXIe siècle, on va avoir besoin d’énormément de robots pour décarboner l’économie. Tout est à réinventer : les offres de produits, les transports, la construction des maisons. Et on manquera de main-d’œuvre pour ça. La pénurie de talents à laquelle nous sommes déjà confrontés sur de nombreux métiers en est un bon exemple.
“Il n’y a pas eu une révolution technologique qui ne se soit accompagnée d’une expansion économique, démographique et territoriale”
—Pascal Picq
P. P. : Au cours de l’évolution de la lignée humaine, il n’y a pas eu une révolution technologique qui ne se soit accompagnée d’une expansion économique, démographique et territoriale, entraînant elle-même des créations d’activité. C’est la logique des écosystèmes : plus il y a d’acteurs, plus il y a d’activité. Dans les pays où plus de femmes, de juniors et de seniors travaillent, il y a plus de travail et d’emplois ; ce qui vaut avec les machines. L’écosystème de l’économie verte devrait créer des emplois : trois cents millions de jobs d’ici 2030 ! Mais ce n’est pas sur ce secteur, certes vital, que se fera la croissance.
O. G. : Toute la difficulté, c’est d’organiser cette transition dans un court laps de temps, et de la financer. On va devoir former beaucoup plus de gens à l’échelle mondiale ou continentale.
Quel est le rôle de l’entreprise dans tout cela ?
O. G. : L’entreprise prend conscience de cet enjeu. Avant, il y avait une séparation entre un monde académique qui fabriquait des diplômés et l’entreprise qui les embauchait. Depuis l’apparition du chômage de masse en Occident dans les années 1970, et avec le besoin de spécialisation accru, les entreprises participent à la formation. Elles se sentent aussi responsables de l’employabilité de leurs collaborateurs, et se soucient de ce qu’ils deviendront une fois qu’ils auront quitté l’organisation. Mais la formation reste à améliorer. Il faut aller plus loin que se demander quels sont les besoins d’un pays à dix ans dans les grandes filières, en tenant compte des nouveaux besoins, d’une organisation du travail différente, de la puissance du numérique…
P. P. : C’est toute l’ambiguïté de ce que de Gaulle appelait l’« exigence du plan », alors que toute planification conduit à l’échec. Un plan ne sert pas à dire ce que sera l’avenir mais à se préparer à ce qui ne va pas advenir. En 2008, parmi les dix plus grosses capitalisations boursières, il y avait des pétrolières, quelques banques, de la « Big Pharma » et Microsoft. Dix ans plus tard, sept jaillissent du numérique, dont Microsoft. Inquiétant ? Pas du tout. Ce sont les certitudes qui nous mettent dans l’angoisse. Le temps d’un métier pour la vie est révolu depuis longtemps. Même les métiers les moins qualifiés vont monter en compétence. Le grand mot est la formation. Cadeau de notre évolution : nous sommes une espèce qui est capable d’apprendre tout au long des âges de la vie ! Plus encore : c’est bon pour nos capacités cognitives, l’espérance de vie et, globalement, pour la société.
“[Sur la question des données], l’Europe bénéfice d’une forme de leadership par son exigence normative”
—Olivier Girard
On s’inquiète de plus en plus du pouvoir d’entreprises privées comme les Gafam [Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft]. Jusqu’où faut-il laisser la technologie se développer sans la réguler au niveau étatique ?
O. G. : Il faut des règles. L’Europe est en avance sur ces sujets, le reste de la planète la copiera – peut-être pas la Chine, mais du moins les États-Unis. De même qu’il y a des normes sur les moteurs, il y aura des normes sur les algorithmes, et des organismes pour les certifier. Prenons le domaine du cloud : il y a encore quelques années, on ne se posait pas la question de savoir où l’on stockait ses données. Puis la France et l’Allemagne sont arrivées avec le concept de « cloud souverain », en affirmant la nécessité de protéger certaines données qui relèvent de leur souveraineté nationale. Aujourd’hui, tout le monde réclame des fonctionnalités souveraines. Cela montre que l’Europe bénéficie d’une forme de leadership par son exigence normative.
P. P. : La crise de la pandémie et la guerre en Ukraine ont contribué à rappeler l’importance de la souveraineté. Dans une logique écosystémique, il ne faut surtout pas délaisser les activités de production de base (on a vu les conséquences pour les masques, les vaccins, puis le gaz et le blé), ni la souveraineté, des champs au cloud européen.
Faut-il parfois envisager de renoncer à une technologie ?
P. P. : Il n’y a pas de réponse simple et univoque à cette question. Tout dépend de l’acceptation des technologies. En Chine, les gens acceptent ce qu’on y appelle le « réseau céleste », ce système de surveillance globale qui vous trace grâce à la reconnaissance faciale. Tandis qu’en Californie, on a vu des gens gifler ceux qui portaient des Google Glass dans la rue parce qu’ils ne voulaient pas être filmés. Les acceptations sont radicalement différentes selon les cultures. Le numérique chinois, ce n’est pas le numérique californien !
Ce serait donc simplement une affaire d’acceptation culturelle ?
O. G. : L’acceptation culturelle y joue un rôle, bien sûr, mais je pense qu’il ne faut pas sous-estimer la notion d’adaptation au changement, qui est nécessaire pour accompagner le progrès et les avancées technologiques. Il ne me vient pas spontanément à l’esprit une technologie que je trouverais déviante au point de dire qu’il faudrait s’en garder. Encore une fois, c’est l’usage qu’on en fait qui peut poser problème. L’un des risques aujourd’hui, c’est plutôt que l’on devienne très dépendant du numérique. Le roman Ravage de Barjavel [1943] décrit une panne généralisée qui révèle notre impuissance sans la technologie. Que nous arrivera-t-il si tout s’arrête ? En cas de panne aussi, l’adaptation est d’autant plus nécessaire !
P. P. : C’est l’événement de Carrington, une série d’éruptions solaires qui ont fortement perturbé les circuits électriques, comme les télégraphes. Ça s’est passé en 1859, année d’une autre éruption terrestre, celle de L’Origine des espèces par Charles Darwin. Back to evolution!