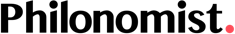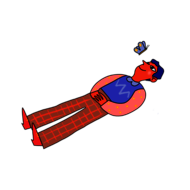Data, intelligence artificielle, hydrogène… Pour réinventer les transports, les innovations ne manquent pas. Dans un monde de plus en plus urbanisé, en proie à une crise environnementale majeure, nous devons revoir nos modes de déplacement. Quels seront les enjeux de la mobilité de demain ? Catherine Guillouard, ancienne PDG de la RATP, et Michel Lussault, géographe, en débattent dans un échange foisonnant d’idées.
Cet article est extrait de l’ouvrage Le Sens de la tech, publié le 26 mai 2023 chez Philosophie magazine éditeur. Retrouvez le sommaire et l’ensemble des articles extraits de cet ouvrage sur le site de Philonomist. Pour commander le livre, c’est par ici !
À l’heure de la transition écologique, la question de la mobilité est de plus en plus présente dans les débats. Le modèle actuel n’est pas durable, c’est évident. Pour en sortir, il faudra nécessairement miser sur la technologie, en inventant des véhicules propres et en continuant à développer un réseau de transports en commun qui puisse répondre aux besoins de tous. Des évolutions qu’il faut penser en accord avec le lieu où elles doivent s’implanter, car l’espace se trouve forcément chamboulé par les aménagements menés en termes de mobilité.
Pour démêler les enjeux complexes de ce vaste sujet, nous avons fait dialoguer un géographe spécialisé dans les questions urbaines et une dirigeante concernée de près par ces problématiques. Le géographe d’abord : Michel Lussault, fondateur de l’École urbaine de Lyon, qui s’est fait une spécialité d’analyser les processus d’urbanisation et leurs impacts sociaux et environnementaux. La dirigeante, ensuite : Catherine Guillouard, qu’il a pu rencontrer juste avant qu’elle ne quitte ses fonctions de PDG du groupe RATP. De leur échange fourmillant d’idées émergent des réflexions et des propositions originales. Comment des espaces non urbanisés ressentent-ils les effets de l’urbanisation ? Comment et pourquoi contenir les villes ? Pourquoi ne pas faire financer les transports publics par les promoteurs immobiliers ? Comment l’intelligence artificielle (IA) peut-elle diminuer les retards du RER ? À lire sans plus attendre.
Propos recueillis par Anne-Sophie Moreau.
En quoi la mobilité est-elle un enjeu crucial pour l’humanité ?
Michel Lussault : Parmi les caractéristiques intéressantes de l’espèce humaine, il y a sans doute son appétence pour la mobilité depuis toujours. Le peuplement de la Terre par les êtres humains dès le paléolithique a déjà quelque chose à voir avec leur désir de mobilité, dont les archéologues et les préhistoriens ont montré qu’il n’était jamais exclusivement couplé à un besoin fonctionnel immédiat. C’est ce qui est fascinant avec la mobilité : elle ne peut jamais être conçue simplement comme une fonction. Dans la période contemporaine, cela s’illustre par la volonté de certains acteurs (politiques, culturels, sociaux…) de la faire reconnaître comme l’un des droits humains fondamentaux ; non pas comme un droit conditionnel (j’ai le droit de me mouvoir si on me demande de travailler quelque part), mais comme un droit « créance » de l’individu, qui peut et qui doit pouvoir réclamer cette mobilité pour quelque projet que ce soit.
Catherine Guillouard : La mobilité est une condition de la liberté. On l’a particulièrement vu et senti pendant la pandémie : toutes les premières lignes ont pu être à leur poste parce que le service public que nous étions avait continué à fonctionner. À la RATP, on a mis en place vingt lignes de bus dédiées aux hospitaliers lors du premier confinement pour leur permettre de se déplacer, y compris la nuit.
“La mobilité, c’est tout ce qui donne la possibilité de se mouvoir, et ça n’est pas réductible à l’existence d’un véhicule”
—Michel Lussault
La crise du Covid a-t-elle changé notre vision de la mobilité ?
M. L. : Le Covid nous a montré que dès que les aéroports, les gares, les grandes aires de connexion, d’échange de marchandises et de croisement de personnes ferment, non seulement le monde s’arrête, mais le monde urbain perd une de ses conditions de possibilité. Depuis quatre-vingts ans, le progrès technologique au sens large – pas simplement la technologie des modes de transport, mais la technologie de l’ensemble du système – permet à l’individu de se mouvoir plus facilement. Car la mobilité, c’est tout ce qui donne la possibilité de se mouvoir, et ça n’est pas réductible à l’existence d’un véhicule.
C’est pourquoi d’ailleurs je préfère parler de mobilité et de logistique (logistique que je définis comme le champ des techniques et des procédures nécessaires à réaliser un déplacement) que de seule mobilité. Si, à la RATP, vous changez votre flotte de bus, c’est l’ensemble du système logistique qui doit être reconsidéré. Or sans les logistiques des personnes, des matières et des données que nous connaissons aujourd’hui, nous n’aurions pas du tout le même monde. Depuis quelques décennies, il y a eu une sorte de couplage entre l’aspiration à la mobilité, l’évolution technologique et l’urbanisation planétaire qui a profilé le monde mobilitaire et connecté que nous connaissons aujourd’hui, et dont la pandémie nous a montré à la fois la puissance et la vulnérabilité.
C. G. : Nous avons profité de cette crise pour nous interroger collectivement sur notre raison d’être, révélée en mars 2021 et que nous avons définie comme « s’engager chaque jour pour une meilleure qualité de ville ». Nous sommes en effet un opérateur de transports publics, mais nous gérons aussi des infrastructures, nous construisons des lignes de métro et les entretenons. Nous bâtissons aussi de véritables bouts de ville, en construisant des crèches ou encore des logements au-dessus des centres bus.
Aujourd’hui, la RATP est un fabuleux thermomètre de la situation post-Covid. En semaine, la fréquentation sur nos RER est à 86 % de son niveau prépandémique. Le week-end, le métro est à 90-95 % ; en semaine, il est à 85 %. Un nouveau schéma sociétal est en train d’émerger, avec un nouveau rapport au télétravail et aux loisirs. Ce qu’on voit, ce sont des gens qui, au travers du télétravail, ont pris des habitudes totalement différentes et restent davantage chez eux pour travailler. Les effets d’heures de pointe se sont lissés : les entreprises n’attendent plus que leurs salariés soient à leur bureau entre 8 h 30 et 9 heures.
On a aussi noté une augmentation très forte pendant la crise du volet logistique et du commerce électronique. On l’a d’ailleurs anticipé : pour utiliser au mieux nos actifs, on a fait venir des logisticiens de Chronopost, d’Amazon et autres pour organiser de miniplateformes logistiques à l’intérieur de nos centres bus et pouvoir faire de la livraison du dernier kilomètre en centre-ville en pur électrique. Le tout avec des appels d’offres et des clauses qui respectent les conditions sociales des employés, bien sûr.
“Dès qu’on parle de mobilité, on parle de la vie humaine en société, et donc de choses qui sont extratechnologiques”
—Michel Lussault
M. L. : De ce que vous dites, on voit bien qu’en matière de mobilité, il est nécessaire de ne pas considérer que les technologies et les techniques, même si celles-ci sont fondamentales. Car dès qu’on parle de mobilité, on parle de la vie humaine en société, et donc de choses qui sont extratechnologiques. La mobilité, c’est un ensemble d’activités, de ressources et de pratiques, et même d’imaginaires et de cultures permettant le jeu de relations et de connexions qui est au cœur du monde contemporain. Ce n’est pas un hasard si les grands opérateurs de mobilité dans le monde – et il n’y a pas de contre-exemple – sont tous devenus de grands opérateurs urbains transversaux.
C’est vrai aussi de grands groupes de logistique de marchandises qui sont des « urbanistes » majeurs, au sens où ils contribuent puissamment à la mise en place d’espaces emblématiques de l’urbain contemporain. On pourrait aisément montrer comment une entreprise qui règne sur la logistique comme Amazon est aussi une entreprise qui fait de l’urbanisation. Bref, j’y insiste à nouveau, on doit toujours associer analyse des faits mobilitaires dans toutes leurs dimensions urbaines et examen des faits logistiques.
Quels sont les enjeux liés à la forte urbanisation aujourd’hui ?
M. L. : Les nouveautés technologiques ont permis une mobilité plus rapide mais surtout de plus large échelle géographique, car à chaque fois qu’on gagnait de la vitesse, on gagnait de l’espace. La mobilité est un phénomène spatio-temporel : si vous augmentez votre vitesse moyenne, vous gagnez en espace parcourable par unité de temps. C’est ce qui a été à l’origine de la périurbanisation.
Je fais partie de la famille de chercheurs qui considèrent ce qu’on appelle en bon français « the planetary urbanization » : pour nous, l’urbanisation a gagné tous les espaces et toutes les sociétés, même ceux qui apparemment ne sont pas urbanisés. Si l’on est dans un espace apparemment rural, formellement non urbanisé, mais qu’on est dépendant de son automobile pour accéder aux biens et services, et connecté au réseau télécommunicationnel pour assurer un certain nombre de prestations et d’activités, on est inscrit dans le processus d’urbanisation planétaire. Tout est en réalité connecté dans un système global, ce que j’appelle le « système urbain planétaire », dans lequel on retrouve des formes de vie assez comparables.
“Il faut contenir la ville, car l’horizontalité coûte très cher, tant pour l’installer que pour l’entretenir”
—Catherine Guillouard
C. G. : On est passé à des taux d’urbanisation extrêmement élevés. Aujourd’hui, 70 % des espaces sont urbanisés, avec une centaine de villes qui vont avoir plus de cinq millions d’habitants d’ici à 2030. Or, cela va être un sujet majeur que d’arriver à vivre dans ces lieux tout en préservant un minimum l’environnement et la qualité de vie. Il faut contenir la ville, car l’horizontalité coûte très cher, tant pour l’installer que pour l’entretenir. Et on ne peut pas dire que le mitage urbain soit fantastique.
En tant que groupe RATP, on se donne pour objectif de contribuer à une urbanisation raisonnable et raisonnée. Nous sommes très engagés sur les aspects de responsabilité sociale et environnementale. Et nous sommes de fervents partisans de la verticalisation : on utilise la base de nos actifs industriels pour construire au-dessus, pour optimiser les espaces contre l’étalement urbain. On refuse de réduire notre vision au transport, même si évidemment c’est notre cœur de métier.
Quels types de transports doit-on favoriser ou développer pour freiner le réchauffement climatique ?
M. L. : Quand on analyse la technologie mobilitaire, on est trop souvent obsédé par la technologie des véhicules. Or, ce n’est plus tellement la seule performance intrinsèque des véhicules qui est centrale depuis quelques années, mais plutôt leur compatibilité avec les enjeux économiques, avec les aspirations sociales et, plus récemment, avec les défis de décarbonation.
C. G. : L’utilisation de l’espace public est un sujet majeur. Un exemple : si les 1 700 personnes qu’on transporte aujourd’hui dans un RER décidaient de revenir à l’automobile, on aurait – étant donné qu’on a en Île-de-France 1 voiture pour 1,2 automobiliste – 1 400 voitures de plus en circulation, pour 1 train de RER ! Ce serait une catastrophe, en termes de pollution, mais aussi pour l’espace public. Les mobilités de transports publics de masse sont très économes de ce point de vue-là. Chaque jour, 1,4 million de voyageurs empruntent le RER A. Et c’est en ville que se joue ce combat pour l’espace public.
“La grande force du transport public, c’est qu’il pourrait économiser de tout : de l’espace, des ressources, des financements, des capacités d’attention des voyageurs”
—Michel Lussault
M. L. : On pourrait ajouter que la grande force du transport public, c’est qu’il pourrait économiser de tout : de l’espace (les infrastructures routières et les automobiles en surconsomment), des ressources, des financements par kilomètres parcourus, des capacités d’attention des voyageurs (on est déchargé de la nécessité de conduire et on peut donc s’attacher à une autre activité, lecture, écoute, repos, etc.). Toutefois, il reste beaucoup de travail afin de réaliser ces promesses. Si l’on veut que les sociétés urbaines affrontent les défis du changement global (vagues de chaleur, stress sur les ressources, restauration des hydrosystèmes et des écosystèmes, etc.), il va falloir des technologies sociales qui permettront d’intensifier encore le transport public, mais aussi d’améliorer sa qualité et sa paisibilité.
C. G. : Le transport public est un axe majeur de la décarbonation. À la RATP, nous avons un objectif très important qui est de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 50 % entre 2015 et 2025. Les trois quarts de nos gaz à effet de serre proviennent des bus, c’est pourquoi dans le périmètre francilien, nous convertissons nos 4 700 bus et nos 25 centres bus aux énergies propres. L’année dernière, on a fait 600 bus propres, cette année 500. Le tout sans arrêter l’exploitation.

Catherine Guillouard © Xavier Schwebel pour Philonomist
Que penser d’innovations comme l’hydrogène, qu’on accuse d’être une fausse solution ?
C. G. : Nous faisons des bus à hydrogène. Mais je pense que ce n’est pas une technologie mature. Quand je suis arrivée en 2017, j’ai découvert que pour chaque centre bus qu’on convertissait à l’électrique ou au biogaz, les exigences réglementaires étaient toutes différentes. Il en va de même pour l’hydrogène. L’hydrogène gris, généré via des combustibles fossiles, présente un intérêt infiniment moindre que l’hydrogène vert, qui est produit à partir d’électricité d’origine renouvelable grâce à l’électrolyse de l’eau. Je crois fortement que l’hydrogène peut être une réponse, mais au-delà des années 2030, puisqu’il faut encore construire les infrastructures.
C’est le même problème que pour les voitures électriques. Aujourd’hui, je vous mets au défi de traverser la France en voiture électrique sans rencontrer de difficultés (il vous faudra rechercher des bornes, etc.). Le manque d’infrastructures est une priorité absolue pour les dix ans qui viennent, pour l’hydrogène comme pour l’électrique.
“Le métro, le bus et le RER sont les derniers endroits de mixité sociale”
—Catherine Guillouard
Risque-t-on d’évoluer vers un système où les plus privilégiés rouleront en voiture électrique, tandis que les classes populaires s’entasseront dans les transports publics ?
C. G. : Vous avez raison de pointer le sujet de la voiture électrique. Ce mode de transport coûte très cher. Comment vont faire les ménages modestes ? Notre créneau, ce sont les transports en commun collectifs. Le métro, le bus et le RER sont les derniers endroits de mixité sociale. Et notons qu’on n’a pas observé de « ségrégation sociale » post-Covid. Cette inclusion fait partie de la mission des transports qui portent bien leur nom : « en commun ». Il y a eu beaucoup d’aides de la part de la ville de Paris et de la région Île-de-France, pour inciter les gens à les utiliser.
Cela pose d’ailleurs le problème du financement. Aujourd’hui, le poids que les clients portent dans la tarification est modeste. Par rapport aux investissements réalisés, la part qui reste à la charge du voyageur est de l’ordre de 30 %, contre 40, voire 50 % dans les grandes villes étrangères comme Madrid ou Londres. Or la RATP, dans le cadre de son contrat avec Île-de-France Mobilités, a pour objectif d’investir 8,4 milliards entre 2021 et 2024. Et on le fait : on étend les lignes, on rénove le matériel roulant… Mais tout cela coûte énormément d’argent, et le système doit prévoir la maintenance de ces infrastructures.
Aujourd’hui, on est dans une impasse financière : cela fait trois ans que la région se tourne vers l’État pour boucler les financements. Il va bien falloir élargir la boîte à outils des financements, sans quoi on va mettre en péril tout le système de transports publics, qui est pourtant un vecteur stratégique majeur de la stratégie bas carbone. La mobilité est une œuvre collective.
“Ma conviction, c’est que le financement doit être élargi, notamment à la promotion immobilière”
—Catherine Guillouard
Où trouver les financements pour les transports publics ?
C. G. : Ma conviction, c’est que le financement doit être élargi, notamment à la promotion immobilière. Entre le moment où nous avons décidé d’ouvrir l’extension de la ligne 14 et le moment où elle a vu le jour, les prix de l’immobilier ont augmenté de 54 % à Saint-Ouen. Mais pas 1 euro n’a été capté par le système pour le réinjecter dans les transports. Quand on regarde les externalités positives créées par les infrastructures de transports publics et le faible retour qu’on réinjecte dans leurs financements, on se dit que c’est absurde sur le plan économique. À Hong Kong, l’opérateur des transports publics tire les deux tiers de son excédent brut d’exploitation de la promotion immobilière. C’est un grand promoteur immobilier, qui fait du profit et le réinjecte en développant les transports publics.
M. L. : C’est un vrai sujet. Dans de nombreux pays, les externalités positives des investissements publics sont captées par les entreprises qui, en retour, font souvent assumer les externalités négatives de leurs propres investissements à l’État. C’est un vice de forme de la conception initiale du développement urbain qui règne en maîtresse, en particulier depuis cinquante ans, avec ce qu’on pourrait appeler les « imaginations dominantes de la métropole », ou de la world city. Or cette ville mondiale du capitalisme contemporain n’existe que parce qu’il y a cette jouissance des externalités positives des investissements publics, et la gestion publique des communs négatifs. Il faut donc que les pouvoirs publics et les sociétés civiles reprennent la main.
Quel rôle joueront les nouvelles mobilités dans les déplacements du futur ?
C. G. : Nous avons une vision holistique des mobilités : notre rôle, ce n’est pas seulement de faire du transport public de masse, mais aussi de proposer de nouvelles mobilités pour aller d’un point à un autre, en tenant compte du dernier kilomètre. La RATP a aujourd’hui un portefeuille de treize mobilités : huit qu’elle opère en « dur », allant de la navette maritime aux bus, mais aussi cinq nouvelles solutions de mobilité comme les parkings partagés, l’autopartage, le covoiturage… et des applis : sur notre appli Bonjour RATP, vous pouvez désormais réserver un trajet qui inclut une location de vélo ou de VTC.
“Le travail sur la connexion et l’articulation des différents modes mobilitaires a énormément fait progresser le champ de la mobilité urbaine depuis 30 ans”
—Michel Lussault
M. L. : D’autres technologies viennent se substituer aux seules technologies de la performance et de la rapidité. Le travail sur la connexion et l’articulation des différents modes mobilitaires a énormément fait progresser le champ de la mobilité urbaine depuis trente ans. La chaîne longitudinale de mobilité commence avec la technologie de plus faible intensité qu’est la marche, qu’on réinjecte à l’intérieur de ce continuum à travers, par exemple, les applications numériques.
C. G. : Au point que le temps de marche est intégré dans les applications !
M. L. : Ce qui est très spectaculaire pour un géographe comme moi, ce sont les « néogéographies numériques », c’est-à-dire la façon dont le numérique et les applications ont bouleversé notre rapport à l’espace. Ces technologies extrêmement sophistiquées qui permettent d’identifier sa position en temps réel, de composer des itinéraires, etc., ont redonné à la technique la plus élémentaire – la marche – un rôle d’étalon. Puisque c’est toujours peu ou prou à partir de la marche qu’on va composer le reste. Ce qui devient essentiel pour un technologue, ce n’est pas de tendre vers le bus le plus performant dans l’absolu, mais de réfléchir à quelles articulations ménager – ce qui explique qu’il n’y a pas aujourd’hui de technologie mobilitaire sans production de données, sans algorithme, sans capacité de calcul. C’est devenu à la fois l’élément de puissance du système logistique, mais aussi sa fragilité, puisque ça crée aussi des dépendances aux chemins technologiques qui sont très fortes.
“Un système de mobilité efficient, c’est un système qui est capable de faire des connexions entre les différents types de mobilité”
—Catherine Guillouard
C. G. : On travaille sur l’intermodalité mais aussi sur la multimodalité. Un système de mobilité efficient, c’est un système qui est capable de faire des connexions entre les différents types de mobilité. À quoi ça sert d’avoir un bus complètement déconnecté des heures d’arrivée du RER ?
En quoi l’intelligence artificielle (IA) et les data peuvent-elles aider à améliorer les mobilités ?
C. G. : La technologie doit améliorer l’efficience opérationnelle et être développée pour rendre des services aux citoyens. On a déjà un système très sophistiqué, et les technologies vont nous permettre de faire de plus en plus de progrès. Alors que, sur le RER, de nombreuses pannes sont liées aux portes, on a mis en place un programme d’IA qui détecte les problèmes en amont. D’où une baisse de 30 % des pannes sur les portes de nos RER.
En outre, la performance d’un opérateur de transports aujourd’hui nécessite un volet data. Un exemple : récemment, on a eu un effondrement de talus lié à des événements climatiques. On a donc élaboré un plan de traitement de ces crises dans lequel on a inséré tout un volet technique de surveillance de nos infrastructures par des objets connectés.
“Une guerre larvée se fait jour entre les acteurs publics et privés autour de la data”
—Catherine Guillouard
Ma grande obsession, c’est de conserver la capacité à utiliser les data de la manière la plus intelligente possible pour améliorer l’efficience opérationnelle de notre réseau et de nos fonctionnements. C’est important parce qu’une guerre larvée se fait jour entre les acteurs publics et privés autour de la data. Quand vous parlez de mobilité réseau service, il faut être sûr de la réciprocité des échanges de données. La RATP est le deuxième opérateur d’open data en France : chaque mois, plus d’un milliard de données quittent l’entreprise, utilisées par des opérateurs privés tels que Google. Mais il faut que l’inverse soit vrai. Or, aujourd’hui, le système a gravement dérivé vers une asymétrie : il est plus facile pour un opérateur privé de venir se servir dans l’open data des opérateurs publics que l’inverse.
C’est quelque chose que la loi d’orientation des mobilités de décembre 2019 a commencé à cadrer mais les décrets d’application ne sont pas tous sortis, et c’est pour nous un enjeu énorme. Nous n’avons aucun problème à partager nos données pour l’amélioration collective des outils qui vont ensuite avoir un impact sur la qualité des trajets de mobilité proposés ; en revanche, il ne faut pas être angélique : il faut aussi que les opérateurs puissent avoir accès et vendre les mêmes services numériques qui sont proposés par le législateur. L’absurdité totale serait que les opérateurs de transports comme la RATP descendent dans la chaîne de valeur, et deviennent de simples tractionnaires. C’est le danger qu’on essaie de contrecarrer en étant un opérateur souverain : souverain par sa puissance de feu opérationnelle, mais aussi sur ses data.
M. L. : Je pense effectivement que les data sont centrales, et qu’il faut parfois sortir d’un discours trop schématique sur les données, qu’il soit allégorique ou hypercritique, car les réalités sociales sont beaucoup plus mélangées. Cela pourrait permettre à une entreprise de mobilité souveraine de parvenir à faire deux choses qui ont trop longtemps paru inconciliables : maîtriser son système productif opérationnel, mais aussi connaître parfaitement les aspirations et les pratiques de chaque individu. Les data sont une porte d’entrée vers la compréhension qualitative de la mobilité.
C. G. : Au travers des data, on essaie d’avoir une analyse très fine de l’environnement urbain dans lequel nous opérons. Pour vous donner un exemple : en Île-de-France, nous avons 4 700 bus, 335 lignes, et énormément de sujets compliqués autour de l’utilisation de l’espace public, avec les travaux, le trafic, etc. C’est pourquoi nous avons développé un partenariat avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour organiser les trottoirs. Il s’agit de comprendre comment se forment les nœuds gordiens : ce peut être le passage d’un rond-point avec des problèmes d’emprise liés à des travaux, etc. Avant l’arrivée d’Internet, on prenait des véhicules et on traçait. Aujourd’hui, on a besoin de comprendre ce qui se passe de manière plus fine pour atteindre un certain niveau de performance.
M. L. : C’est certes une formidable opportunité que de pouvoir connecter de l’ethnographie des pratiques à ces data. La seule réserve que j’ai là-dessus, c’est que la puissance donnée par la technologie du big data propose une granulométrie de chaque donnée qui peut descendre à l’échelle individuelle. Cet aspect pose d’énormes problèmes éthiques.
“Si le technosolutionnisme est l’idée que la technologie est autonome, alors je ne suis pas technosolutionniste”
—Michel Lussault
Faut-il se méfier du « solutionnisme technologique », soit l’idée qu’on va tout résoudre par la technologie ?
M. L. : Ce qui est décisif, c’est de ne pas avoir de visée technosolutionniste naïve. Si la technologie impose aux humains des solutions dont ils ne veulent pas, elle ne m’intéresse pas. En réalité, nous avons besoin de composés technologiques, qui vont des technologies élémentaires – la marche à pied – aux technologies les plus sophistiquées – le big data ; qui vont de l’hydrogène à l’utilisation d’autres technologies plus frustes et plus sobres ; qui vont de la mécanique classique des portes aux capteurs. La technologie n’est rien si elle n’est pas intégrée à un système piloté par la capacité de problématisation sociale, la volonté politique et le souci éthique et de justice. Si le technosolutionnisme est l’idée que la technologie est autonome, alors je ne suis pas technosolutionniste.
C. G. : L’entreprise n’est pas hors sol, elle appartient à un écosystème. Une partie de l’amélioration de la performance est endogène à l’entreprise : ce sont nos propres process, ce que vous appeliez la « maîtrise du système productif ». Mais il y a de plus en plus de sujets exogènes, comme l’accumulation de la multimodalité dans un même espace public, créant parfois des zones de danger. Il faut pouvoir mieux appréhender ce caractère exogène pour pouvoir déverrouiller tel ou tel endroit. C’est ce qu’on essaie de faire avec le MIT : avoir des idées d’amélioration qui ne soient pas uniquement tournées vers l’intérieur du fonctionnement de l’entreprise, mais vers son écosystème. La puissance de la data là-dessus est centrale et nous permet de rationaliser la discussion qu’on a avec les partenaires extérieurs, car une discussion plus quantitative permet d’apporter des preuves.
M. L. : La data, vous l’avez dit, permet de prendre en compte l’exogène : bienvenue dans le monde anthropocène, ou dans le monde du changement global ! Aujourd’hui, épistémologiquement, on ne peut plus penser des réalités comme si elles étaient un ensemble isolé du reste. Nous sommes tous obligés, lorsque nous observons une réalité quelconque, d’admettre d’abord qu’il va falloir prendre en compte l’exogène, ce qui lui est extérieur. Et que c’est peut-être même l’exogène qui, dans ses relations à l’intérieur de ce que nous pensons pouvoir maîtriser, va dans une très large mesure orienter ce que l’on peut dire et faire dans ce système fonctionnel. Dans une certaine mesure, les technologies numériques sont des technologies qui nous permettent d’opérer ce trajet de l’exogène à l’endogène et réciproquement.

Michel Lussault © Xavier Schwebel pour Philonomist
De nombreuses voix appellent à une réduction drastique des déplacements comme seul moyen de pallier le réchauffement climatique et de répondre à l’insuffisance des ressources énergétiques. Croyez-vous à la nécessité d’une « démobilité » générale ?
M. L. : En tant que chercheur empirique, je vois venir un monde urbain à dix milliards d’habitants, ce qu’il faut toujours intégrer à la réflexion. On ne va pas demander aux gens de redevenir des piétons localisés dans leur village : c’est insoutenable. Nous aurons toujours besoin des systèmes urbains. Or les organisations urbaines ne fonctionnent pas sans mobilité. Je suis donc pour le maintien des mobilités, et pour qu’il n’y ait pas de contingentement a priori des mobilités.
Mais certaines formes de mobilité doivent être priorisées par rapport à d’autres. Je ne parle pas de démobilisation, mais de ce que j’appellerais une « altermobilité ». Il va falloir réfléchir qualitativement aux différentes formes de mobilité, choisir sur lesquelles nous devons miser pour permettre au droit à la mobilité d’être assumé, et se poser la question de savoir lesquelles sont vraiment indispensables. De mon point de vue, certaines mobilités touristiques dites « low cost » ne sont peut-être pas indispensables. Certaines surmobilités de groupes sociaux, qu’on appelle aujourd’hui les « hyperriches », ne sont pas indispensables non plus.
“Si l’automobile est moins présente, alors on s’apercevra que l’urbain va se déplier d’une tout autre façon”
—Michel Lussault
De même, il faut admettre que l’avenir urbain en période de changement global devrait être un avenir de « désautomobilisation » : il faut sortir de notre dépendance individuelle et collective à l’automobile. Cela pose évidemment d’énormes problèmes politiques, mais cela ouvre des perspectives considérables. Si l’automobile est moins présente, alors on s’apercevra que l’urbain va se déplier d’une tout autre façon. On l’a vécu pendant la pandémie : quand les automobiles se sont arrêtées, on a redécouvert à quel point elles occupaient des espaces que nous pourrions utiliser tout à fait autrement.
C. G. : En tant que présidente du groupe RATP, je suis convaincue que s’il y a une entreprise stratégique pour la réussite de la démarche bas carbone, c’est nous. Nous sommes capables de déplacer des millions d’individus dans des circonstances où l’on évite une emprise excessive sur l’espace public, dans des conditions qui sont meilleures. Nos métros, RER et tramways ne polluent pas, puisqu’ils sont électriques. Une fois les bus convertis, on aura un superbe outil de mobilité avec un très faible taux d’émission de gaz à effet de serre par rapport aux millions de personnes qu’on va déplacer.
Comment préserver l’accès de tous à la mobilité dans ce monde aux ressources limitées ?
M. L. : Certains de mes collègues aujourd’hui proposent des systèmes de droits de mobilité qui soient socialement différenciés et je trouve la perspective intéressante ; elle doit être étudiée sérieusement. Vous l’avez dit tout à l’heure, quand les réseaux de la RATP fonctionnaient pendant la pandémie, c’étaient surtout les groupes sociaux fragiles mais indispensables – les premiers de corvée, les premières lignes – qui devaient bouger. Il faut les accompagner dans un droit à la mobilité qui peut être moins restreint que le droit à la mobilité de celui qui peut se payer son jet privé. Il faut donc aborder cela de façon qualitative.
Je pense que l’avenir est aux transports collectifs et publics, qui permettent justement d’avoir une approche tenant compte de l’exogène, c’est-à-dire qui partent du besoin de mobilité de la personne et qui vont jusqu’à une réflexion sur l’organisation urbaine dans son ensemble. Il s’agit de se demander comment servir le besoin de la personne dans un système urbain qui a désormais des contraintes économiques, sociales et environnementales très fortes. Cela demandera des capacités de définir des voies de passage politique nouvelles et des acteurs impliqués pour des décisions qui remettront en question des habitudes et des routines.
C. G. : Les transports publics ont cette magie d’être nés dans cet écosystème, et de savoir prendre en compte cet écosystème – contrairement à la mobilité automobile, qui est le royaume de l’individualisme (et cela que l’on parle de voitures à moteur thermique ou de voitures électriques). Leur caractère ouvert, à la fois sur leur écosystème, leur caractère inclusif, social, environnemental, la maîtrise de la technologie, des déplacements, tout cela fait que les transports publics cochent toutes ces cases. C’est pourquoi il faut continuer à les développer, et c’est pourquoi la question de leur financement est absolument centrale.