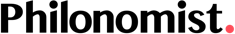Des paresseux, il y en a partout dans le monde du travail, plus ou moins habiles pour déléguer leurs tâches, discrets pour faire oublier leur existence ou philosophes pour justifier leur inaction. L’écrivain Laurent Quintreau nous présente une galerie de ces célèbres oisifs qui ont ponctué l’histoire de la littérature.
Au bureau, il nous est tous arrivé de côtoyer des personnes connues pour leur aptitude à éviter le travail. De nous être laissé bercer par les promesses – jamais tenues – d’un fumiste émérite. D’avoir contrarié l’immobilisme d’un collègue aboulique en lançant de nouveaux projets. Employés, cadres, dirigeants, la paresse n’épargne aucune catégorie sociale et touche la totalité des secteurs d’activité.
Si tout travail est, pour reprendre l’analyse de Hegel, négation de la matière et renoncement à une relation symbiotique avec la nature, la paresse est négation de la négation, et renoncement au renoncement. Au gros travailleur qui répond au devoir, et à la haute idée qu’il se fait de sa mission, le paresseux semble privilégier douceur de vivre et confort personnel immédiat – même si sur une échelle de temps plus longue, son attitude risque de lui être préjudiciable.
Régulièrement stigmatisée par les dirigeants politiques, traquée par des indicateurs de performance de plus en plus précis, ignorée des manuels de développement personnel censés révéler les secrets de la performance et du leadership, la paresse n’a pour autant pas dit son dernier mot. Si l’on en croit la littérature, elle est un invariant du rapport de l’homme au travail avec lequel toute organisation professionnelle doit savoir composer. Le personnage du fainéant, du flemmard, de l’oisif, est en effet présent de longue date dans le roman. Nous renvoyant à notre propre paresse, il nous aide à mieux en comprendre toutes les nuances, les causes possibles et les conséquences prévisibles.
La douceur du farniente
Ivan Gontcharov, Oblomov
Ilia Ilitch Oblomov vient de recevoir la visite de son ami Soudbinski, nouvellement promu chef de service au sein de l’administration impériale russe.
« – Adieu, dit le fonctionnaire. Je me suis attaché à bavarder, si on a besoin de moi là-bas…
– Reste encore un peu, insista Oblomov. Je voudrais profiter de cette occasion pour te demander un conseil : j’ai deux malheurs…
– Non, non, je repasserai un de ces jours, dit Soudbinski. Et il s’en alla.
“Te voilà enchaîné, mon pauvre ami, enchaîné jusqu’aux oreilles”, songea Oblomov en le suivant des yeux. “Et comme il est aveugle et sourd à tout ce qui se passe dans le monde ! Mais il arrivera, il brassera de grandes affaires, et il récoltera tous les grades… Chez nous, on appelle cela : faire carrière. La volonté, l’intelligence, les sentiments, à quoi bon ? Et avec ça il travaille, travaille, de midi à cinq heures au bureau, et de huit heures à minuit chez lui !”
Oblomov éprouvait une joie paisible à l’idée que de neuf heures à trois heures, et de huit à neuf, il pouvait rester étendu sur son divan, et il s’enorgueillissait de n’avoir pas de dossiers à présenter, de documents à rédiger ; bref, de pouvoir donner libre cours à ses sentiments et son imagination. »
Ivan Gontcharov, Oblomov (1859, trad. Gallimard, 2007)
Si l’on devait établir un classement des personnages littéraires les plus paresseux, nul doute qu’Oblomov figurerait sur la première marche du podium. Car l’activité favorite – et l’unique ambition – de ce propriétaire terrien de Saint-Pétersbourg est le repos. Passant le plus clair de son temps à se prélasser dans son « bien-aimé divan », il n’a qu’un seul désir lorsqu’une affaire urgente le porte à l’extérieur : le retrouver. Mais les vicissitudes économiques, les ambitions intempestives, les aléas politiques planent comme autant de dangers sur cette existence paisible, presque végétative. Aussi Oblomov considère-t-il l’avancement de son ami Soudbinski, en passe de devenir conseiller d’État à la cour impériale, comme la pire chose qui pourrait lui arriver. Paresseux hors norme, Oblomov tend à l’aristocratie désoeuvrée d’avant la révolution bolchevique un miroir si fidèle et si grossissant que l’on a parlé d’oblovisme – comme en France on parle déjà de donjuanisme, et bientôt de bovarysme. Montrant une forme de détachement qui pourrait le rapprocher de l’oisiveté chère aux philosophes antiques – la skholè grecque ou l’otium romain –, Oblomov s’en éloigne par son inertie et sa passivité physique. Si l’idéal de vie préconisé par Sénèque, en effet, suppose de se déprendre des affaires économiques et des passions en général, c’est pour mener à l’exercice des choses les plus hautes de l’esprit. Et non pour fusionner avec la matière inerte d’un divan.
L’oisiveté malheureuse
Émile Zola, La Joie de vivre
Fils unique de la famille Chanteau – dont le roman narre le naufrage –, le jeune Lazare se projette dans mille projets qu’il abandonne aussitôt.
« Bien qu’il ne fît rien, la nouvelle passion dont il était envahi, semblait l’occuper au-delà de son temps et de ses forc
(sans coordonnées bancaires)
Accédez gratuitement à l'intégralité du site.
Votre entreprise vous a abonné(e) à Philonomist ?
Cliquez sur le bouton ci-dessous.