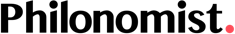Le mouvement pour la neurodiversité nous invite à accueillir toutes sortes de profils atypiques (ou divergents) sur le lieu de travail, des gens sur le spectre de l’autisme à ceux qui souffrent de TDAH ou d’hypersensibilité… Et tant mieux. Mais qui au juste entre dans les cases de ce nouvel esprit de tolérance, et pourquoi ? Et ne faut-il pas remettre en cause la notion même de « neurotypique » pour étendre notre tolérance à tous, avec ou sans étiquette ?
Voyez cet article comme un « safe space » dans lequel nous mènerons librement une petite expérience de pensée, sans jugement moral. Maintenant, pensez à quelqu’un de votre entourage – disons un proche ou un collègue – que vous ne supportez pas. Pour ce que vous en savez, il n’a pas de maladie, pas de diagnostic d’un quelconque trouble ; simplement, vous trouvez qu’il se la raconte, qu’il est trop asocial, qu’il a l’esprit étriqué ou même qu’il est tout bonnement méchant. Certains sont d’accord avec vous, et tous ensemble vous lui cassez du sucre sur le dos. De votre côté, peut-être êtes-vous un ours mal léché aux yeux d’autres collègues, et d’ailleurs vos oreilles sifflent en ce moment même ! Mais je digresse.
Maintenant, imaginez que la personne à laquelle vous pensez entre un jour dans le bureau et déclare qu’on vient de lui diagnostiquer un certain trouble qui explique les traits de caractère qui vous tapent sur les nerfs. La comptable revêche a découvert qu’elle est hypersensible ; le manager rigide vient d’apprendre qu’il est sur le spectre… Voilà qu’ils grossissent désormais les rangs des neurodivergents : leur cerveau ne fonctionne pas comme celui de la plupart des gens, et ils n’y peuvent rien. Continuerez-vous à les critiquer ou à les juger responsables de leurs manières ? Et si non, pourquoi ?
“Les étiquettes entraînent une différence saisissante dans la manière dont nous nous traitons”
Qui est vraiment « normal » ?
Ce scénario imaginaire permet de mettre en relief la différence saisissante que ce genre d’étiquettes entraîne dans la manière dont nous nous traitons les uns les autres, en raison d’une dichotomie morale implicite. D’un côté, il y a des gens qui ont un trouble – un handicap ou juste « un certain type de cerveau », d’après la définition que le Cambridge Dictionary donne de la neurodivergence – lequel conditionne leurs capacités et leur comportement. Et puis il y a les autres : les gens normaux, pour le dire crûment, ou, pour reprendre le langage de la neurodiversité, les gens « neurotypiques ». Par définition, puisque ceux-là n’ont pas de trouble connu, cela implique qu’ils sont en contrôle d’eux-mêmes et donc responsables de leur comportement et de leurs capacités (ou de leur manque de capacités). Et donc, on peut ricaner derrière le dos du responsable informatique qui ne supporte pas la moindre moquerie ou dire du mal du boss qui s’entête à micromanager son équipe. Tant qu’ils ne sont pas diagnostiqués TDAH ou ADHS, c’est de bonne guerre.
Mais examinons de plus près cette dichotomie. Ce collègue ou cette connaissance qui vous enquiquine : la décririez-vous vraiment comme normale, ou typique ? Je me souviens d’un ancien collègue aux yeux bleus qui me fixait d’un air fasciné, un sourire plaqué sur le visage et sans battre des paupières, quand je lui parlais… Aujourd’hui encore, je le placerais sur le spectre de la psychopathie, si une telle chose existe (et si ça n’est pas le cas, il faudrait peut-être l’inventer). A minima, je dirais qu’il occupait la zone tampon entre le pays des gens normaux et le territoire de Hannibal Lecter.
Le syndrome Dwight Schrute
La série The Office est pleine de personnages de ce genre. Comme Michael Scott (Steve Carrell), le manager hyperactif en recherche permanente d’attention, imperméable aux conventions sociales ; ou Dwight Schrute (Rainn Wilson), son assistant nerd hyperzélé, prêt à tout pour maintenir l’ordre. Sont-ils neurotypiques ? Peut-être, par défaut, les scénaristes n’ayant jamais indiqué le contraire, mais alors de justesse. En préparant cet article, je me suis laissé aspirer par des forums où l’on débat sans fin de leurs troubles respectifs. Pour certains, Scott montre tous les signes de TPH (trouble de la personnalité histrionique) tandis que Schrute souffre soit de TPP (trouble de la personnalité paranoïaque), soit de TSA (trouble du spectre de l’autisme). La liste des acronymes s’allonge à mesure que les fans discutent des autres membres de l’équipe, de la comptable pète-sec Angela Martin (Angela Kinsey), sûrement affectée d’un TOC (trouble obsessionnel compulsif) au vendeur puéril Andy Bernard (Ed Helms), à qui sont attribuées toutes sortes d’étiquettes, de TDI (trouble dissociatif de l’identité) à TEI (trouble explosif intermittent), voire des lésions cérébrales dues à un mélange d’alcool et d’hippocampe en poudre…
“Les œuvres de fiction pourraient contribuer à rejeter une normalité fantasmée”
Mais si ces théories sont amusantes, affubler ces personnages de troubles labellisés, c’est rater tout le propos de The Office, car la magie de cette série réside justement dans la célébration de ces excentricités et de ces idiosyncrasies, qui sont à la fois risibles et attachantes. Et en tendant vers nous ce miroir, les comédies qui se déroulent sur un lieu de travail comme The Office – et celles qui ont surgi dans la foulée, comme Parks & Recreations ou Community – nous suggèrent d’accepter en riant les cinglés que nous sommes tous au fond.
Après tout, c’est bien le pouvoir d’une bonne histoire, ou de « l’imagination narrative » défendue par la philosophe Martha Nussbaum. « J’entends par là la capacité à imaginer l’effet que cela fait d'être à la place d’un autre, à interpréter intelligemment l’histoire de cette personne, à comprendre les émotions, les souhaits et les désirs qu’elle peut avoir » (Les Émotions démocratiques. Comment former le citoyen du XXIe siècle, Flammarion, 2011) Alors que les œuvres de fiction nous ont aidés à opérer le basculement émotionnel du dégoût à l’empathie, ce qui nous conduit aujourd’hui à mieux traiter un nombre croissant de minorités, elles pourraient maintenant contribuer à rejeter une normalité fantasmée sous prétexte qu’une poignée de gens dans le camp majoritaire sont toujours privés de l’empathie dont ils devraient faire preuve.
En quête de normes
Le nombre de Dwight Schrute et de Michael Scott que nous rencontrons dans notre vie laisse entendre que notre ségrégation morale spontanée entre typiques et atypiques pourrait bien avoir quelque chose d’arbitraire, de même que cette distinction conceptuelle elle-même. Les définitions de ces concepts sont d’ailleurs souvent circulaires, comme le montrent celles du Cambridge Dictionary pour « neurodivergent » – « lié à un type de cerveau souvent considéré comme différent de la norme » –, et « neurotypique » – « non associé à un trouble du cerveau […] souvent considéré comme différent de la norme ». Ainsi donc, le neurodivergent est celui qui n’est pas neurotypique et vice versa. On ne voit pas quelle substance il y a derrière cette distinction.
“Les traits autistiques sont distribués normalement à toute la population humaine, de même que les traits TDAH”
—Ginny Russel, sociologue
Et ce n’est guère surprenant, car les catégories de neurodivergence, loin d’être des réalités binaires, sont en réalité des constructions psychiatriques relatives à une série de traits de caractère sur un spectre. « Ces traits s’étendent à la population infraclinique, c’est-à-dire que de nombreuses personnes qui n’ont pas de diagnostic d’autisme ont des traits autistiques, explique la sociologue Ginny Russel dans sa contribution au livre Autistic Community and the Diversity Movement (Palgrave Macmillan, 2020). C’est ce que les chercheurs appellent le “phénotype élargi de l’autisme”. Cela signifie qu’il n’existe pas de distribution bimodale claire séparant les gens avec et sans autisme, si bien qu’il n’y a pas deux populations distinctes, l’une “neurotypique” et l’autre “neurodivergente”. En fait, les traits autistiques sont distribués normalement à toute la population humaine, de même que les traits TDAH. »
Une autre raison de remettre en question cette ségrégation morale nous est fournie par la critique de ce qu’on comprend en général du conditionnement et de la responsabilité. Que les neurodivergents ne puissent rien changer à leur comportement est impliqué par le préfixe même du terme : ils sont littéralement conditionnés par leur cerveau. Mais à l’ère des neurosciences, c’est notre cas à tous : « nous sommes notre cerveau », comme le proclame le titre de l’ouvrage de Dick Swaab publié en 2010. Et quand bien même nous ne serions pas conditionnés par notre cerveau, nous le serions au moins en partie par notre éducation, notre passé, nos origines sociales ou les événements spécifiques que nous avons vécus.
Ici encore, l’imagination morale de Nussbaum peut nous aider à éclairer d’une lumière bienveillante les particularités des autres. La prochaine fois que vous trouverez quelqu’un intrinsèquement désagréable, imaginez-lui une vie, une histoire, qui expliquerait son attitude, et voyez si vous ressentez toujours la même chose ensuite. Encore mieux, essayez petit à petit d’en savoir plus sur sa vie, son histoire, au détour d’un café ou d’une pause déjeuner…
“Ces notions sont dénoncées comme une distraction alors que les malades atteints de vraies déficiences ont des besoins pressants”
Par-delà la dualité
La confusion qui règne autour de cette dichotomie typique-atypique est l’une des raisons qui explique pourquoi le modèle de la neurodiversité a été remis en question ces dernières années. Ces notions trop générales sont dénoncées par beaucoup comme une distraction alors que les malades atteints de vraies déficiences ont des besoins pressants et que le modèle médical du handicap est plus adapté pour les identifier et les traiter.
D’autres affirment au contraire que cette confusion est une raison de plus pour ouvrir davantage encore le modèle. Comme Sharon Davenport, fondatrice de l’Autistic Women and Non-Binary Network (AWN), pour qui c’est « quelque chose que je comprenais intimement comme l’acceptation inclusive de toute différence neurologique sans exception », ajoutant : « J’en suis venue à considérer que la neurodiversité ne laisse personne au bord de la route. » (Autistic Community and the Neurodiversity Movement).
Ces deux réponses au problème – élargir la neurodiversité pour y inclure tout le monde ou la réduire aux handicaps cliniques – ne s’opposent pas forcément l’une à l’autre. On peut concevoir des politiques ciblées pour aider ceux qui ont des handicaps tout en aspirant à cette bienveillance générale que visent les promoteurs de la neurodiversité.
“Le mouvement pour la diversité semble plaider pour une vision de l’homme hors des classifications scientifiques”
Quand je pense à mon ancien collègue au sourire reptilien, je peux m’émerveiller de son détachement presque irréel et me dire qu’après tout, ce n’est pas si grave d’avoir un vague côté Hannibal Lecter. D’ailleurs, sans le cannibalisme non consenti, Hannibal Lecter ferait sans doute un collègue charmant ! Et même si ce n’était pas le cas, il serait tout de même digne de compassion et de dignité rien que pour notre humanité partagée.
Dans son effort louable pour surmonter la vision du monde segmentée inhérente aux politiques identitaires – avec les économies d’empathie qui en découlent, les supposés privilégiés n’y ayant pas droit –, le mouvement pour la diversité semble plaider, au-delà de son sujet propre, pour une vision de l’homme hors des divisions induites par les classifications scientifiques. Un chrétien parlerait de l’agapè, l’amour inconditionnel de tous les hommes, y compris de ses ennemis (Luc 6:27) ; un bouddhiste, lui, de metta, ou bienveillance ; et l’hindou d’atmaivaabhut, mon préféré : c’est l’empathie que nous ressentons lorsque nous voyons en l’autre la même âme qui réside en nous tous (Yajur-Véda, 40.6). Tous portent le même idéal éternel qui manque cruellement aux modèles scientifiques actuels : celui du souci inconditionnel de l’autre.