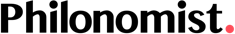Juin, c’est le mois des fiertés. Mis à part que votre comité d’entreprise a installé un drapeau arc-en-ciel dans le hall d’entrée, vous ne voyez pas trop de quoi il s’agit ? Hétéronormativité, dysphorie de genre, asexualité, allié : tous ces termes vous passent au-dessus de la tête ? Ce glossaire philosophique est fait pour vous. De quoi éclairer et approfondir certains débats contemporains difficiles à comprendre pour les néophytes !
Allié
Nous sommes en juin, « mois des fiertés », et votre entreprise a mis à disposition de ses salariés des petits pin’s arc-en-ciel floqués de l’inscription « being a good ally » : « être un bon allié ». Si vous pensez immédiatement à la Seconde Guerre mondiale, détrompez-vous. Le terme d’« allié » a été revendiqué dès les années 1970 par des associations américaines rassemblant des parents de personnes homosexuelles souhaitant combattre à leurs côtés. Dans le langage des militants LGBT+, mais aussi féministes et antiracistes, l’allié est l’individu qui, sans subir le même genre d’oppression qu’un autre, prend part aux mêmes engagements en faveur de l’égalité.
Mais attention : il y a les « bons » alliés et les « mauvais ». Selon l’association féministe et antiraciste Lallab, par exemple, qui édite ses « 11 conseils pour être un.e bon.ne allié.e », il est recommandé de « ne pas monopoliser l’énergie et la force mentale ». Être un bon allié, c’est manifester sa solidarité tout en rappelant que sa situation reste extérieure à celle du groupe visé – ne pas parler au nom des gens qu’on soutient, éviter de trop s’exprimer en son nom propre… bref, ne pas trop l’ouvrir. Un bon allié est celui qui reconnaît que quel que soit son engagement et sa bonne volonté, il lui est impossible de ressentir dans sa chair ce que subissent les personnes dont elle est solidaire.
“Ici, l’empathie est présentée comme insuffisante pour fonder une véritable solidarité”
Derrière cette séparation entre les alliés d’un côté et les opprimés de l’autre, il y a l’idée que leurs expériences seraient irréductiblement différentes. Ici, l’empathie est présentée comme insuffisante pour fonder une véritable solidarité. Pourtant, l’empathie est souvent louée comme une valeur humaine forte, qui nous lie les uns aux autres. Déjà au XVIIIe siècle, David Hume, dans son Enquête sur l’entendement humain (1748), notait que tous les êtres humains étaient dotés de cette propension spontanée, irrésistible, à ressentir à l’intérieur d’eux-mêmes ce qu’ils voient se produire chez ceux qui leur ressemblent.
Oui, mais il y a un hic... Cette faculté naturelle à nous mettre à la place des autres n’a rien d’universel et se construit sur un biais finalement assez égoïste : pour Hume, plus une personne est éloignée de moi dans le temps ou l’espace, moins elle a de points communs avec moi, et moins j’aurai d’empathie pour elle. L’empathie, basée sur ce processus d’identification à géométrie variable, peut conduire à surévaluer les ressemblances et ignorer ce qui me différencie d’autrui. Exemple ? Votre cheffe qui répète qu’elle comprend les souffrances des personnes homosexuelles parce qu’elle-même a embrassé sa cousine Chantal quand elle avait 18 ans. Maladroit, non ?
Le souci, c’est que la solidarité rationnelle, qui cherche à éviter les biais de l’empathie, est un pur accord de principe désincarné. De ce fait, elle a peu de chances de réellement entrer dans des habitudes de langage ou de pousser des individus à changer. Arborer un pin’s et souscrire théoriquement à toutes les exigences des militants peut être une manière d’afficher un soutien de façade, sans s’émouvoir plus avant de la discrimination ni chercher à la comprendre.
Hume donne peut-être une solution lorsqu’il propose la notion de bienveillance, qu’il pense comme un correctif à l’empathie. La bienveillance, c’est une forme d’empathie rationnelle qui permet à l’individu de se reconnaître dans la souffrance ou la joie humaine, même éloignée de lui-même. Pour cela, il mobilise une certaine représentation imaginaire, rationnelle, de la dignité humaine en général, en s’extrayant de son expérience personnelle. Peut-être qu’au lieu d’arborer un pin’s et de claironner son soutien, votre cheffe pourrait lire les écrits fondateurs des écrivains LGBT+, afin de sortir d’elle-même, d’accéder à une expérience du monde qui lui est en partie étrangère, et qui sait ? D’y trouver une place.
Asexualité
Alma est arrivée en retard et échevelée au travail. Une de ses amies du bureau lui fait un clin d’œil suggérant qu’elle a dû faire des folies sur l’oreiller au réveil, avant de renchérir : « Au moins les asexuels comme moi, on est toujours à l’heure ! » Asexuel ? C’est une nouvelle nationalité, ce truc ? Eh non ! L’élément commun aux personnes se présentant comme asexuelles est qu’elles ne ressentent pas de désir sexuel pour autrui. La visibilité de l’asexualité vient aussi de l’engagement de personnes asexuelles au sein des communautés LGBT+ (c’est le « a » de LGBTQIA, version longue de l’abréviation). Plusieurs militants ont à cœur de faire reconnaître leur asexualité comme une orientation sexuelle qui n’est pas dans la norme, dans la mesure où elle ne répond pas à l’injonction dominante de notre société hypersexualisée. En effet, de nombreux asexuels, se sentant exclus, sont ainsi contraints de faire l’amour pour nouer des relations amoureuses ou pour ne pas passer pour « frigides ».
Cette revendication fait débat. Si l’Association américaine de psychiatrie a, en 2013, bien reconnu l’asexualité comme une orientation sexuelle à part entière, certains militants LGBT+ comme le journaliste américain Dan Savage comprennent mal la participation d’asexuels aux marches des fiertés. Leur argument ? L’asexualité est précisément une absence de sexualité : il y aurait là une contradiction. À cela s’ajoute le fait que l’asexualité n’a jamais été déclarée illégale et peut plus facilement rester tue. Il est plutôt rare d’entendre des récits de personnes discriminées à l’embauche ou agressées dans la rue à cause de leur asexualité !
“La visibilité grandissante de l’asexualité n’a-t-elle pas partie liée avec une certaine lassitude relative à l’omniprésence du sexe dans nos sociétés ?”
L’asexualité soulève cependant une question : sa visibilité grandissante n’a-t-elle pas partie liée avec une certaine lassitude relative à la place du sexe dans notre société ? Son omniprésence dans notre environnement culturel ainsi que dans nos conversations pousserait presque à affirmer, dans le sillage de l’ouvrage Le Nouveau Désordre amoureux (Seuil, 1977) de Pascal Bruckner et d’Alain Finkielkraut, que la révolution sexuelle n’a pas eu lieu : loin d’avoir libéré la sexualité, ce mouvement nous aurait enchaînés à la sexualisation de nos vies.
Il n’est pas inutile de rappeler que les asexuels vivent bien des relations amoureuses. Ils posent une distinction entre une attirance sexuelle et une attirance qu’ils disent « romantique ». Les asexuels peuvent ainsi se qualifier d’« hétéroromantiques » ou d’« homoromantiques ». Cette non-coïncidence du désir avec la pratique sexuelle n’est pas sans rappeler ce que Lacan dit de la satisfaction sexuelle, tempérant le propos freudien qui tend à réduire l’ensemble de l’activité humaine à une pulsion libidinale. La philosophe lacanienne Alenka Zupančič défend dans son livre Qu’est-ce-que le sexe ? (Presses du réel, 2019) que la satisfaction sexuelle se retrouve aussi bien dans l’acte sexuel que dans une série de pratiques comme la parole, la peinture, la création qui toutes recoupent un moment de décharge, de communion et de communication.
L’asexualité ne signifie ainsi pas absence de désir ou d’attraction en dehors du sexe, au contraire. Il se pourrait qu’elle trouve, dans les marges d’une société hypersexualisée, une autre manière d’interroger et d’interpréter le désir. Et ainsi réinventer l’amour, comme le programmait le poète Rimbaud ?
Dysphorie de genre
Vous venez d’apprendre que Noé, le stagiaire, a fait son coming-out trans. Votre collègue Valentin se réjouit : ça se voyait, il était mal à l’aise depuis des mois, fuyant les regards et se cachant sous des vêtements XXL. « On sentait qu’il souffrait de cette dysphorie de genre », ajoute-t-il benoîtement en finissant son taboulé. « Une dyspho-quoi ? » : vous ne l’avez pas dit, mais vous l’avez pensé très fort.
Rien de bien sorcier. La dysphorie de genre est une notion médicale qui désigne la détresse que peuvent ressentir les personnes transgenres face au sentiment de l’inadéquation entre le genre qui leur a été assigné à la naissance et leur identité de genre. La notion, forgée à partir d’un alliage du préfixe grec « dys » signifiant la négation ou la difficulté, ainsi que du verbe « phorein » signifiant porter, pourrait se traduire littéralement par « difficulté à supporter son genre ». La dysphorie de genre est en effet souvent décrite comme la conséquence d’une naissance « dans le mauvais corps », et peut se manifester par des comportements violents et autodestructeurs.
On peut rapprocher la dysphorie de genre de certaines analyses que fait Sartre du malaise existentiel qui prend Roquentin, le héros de son roman dans La Nausée (1938). Roquentin réalise que son corps est proprement contingent, qu’il est aussi fugace et fragile que n’importe quel objet en trois dimensions. Son vertige nauséeux lui vient d’un écart irréductible entre son intériorité et son corps, devenu aussi étranger que la banquette du bus sur laquelle il est assis. Mais se pose alors la question de savoir quelle est la différence entre un vécu partagé par beaucoup de personnes – qui n’a jamais été mal dans sa peau, au fond ? – et un vécu propre aux personnes trans. En effet, on peut se demander où s’arrête la dysphorie « existentielle » telle que peut la décrire Sartre, et la dysphorie « de genre ».
“L’important n’est pas ce que l’on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-même de ce qu’on a fait de nous”
—Jean-Paul Sartre
Dans la dysphorie de genre, la souffrance provient précisément d’un pareil écart entre le corps avec lequel je suis né, et le genre auquel je m’identifie. Chez Sartre, la liberté apparaît lorsqu’on comprend qu’on peut se détacher des objets qui nous entourent et assumer une existence propre. Ici, ce n’est pas des objets que la personne trans se détache, mais d’une partie d’elle-même. Tout se passe comme si la personne trans avait juste assez de liberté pour ne plus reconnaître comme sien le corps qui lui a été attribué, avec ses trophées charnels encombrants – seins, poils, pénis, hanches… – et les normes sociales qui vont avec, sans pour autant pouvoir en changer si facilement. Changer de genre devient un choix nécessaire, qui fait souffrir dans la mesure où il bute sur une série d’obstacles intimes ou sociaux.
Loin de se déterminer dans un genre, les personnes transgenres souhaitent seulement vivre de la seule manière qu’il leur est possible de vivre, c’est-à-dire selon l’orientation de genre qui les anime. Dans Saint Genet, comédien et martyr (1952), Sartre déclare que « l’important n’est pas ce que l’on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-même de ce qu’on a fait de nous ». Sortir de la dysphorie de genre, et donc de la souffrance, peut passer par une transformation du corps, via l’attitude, l’habillement, le maquillage, voire parfois, des opérations chirurgicales.
Féminisme différentialiste VS universaliste
Vous êtes féministe, mais un peu pris en tenaille. Vos deux meilleures amies débattent à longueur de journée : l’une défend bec et ongles l’idée d’une différence féminine, s’appuyant souvent sur des caractéristiques propres aux femmes ; l’autre considère que si des différences sont généralement observables entre les femmes et les hommes, l’humanité qui leur est commune l’emporte et invite à modérer l’argument d’une différence féminine dans l’engagement féministe. Bref, vous êtes coincé entre deux écoles, deux visions radicalement différentes du féminisme : le différentialisme et l’universalisme. Le sujet du débat est donc de déterminer si la revendication d’une différence est un bon moyen d’atteindre l’égalité réelle.
“On ne naît pas femme : on le devient”
—Simone de Beauvoir
Sur le ring de boxe, nous avons à gauche le féminisme universaliste qui repose sur l’idéal de liberté, sur la morale républicaine héritée du siècle des Lumières. Les femmes ne seraient pas radicalement différentes des hommes, et pourraient aspirer à la même émancipation. « On ne naît pas femme : on le devient », disait Simone de Beauvoir pour nommer ce refus de désigner une essence féminine. Ce refus visait à combattre l’assignation des femmes à un rôle subalterne à celui des hommes au nom de leurs différences. Autre caractéristique du féminisme universaliste : ne pas restreindre la réflexion et l’engagement féministe aux principales concernées (les femmes) au nom de l’égale dignité de tous les êtres humains, tous disposés à l’émancipation. Le féminisme, sous cet angle, serait un combat universel, transcendant les différences culturelles.
À la droite du ring, revendiquant une différence essentielle entre les femmes et les hommes, nous avons les féministes différentialistes qui défendent l’idée selon laquelle des qualités exclusivement féminines (compassion, sensibilité...) pourraient exister. D’un côté des métiers d’hommes, de l’autre des métiers de femmes ; d’un côté, une rationalité comprise comme une fausse neutralité, en réalité masculine, et de l’autre, une sensibilité, une douceur, un sens de l’empathie propres aux femmes qui devraient être revendiqués comme tels. Ce que les féministes universalistes présentent comme un idéal d’émancipation commun ne serait en fait qu’une philosophie masculine. Les femmes, pour véritablement s’émanciper, devraient renoncer à rentrer dans les cases d’un universalisme masculin. Au double risque d’essentialiser les femmes et de créer des droits différenciés ?
Ceci dit, des postures médianes existent. Ainsi, la philosophe Camille Froidevaux-Metterie défend la nécessité de penser la sexuation des corps des femmes, sans renoncer pour autant à l’idéal universaliste d’un monde dénué de discriminations de genre. Dans Le Corps des femmes. La bataille de l’intime (Philosophie magazine éditeur, 2018), elle entreprend de tracer les « contours des corps féminins », « de la puberté à la ménopause, en passant par une éventuelle grossesse », autant d’éléments survolés par un universalisme aveugle et un différentialisme borné. De quoi relancer le match ?
Hétéronormativité
« Alors, tu pars avec qui cet été ? Ta copine ? — Euh non, mon copain. » Un ange passe entre deux gorgées de café. Vous venez de tomber dans le piège de l’hétéronormativité en supposant par défaut que la dernière recrue de votre équipe était, comme vous, hétérosexuelle. Rassurez-vous, vous n’êtes pas un cas isolé. En fait, c’est une grande partie de notre organisation sociale, politique et sanitaire qui est entièrement construite par et pour les hétérosexuels.
La force de l’hétéronormativité, c’est qu’elle se présente comme « un discours culturel hégémonique fondé sur les structures binaires qui se font passer pour le langage de la rationalité universelle » (Judith Butler, Trouble dans le genre, La Découverte, 2005). Ce concept a été déployé à partir des travaux de Gayle Rubin, une anthropologue et militante féministe américaine qui s’est penchée sur la manière dont la sexualité était perçue dans la société. Elle soutient que nos sociétés opèrent une hiérarchisation sexuelle complexe, qui exclut par définition tout un pan de la population. Elle relève plusieurs critères qui définissent une sexualité « normale » : hétérosexuelle, conjugale, monogame, procréatrice, elle s’exerce en privé, entre personnes du même âge, sans pornographie ou sextoys, etc. Gare à qui transgresse ces règles ! Il bascule alors immédiatement du « mauvais » côté de la sexualité.
La dénonciation de l’hétéronormativité n’a cependant pas pour corollaire d’instituer l’exception en règle ! Dans Le Normal et le Pathologique (Puf, 1966), le philosophe français Georges Canguilhem distingue l’anormal de l’anomal : « En toute rigueur sémantique anomalie désigne un fait, c’est un terme descriptif, alors que anormal implique référence à une valeur, c’est un terme appréciatif, normatif ». Et en l’occurrence, le plus souvent dépréciatif. Alors oui, en effet, il existe en moyenne moins de personnes homosexuelles, par exemple, que de personnes hétérosexuelles. Mais pour éviter que l’écart normatif ne supplante ce seul écart statistique, il est nécessaire de faire disparaître l’idée qu’il y aurait une sexualité normale et une sexualité réservée aux marginaux. Jusqu’à tourner sept fois sa langue dans sa bouche ?