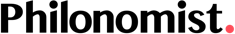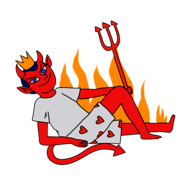Face à l’urgence climatique, il va falloir apprendre à renoncer : à cette nouvelle piscine superflue, au développement d’objets connectés, à certains investissements… Pour que ce renoncement ne s’apparente ni à un sacrifice, ni à un antimodernisme sommaire, le chercheur Alexandre Monnin plaide pour une « redirection écologique ». Comment déterminer les technologies à abandonner ? Les infrastructures néfastes dont il faut se séparer ? Il trace pour nous quelques lignes d’action.
Propos recueillis par Athénaïs Gagey.
Qu’est-ce que le renoncement ?
Alexandre Monnin : Aujourd’hui une entreprise souhaitant verdir son activité cherche à en limiter l’impact, en réalisant des gains d’efficience. Pour produire du chocolat en grande quantité, par exemple, il faut déforester. Certains vont chercher à déforester le moins possible, ou à compenser les externalités négatives de l’activité, en agissant une fois les dommages commis. Mais pourquoi chercher à rendre efficiente une activité qui a pour condition la déforestation ? On joue sur le volet tactique, et non sur le volet stratégique. Pourtant il va bien falloir questionner la finalité de nos activités. C’est tout l’enjeu du renoncement : travailler démocratiquement à fermer et rediriger certaines activités.
N’a-t-on pas déjà commencé à renoncer ?
Oui, mais pas de manière cohérente, concertée et démocratique. Le grand virage énergétique dans le sillage de la guerre russe en Ukraine relevait moins du renoncement anticipé que de la gestion de crise. En fait, il y a toujours eu des fermetures, qui n’étaient pas des renoncements concertés. On a bien désindustrialisé dès les années 1980... pour délocaliser ! Et puis maintenant, on veut relocaliser. Certaines fermetures renforcent le statu quo, très à distance des préoccupations environnementales.
Cela étant, les exemples de renoncement se multiplient déjà : la construction neuve dans le pays de Fayence (Var) à cause du manque d’eau ; un projet de golf dans l’Hérault ; au niveau européen, on renonce aux moteurs thermiques ; pour faire face à la crise de l’azote qui dure depuis plusieurs années, les Pays-Bas ont décidé de renoncer à une partie de leur cheptel… On n’est qu’au début du renoncement : il faut le réaliser et sortir du registre de la gestion de crise et de l’exceptionnalité pour politiser ces questions.
Aux externalités négatives, qui désignent les conséquences négatives attachées à une activité économique qu’il faudrait venir compenser, vous opposez la notion de « communs négatifs ».
Les « communs négatifs » désignent tous les héritages qui dégradent les conditions d’habitabilité de la Terre, et qu’il faut prendre en charge collectivement – exactement comme on gère ensemble les biens communs tels que l’air, l’eau, etc. Ce peut être des réalités physiques, comme les infrastructures et les usines, ou des héritages théoriques et culturels tels que les modèles managériaux et organisationnels actuels. Avec cette notion, j’insiste sur le fait que les externalités ne sont pas des conséquences fortuites, mais les conditions de possibilité d’activités problématiques dont il faut changer la trajectoire.
“Les externalités négatives ne sont pas des conséquences fortuites, mais les conditions de possibilité d'activités problématiques”
Comment décide-t-on de ce qu’est un commun négatif ?
Ce n’est pas une catégorie ontologique : rien n’est intrinsèquement un commun négatif. C’est par le travail d’enquête que l’on détermine ce qu’il faut fermer, démanteler ou réaffecter. Bien souvent, d’ailleurs, ces enquêtes aboutissent à des diagnostics complexes.
Contrairement aux grands récits ontologiques qui restent campés sur leurs positions, l’enquête admet toujours des zones grises, des enjeux intriqués… On peut être contre les mégabassines par principe, mais il faut se pencher sérieusement sur la question pour prendre partie et réaliser l’ampleur de la tâche qui nous attend – s’y opposer signifie remettre en cause l’agriculture industrielle, etc.
Que faire alors de ces diagnostics ambigus ?
Ils n’empêchent pas de faire des choix engagés ! D’où le besoin de protocoles d’arbitrage. Le cas des mégabassines, là encore, est révélateur : aux alertes de la société civile a suivi un affrontement sans échappatoire. C’est une entrée technique qui ouvre à des questions beaucoup plus larges : on a besoin d’institutions qui confrontent ces alertes civiles à des contre-expertises. C’est parce qu’on n’a pas de protocole d’arbitrage que le débat stagne et se brutalise.
Le débat autour de la 5G est aussi parlant. Des salariés d’Orange avaient publié en interne des rapports qui n’étaient pas favorables à ce protocole, pour des raisons tant environnementales que de rentabilité. Finalement, c’est le président Macron qui a tranché : pourquoi lui ? Le renoncement doit toujours être le fruit d’enquêtes collectives et démocratiques avec les acteurs locaux, plutôt que de simples consultations.
Concrètement, la technologie est-elle toujours un commun négatif ?
Les technologies qui reposent sur des ressources non renouvelables et vivent longtemps à l’état de déchet sont problématiques. Le physicien belge José Halloy les appelle « technologies zombies » : sans avenir, elles n’arrivent pas à mourir parce que les déchets ne peuvent pas être compostés, ni digérés dans les grands cycles biogéochimiques. Seulement, on s’est tellement attaché à ces « zombies » qu’on ne peut plus tout jeter. Il faut donc identifier ceux qu’on veut conserver, pour arrondir le passage vers la soutenabilité forte. Sans doute renoncer au SUV électrique, et se tourner vers la voiture électrique, moins zombie que la voiture thermique, le temps de détricoter notre système de mobilité qui tourne trop exclusivement autour de l’automobile.
À l’inverse, on ne peut pas balayer la difficulté de la tâche d’un revers de main. En 2020, l’Azerbaïdjan remporte la guerre contre l’Arménie, notamment grâce à ses drones qui ont détruit les installations antiaériennes arméniennes. On ne sort pas aisément de la course aux armements. Ce qui mérite d’être intégré dans la planification du renoncement. Il faudra certainement à l’avenir prendre en compte la nécessité d’arbitrer entre des usages grands publics et des usages souverains de la technologie, et renoncer à certains acquis de la société civile – qui découlent historiquement d’une diffusion des technologies militaires.
“Le temps qu’une innovation soit conçue et industrialisée, elle est parfois déjà anachronique”
Certaines technologies sont déjà zombies avant même d’être créées et commercialisées, écrivez-vous.
Ma trajectoire de recherche m’a fait réaliser l’existence de ce que j’ai appelé des « futurs obsolètes » : le temps qu’une innovation soit conçue et industrialisée, elle est parfois déjà anachronique en arrivant sur le marché. Dans les laboratoires, on ne sait pas renoncer à un projet. Or, il est bien plus difficile de se débarrasser d’innovations après leur commercialisation.
Exemple : les objets connectés. On se prépare à l’arrivée de plusieurs centaines de milliards d’objets connectés d’ici 2030. Ils nous viennent des projets de l’informatique ambiante, qui date des années 1980 ! On fait advenir des innovations polluantes et énergivores, qui ont été imaginées il y a plus de quarante ans, à une époque qui n’était pas autant confrontée à l’urgence des questions de durabilité.
S’ils servent à capter des données pour les sciences du climat, pourquoi pas. Ce sont les applications commerciales de ces technologies qui sont discutables. Il faut également savoir que les projets d’innovation sont parfois justifiés par des logiques circulaires absurdes : comme on a fait le choix de la 5G, il faut faire advenir des objets connectés qui en dépendent. Et pourquoi a-t-on fait de la 5G ? Pour les objets connectés...
Parmi les communs négatifs, vous citez également les organisations.
Souvent, la critique des organisations se fond simplement dans celle du néolibéralisme. Or, il faut absolument leur faire une place, car elles constituent une cause majeure des problèmes qui sont les nôtres aujourd’hui. Les outils de gestion actuels ne sont plus à même de prendre la mesure des bouleversements en cours et à venir.
Un exemple : la station de ski de Métabief dans le Doubs, où l’activité hivernale apparaît comme dépourvue de viabilité à l’avenir. À ce type de problématique, on répond habituellement par la diversification – le « tourisme quatre saisons ». Or, les responsables de la station ont évalué que cela ne permettrait pas de maintenir l’activité attendue. Dès lors, que faire ? Les outils de gestion à notre disposition sont pris de court. D’où la nécessité d’enquêter sur le terrain pour identifier ce dont le territoire peut vivre, en dehors des balises habituelles.
Vous conseillez des entreprises en redirection écologique. Avez-vous des exemples ?
Avec la ville de Grenoble, nous nous sommes demandé s’il fallait continuer à reconstruire des piscines municipales qui ont une espérance de vie de quarante-cinquante ans. Mon collègue Diego Landivar, avec quatre étudiants de la formation que nous avons montée, a consulté tous les acteurs concernés : les piscinistes, les chauffagistes, les plombiers, et défini un protocole pour associer les citoyens à cette décision, leur permettre d’exprimer leur attachement à l’infrastructure en question.
L’un de nos étudiants, Andrea Angioletti, a travaillé sur le devenir de l’assurance habitation avec la Maif : que faire, quand des zones d’habitation deviennent de moins en moins assurables, notamment avec les phénomènes de retrait-gonflement des argiles qui sont de plus en plus difficiles à assurer, ou encore le recul du trait de côte ?
On pourrait penser que le renoncement relève d’une planification à l’échelle macroéconomique. À vous entendre, le changement vient surtout des organisations.
De toutes les manières, certaines activités sont interrompues, indépendamment de tout plan national ! Le problème de l’échelle macroéconomique, c’est qu’elle est seulement financière : si un actif est appelé à ne plus être rentable, ce que l’on nomme un « actif échoué » , il est conseillé de retirer ses billes pour les investir ailleurs. Que deviennent alors les organisations, les territoires, les gens attachés à ces actifs voués à disparaître ? Ce n’est pas interrogé. Pour prendre la mesure de ce qu’induisent toutes ces transformations à l’échelle du territoire, il faut enquêter. Ce n’est guère le boulot des économistes (même décroissants) ou des politiciens, c’est un travail de terrain – à remettre bien sûr en perspective par la suite.
Que faire des « savoirs inconfortables », qui désignent ces compétences destinées à périmer avec la transition climatique ?
Dire des travailleurs et des travailleuses qu’ils et elles sont des actifs échoués éclipse le fait que, lorsqu’on désaffecte ou réaffecte une activité, il y a des infrastructures qui perdurent, dont il faut gérer la fin de vie, et par conséquent, d’immenses chantiers de maintenance et de réparation. Les actifs échoués, ce sont des activités ou des infrastructures mais certainement pas les travailleurs ! Les « savoirs inconfortables », autrement dit les savoirs de ce qui ne fonctionne pas, des pollutions cachées, etc., doivent être au centre de la redirection. Récemment, des ouvriers des plateformes de raffinage de TotalEnergies ont revendiqué le droit de démanteler les raffineries pour participer eux-mêmes à l’édification d’un nouveau modèle énergétique en France.
“Vouloir revenir au monde du vivant, c’est un refus du monde actuel qui n’aide ni à le comprendre ni à le transformer”
Démanteler, brider le progrès technique : le renoncement n’est-il pas un refus de la modernité ?
Surtout pas ! Beaucoup de contestations aujourd’hui s’inscrivent dans une opposition à la science et la modernité – le mouvement antivax pendant le Covid a manifesté une tendance déjà bien établie. On accuse Descartes et les modernes en voulant s’émanciper de la science occidentale. La Science est résumée à l’Occident, l’Industrie à la Civilisation, ce qui est problématique historiquement et politiquement ! On a parfois l’impression d’être entré dans une vaste gigantomachie, une réaction contre la Technique, la Technologie, l’Industrie, la Civilisation – avec des majuscules à chaque fois. Mais l’antimodernisme vire parfois au complotisme. Vouloir revenir au monde du vivant, se tourner des ontologies vernaculaires et autochtones en guise d’action politique ne constituent pas une réponse actionnable. C’est un refus du monde actuel, qui n’aide ni à le comprendre ni à le transformer.
On se rappelle de la caricature de Macron qui associait l’opposition à la 5G au modèle amish…
Bien sûr ! On baigne dans la caricature, parce qu’on tient à identifier de grandes causes à tous nos problèmes. Comme Nietzsche, qui a vu dans le christianisme la racine de tous nos maux. Ce type d’histoire philosophante qui cible la Modernité, l’Être, le Capitalisme ou la Nature est invariablement bourré de simplifications. Au lieu de chercher des prises et des moyens concrets pour transformer les pratiques, les institutions et les savoirs, on répond par une promesse de grande bascule philosophique, de surcroît pleine de confusion – Philippe Descola nous dit que « la nature, ça n’existe pas », les militants écolos répondent « nous sommes la nature qui se défend »... Plutôt que de céder au solutionnisme ontologique, en faisant de la Modernité un bouc émissaire à liquider (théoriquement plus que matériellement), il faut s’en tenir à des analyses extrêmement circonstanciées. Elles existent, mais en marge des débats actuels. Je prône une certaine sobriété philosophique en la matière.