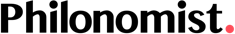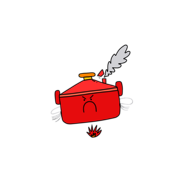La Coupe du monde de rugby n’est plus qu’à un jet de ballon ovale ! Et c’est en France que vont s’affronter les plus grandes équipes à l'automne prochain. Pour vous faire patienter, on vous fait découvrir ce petit dialogue entre Catherine Kintzler, philosophe fan de ballon ovale et Christophe Dominici, ancien ailier légendaire du XV de France, décédé en 2020. Cet échange, publié en 2007 par nos confrères de Philosophie magazine, n’a rien perdu de son actualité. Car pour le joueur comme pour la supportrice, le rugby est une façon exemplaire de se confronter aux choses et aux autres, de se construire.
Propos recueillis par Julien Charnay.
Christophe Dominici : Depuis les années 1990, en France, un regard nouveau se pose sur le rugby. Il n’est plus représenté comme une confrontation de brutes épaisses où le plus agressif et le plus méchant doit nécessairement gagner. La pratique du rugby a évolué. Tout change, la technique et l’esthétique. Avec la professionnalisation et la mondialisation, il est devenu beaucoup plus télévisuel. La Coupe du monde pour laquelle plus de deux millions de billets ont déjà été vendus est la consécration de cette transformation, assez loin de mes débuts à Toulon. J’ai commencé dans un club très atypique qui cultivait des valeurs guerrières. En 1997, j’ai rencontré Max Guazzini, président du Stade français de Paris, club qui avait pour ambition de devenir champion de France. J’ai signé tout de suite. Au début, on jouait devant 2000 personnes. Et puis le club a ouvert grand ses portes à un public nouveau, grâce notamment au calendrier des « Dieux du stade », qui montrait les corps nus des rugbymen. Cela a changé le regard porté sur nous, celui des femmes par exemple.
Catherine Kintzler : Si une femme comme moi, philosophe, est devenue une supportrice du Stade français, c’est parce que, au-delà de la qualité de l’équipe, quelque chose a bougé. J’étais depuis longtemps intéressée et même passionnée par le rugby. Mais je n’osais pas aller à un match, je les suivais à la télé par la médiation de l’écran et du commentateur. Quelle est cette métamorphose dont parle Christophe Dominici ? La vieille langue du rugby, avec ses légendes herculéennes du fond des âges, est venue se brancher sur ce qu’il y a de plus sophistiqué dans la modernité. Pour caractériser cela, je trouve le terme de paillettes trop superficiel. Il y a toute une gestique, une manière hypermoderne de mettre en scène le corps, qui a été intégrée. Pour les maillots, le Stade français a osé choisir le rose et le semis de fleurs à la place des rayures ! Cet esprit m’a tout récemment libérée. La première fois que je vous ai vu arriver « en vrai » sur le terrain, c’était lors du match Paris-Perpignan le 13 mai 2007 : le Stade français portait un maillot rose fluo « deuxième peau » et vous faisiez, pour l’échauffement, des passes sans ballon. Vous m’êtes apparus comme des danseurs. C’était comme une chorégraphie. J’étais ébahie. Ces maillots engagent un rapport au corps dont ils épousent la silhouette. Et puis le rose, il fallait oser ! Je me suis sentie concernée et pas seulement séduite.
“Aujourd’hui, je vais au stade comme je vais à l’opéra, avec l’envie d’assister à un spectacle de haut niveau”
—Catherine Kintzler
C. D. : Je me souviens très bien du premier match que l’on a joué sous la tunique rose. C’était à Perpignan. En tant que capitaine, je suis entré le premier, avec mes coéquipiers dans la foulée. Nous avons eu droit à une immense bronca ! Et puis, petit à petit, ce maillot a été accepté et même plébiscité par ceux qui, hier, nous sifflaient. Le Stade français avait anticipé cette jonction qui s’est opérée entre la mode et le rugby. Pour faire venir à lui un nouveau public, le rugby a épousé une culture du spectacle.
C. K. : Et c’est réussi. Aujourd’hui, je vais au stade comme je vais à l’opéra, avec l’envie d’assister à un spectacle de haut niveau.
C. D. : On a la chance d’avoir un public très différent de celui du football. C’est que l’esprit du rugby est beaucoup moins stressant que celui du football. Tous les samedis, au Parc des Princes, le football prend des allures de théâtre de guerre. La violence engendre la violence.
C. K. : Un des motifs de mon intérêt philosophique pour le rugby est que c’est un jeu où le rapport entre le permis et le défendu n’est pas simpliste et infantile. La faute est intégrée au jeu. La bagarre générale peut exister, mais on apprivoise la violence. Elle est présente mais réprimée, pas refoulée. Du coup, il n’y a pas de retour du refoulé. Dans le football, comme la violence est interdite et refoulée sur le terrain, elle resurgit par moments entre les joueurs ou entre les spectateurs. Dans le rugby, il y a une dimension dialectique. La faute est constitutive, la transgression est traitée, et non simplement exclue. On recule pour avancer. Si on évite de percuter l’adversaire, ce n’est pas parce que cela est défendu, mais par choix ! J’aime le rugby parce qu’il engage un rapport maîtrisé à la force, et comme beaucoup de travailleurs intellectuels, je suis un travailleur de force ! Vous parlez du travail fait par les instances du rugby pour le transformer en spectacle. Mais cette métamorphose n’a pu s’opérer avec succès que parce qu’elle
…(sans coordonnées bancaires)
Accédez gratuitement à l'intégralité du site.
Votre entreprise vous a abonné(e) à Philonomist ?
Cliquez sur le bouton ci-dessous.